Tariq Teguia, un réalisateur algérien au carrefour de l’actualité
Rencontre avec Tariq Teguia, réalisateur et scénariste de Révolution Zendj.
Plébiscité comme « cinéaste phare de l’Algérie contemporaine », Tariq Teguia est l’invité du Centre Pompidou de Paris, qui lui consacre une rétrospective, du 6 au 15 mars 2015. (*) Parallèlement, son nouveau film, Révolution Zendj (**), sort en salles le 11 mars, en France, illustrant l’aptitude de l’artiste à s’émanciper des territoires pour tracer le sillon d’un cinéma d’auteur émancipé.
Tariq Teguia engage depuis ses courts-métrages tournés en Algérie, Ferrailles d'attente, 1998, La Clôture, 2002, une œuvre indépendante, coproduite par la France, dessinant comme une carte significative des frontières qui aliènent. Son premier long-métrage, Rome plutôt que vous, 2006, esquisse une ligne de fuite en impasse pour sortir d’Alger. Inland, 2008, ouvre des perspectives vers le désert algérien où l’on part se révéler en perdant ses repères.
La question s’élargit avec Révolution Zendj, 2013, en suivant l’enquête d’un journaliste algérien sur le soulèvement d’esclaves noirs contre le Califat abbasside, en Irak, au IXème siècle, les impulsions d’une étudiante en Grèce, qui gagne le Liban pour cerner l’impact de son origine palestinienne, et les manoeuvres d’affairistes américains autour de spéculations immobilières en Irak. Ces trajectoires déplacent l’action en Algérie, au Liban, en Irak, aux Etats-Unis et en Grèce où couvent les feux de la révolte contre les forces du capital.
En parcourant ces espaces, Tariq Teguia semble baliser les lueurs de l’identité arabe et ses questions sur la place à trouver pour l’exprimer sans entraves. Révolution Zendj est une œuvre géographique, organique, pulsionnelle et méditée qui mêle les considérations sur le passé, le présent instable et le devenir à conquérir. La qualité des images sous-tend une approche philosophique, à l’écho politique, à partir d’un scénario écrit en 2009, et des impressions saisies durant les déplacements du cinéaste.
En cumulant des moyens éclectiques, issus d’une production française, aidée par l’Algérie et la structure de Yacine Teguia, son frère, le réalisateur bénéficie d’un soutient du Liban via le cinéaste Ghassan Salhab qui campe aussi un rôle, et de Pays du Golfe. La diffusion du film sur le territoire français, est une occasion de saisir le regard du réalisateur sur ce point de son parcours, la possibilité de produire au Maghreb et dans le monde arabe, mais aussi de s’en émanciper pour célébrer la pulsion de résistance et d’affirmation de soi dans un monde en mutations idéologiques et technologiques.
- Vous êtes au coeur de l’actualité avec la sortie de Révolution Zendj mais aussi cette rétrospective assez exhaustive au Centre Pompidou. C’est une convergence occasionnelle ou étudiée ?
On devait d’abord sortir le film et à la différence des premiers longs-métrages, on a pensé s’en occuper nous mêmes, avec la société Zendj, en France, qui l’a produit. Il y a eu une proposition du Centre de faire une avant-première et cette rétrospective. Donc on a décalé notre sortie qui devait avoir lieu en novembre pour qu’elle coïncide avec la proposition du Centre. Révolution Zendj a été très difficile, très long à faire. Je suis sorti épuisé de ce film. Depuis l’année qui a suivi la première mondiale à Rome, je l’ai accompagné dans des festivals donc ce n’était pas compatible avec une distribution en novembre. Voilà comment ça a coïncidé et c’est tant mieux parce que l’investissement du Centre est crucial.
- Voyez-vous ça comme une reconnaissance ?
J’essaie de voir ça modestement. Ce n’est pas une consécration. Je n’ai fait que trois longs-métrages et quelques courts. Je le prends modestement, ça ne peut pas être autrement.
- Vous venez de faire trois longs-métrages qui se correspondent. Est-ce donc une étape qui clôt quelque chose ou allez-vous continuer dans la même dynamique ?
C’est vrai qu’il a un triptyque, trois panneaux qui forment un ensemble. Rome plutôt que vous, c’est l’Algérie de la guerre lente, de la guerre civile. Inland, c’est l’extension de la carte à l’échelle de l’Algérie qui regarde vers l’Afrique. Révolution Zendj étend à nouveau la carte en s’intéressant à d’autres espaces que partage l’Algérie, c’est à dire le monde de la Méditerranée et le monde arabe. Aujourd’hui, je ne peux pas dire ce que ça clôt. Je ne sais pas où je vais et n’ai aucune idée de ce qui arrivera.
Sortir la production d’un territoire
- Vous semblez libre en disant ne pas savoir ce que vous allez faire. Qu’est-ce qui vous permet de garder cette indépendance dans la manière de gérer vos productions ?
C’est parce que l‘on est pauvres, tout simplement. C’est la très grande pauvreté qui rend indépendant, mais qui entrave aussi par d’autres côtés. Je travaille essentiellement avec mon frère [Yacine Teguia, ndlr] comme coscénariste et comme producteur. Les techniciens des films sont des amis, les acteurs aussi pour la plupart. C’est un peu moins vrai sur Révolution Zendj parce qu’il y a plus de monde mais on travaille avec très peu de moyens, car il en faut. Ce n’est pas un film « no budget ». Son budget est de 400 000 euros, ce qui est très peu d’argent pour faire un film comme celui-là. Ça coûte quand on se déplace d’un pays à un autre, qu’on retourne certaines séquences. On a été obligé de repartir à Beyrouth, en Grèce. J’ai peu d’interlocuteurs sur le projet. On a des coproducteurs comme Le Fresnoy, le studio national des arts contemporains. C’est un endroit très confortable pour travailler le mixage et ils n’interviennent pas dans la matière du film. Ils acceptent un projet tel quel. Sur Inland, cela avait été le même mode de production. Les rapports qu’on a eus avec Philippe Carcassonne qui est pourtant un gros producteur, renommé, ont été du même ordre. Il n’est pas intervenu en disant :« iI ne faut pas faire ça, il faut le faire différemment ». On a fait le film, c’est tout.
- Donc pour Révolution Zendj, vous partez de la petite structure avec votre frère qui a une société en Algérie, et la société en France. Comment agrégez-vous les moyens et les autres participations ?
Le procédé est très simple. On doit écrire un scénario d’une centaine de pages. Moi et mon frère, on sait à peu près où on va s’adresser. On va aux guichets qui nous connaissent un peu. Je pense en particulier au Fonds Hubert Bals dont on a toujours eu le soutien. Les sommes ne sont pas énormes mais elles sont fondamentales car elles impulsent un processus de financement. L’aide au développement commence avec 10 000 euros. Une fois qu’on a acquis ça et qu’on dit qu’on est aidé par le fonds qui est reconnu et appuie des cinéastes conséquents, je vais demander de l’argent au Ministère algérien de la culture. Il y a un fonds pour ça, le FDATIC, avec un plafond d’environ 100 000 euros. On l’a déposé là et ensuite au Fonds Sud qui n’a plus le même nom aujourd’hui. Mais ça, on ne l’a pas obtenu pour Révolution Zendj. On a demandé au Fonds du cinéma du Val-de-Marne qui nous a donné une aide. Puis il y a des fonds arabes qui vont jusqu’à 100 000 euros environ. Ils proviennent des Pays du Golfe, de Abu Dhabi, Dubaï et Doha avec le Doha Film Institute, au Qatar. Ils aident en pré production, en production. Ça tourne en moyenne autour de 100 000 dollars chez eux. Voilà comment ces petites sommes se sont agrégées. Donc on a eu de l’argent public en France avec le Val-de-Marne et le Centre National des Arts Plastiques aussi. C’est un indice : pour Révolution Zendj, on n’a pas eu un fonds de cinéma comme le Fonds Sud qui a rejeté le projet, mais en revanche on a de l’argent qui vient d’un fonds destiné à aider les arts plastiques, c’est à dire les œuvres de musée, les performances, les installations, l’art vidéo, la sculpture. C’est un signe qui indique où certains pensent que le travail doit être, c’est à dire pas nécessairement dans une salle de cinéma mais aussi au musée, dans une galerie…
- Vous situez-vous comme un cinéaste plasticien, un plasticien cinéaste ?
Je me considère comme un cinéaste. Mes longs-métrages sont ceux d’un cinéaste. C’est ce qu’il y a marqué sur mon passeport d’ailleurs. Ceci dit, c’est vrai que dans ces films qui sont ceux d’un cinéaste, cela ne m’interdit pas d’aller regarder du côté de la photographie, de la chorégraphie, de la danse, du côté de la peinture, des installations. Dans les films mêmes, je ne m’interdis pas d’aller voir vers d’autres pratiques.
Sortir l’histoire des frontières
- Avec Révolution Zendj, on sent une tentation de relire l’Histoire, celle des esclaves, de la question palestinienne dans la guère du Liban… Est-ce une manière de la réévaluer ?
En parlant de triptyque à propos de mes longs-métrages, j’ai parlé de géographie, algérienne d’abord. Cette question est fondamentale. Dans Révolution Zendj, le journaliste s’appelle Ibn Battutâ qui est le nom d’un grand voyageur arabe du XIIIème siècle, parti de Tanger pour traverser l’ensemble du monde musulman pendant 30 ans. Il a visité Bagdad, Damas, a été jusqu’en Indonésie, en se posant cette question : « Qu’est-ce que c’est qu’être musulman ? » Notre journaliste algérien ne se pose pas cette question mais il se demande : « Qu’est-ce que c’est qu’être citoyen dans le monde arabe ? » C’est la question sous-jacente à son périple. Il y a donc la question de la géographie et la question de l’Histoire comme vous le dites. Ce que j’ai voulu faire, c’est montrer comment des questionnements très anciens, des oppressions très vieilles, nous éclairaient sur ce qui se joue au présent. Ce n’est pas une relecture, une réévaluation. La révolution Zendj si elle est peu connue dans le monde occidental, c’est un épisode de l’histoire du monde musulman et du monde arabe en particulier, qui y est relativement connu. Les uns les ont très mal jugé, considérant que le maître des Zendjs est un hérétique qui doit être condamné, dont la figure doit être ternie et oubliée. Mais en même temps dans les années 70, dans les gauches arabes, la révolution Zendj a servi de modèle en montrant des opprimés qui se soulèvent contre leurs oppresseurs. De la même manière, la révolte de Spartacus dans le monde romain, a servi de modèle et a même donné son nom à un mouvement révolutionnaire, en Allemagne, dans les années 1910, les Spartakistes. C’est donc moins relire l’Histoire que la reconnecter et montrer qu’il y a des mouvements de l’Histoire que rien n’éteindra. Ce dont je parle dans le film, c’est le refus de l’oppression, c’est qu’il y a une persistance des luttes. Et il y a une nécessité des luttes.
- Vous reliez l’Histoire, vous reliez les temps mais aussi les histoires de ces individus particuliers qui sont les personnages du film. Quelle est la teneur de la trame que vous avez tissée autour ?
C’est une trame relâchée. Peut-être qu’en tant que scénariste, mon frère ne sera pas forcément d’accord sur ce point, mais de toutes manière on s’entend sur l’essentiel. En tant que cinéaste, je peux dire que pour le film, la trame narrative reste relativement lâche. Ce n’est pas ce qui me passionne le plus, ce n’est pas là que je travaille le plus. Ça valait déjà pour Rome plutôt que vous et Inland. Les articulations narratives, la progression restent lâche parce que je veux faire autre chose. Je ne veux pas véritablement raconter une histoire. Ma tentative a été à chaque fois de mettre en forme des sensations.
- Comment avez-vous choisi vos points de chute : le sud de l’Algérie, Beyrouth, Thessalonique, les Etats-Unis, l’Irak ?
Ce sont des endroits que j’ai traversés. Après Inland, en 2009, j’ai été amené à suivre le film dans les festivals. J’ai été en Algérie, dans le monde arabe, aux Etats-Unis, en Europe, à Thessalonique, Beyrouth, Damas, au Caire, à Alexandrie… Une part du travail du cinéaste, c’est de regarder autour de soi ce qui se passe, ce qui se produit, ce qu’il advient et comment ça devient. À partir de ces notes, on a écrit un premier scénario avec mon frère, qui a été déposé dans les commissions plusieurs mois avant que ne débutent les premières émeutes qui vont donner lieu aux révolutions du monde arabe. Le premier jour de tournage a eu lieu à Athènes, quelques jours avant que ça s’enflamme en Tunisie. Les manifestations ont confirmé notre intuition qui était de dire que les oppressions ne peuvent pas durer. On n’en est pas sortis pour autant mais il y a eu un sursaut et il y en aura d’autres. Ce film là avait pour ambition de montrer que les luttes étaient liées entre elles. Elles se répondaient. Ce qui se jouait dans le monde arabe avait des implications en Europe. On l’a vu ensuite avec les occupations des places par les Indignados qui étaient en miroir de ce qui se passait à Tahrir, au Caire.
- Pourquoi malgré tout ce qui s’est passé dans ces pays, avez-vous concentré votre propos sur quatre zones pour réaliser le film ?
Parce que c’est là que ça m’a frappé, notamment en Grèce. Il y avait dans les universités, un appétit politique que je voyais beaucoup moins par exemple, dans les universités françaises dont je suis sorti d’une certaine manière. Cet appétit politique, je le voyais beaucoup moins ailleurs, en Europe. J’ai vu des choses aussi à Damas, à Beyrouth. Après évidemment quand on cartographie avec nos moyens, il n’est pas possible de faire tous les pays. Donc on a choisi des lieux qui à un moment donné, ont porté et continuent à porter un idéal notamment révolutionnaire. C’est le cas de Beyrouth qui dans les années 1970-1980, a vu arriver beaucoup de révolutionnaires du monde arabe mais pas seulement. Il y avait un bouillonnement révolutionnaire. La question est de savoir ce qu’il en est resté.
- Avez-vous travaillé différemment dans chaque zone de tournage ?
Fondamentalement non. C’est toujours une petite équipe, les mêmes techniciens que pour Inland : directeur photo, preneurs de son, script… Il y a mon frère à la production, les acteurs que l’on voyait déjà dans Inland et qu’on retrouve ailleurs dans d’autres rôles. Localement, on se fait aider d’amis. À Beyrouth par exemple, j’ai demandé à Ghassan Salhab s’il ne connaîtrait pas quelqu’un qui pourrait nous aider pour la production, les autorisations. Ça a été la même chose en Grèce, à New York. Donc le cœur est toujours le même, ensuite on va prendre localement deux ou trois personnes. Guère plus en général.
Sortir les images des flots narratifs
- Comment arrivez-vous à relier les blocs de scènes, tournées à des endroits différents, à des époques parfois différentes, qui ressemblent presque à des cellules autonomes mais qui ont des correspondances ?
Par le montage, le rythme, les couleurs. La narration est relativement lâche comme je l’ai dit, mais on arrive à suivre un récit. Il est question malgré tout d’un mobile dans ce film, et de la manière dont les choses se déplacent les unes par rapport aux autres. Elles se recouvrent quelquefois. On passe d’un plan à l’autre, d’une ville à une autre, d’Alger à Thessalonique, sans qu’on sache où l’on se trouve, imperceptiblement. C’est fait pour ça. Les choses se font au montage, en terme de colorimétrie, de mouvements, de textures. Par exemple, Z de Costa-Gavras a été tourné à Alger alors que le récit se passe à Thessalonique où il y a la scène du journaliste assassiné par les Colonels grecs. Moi aussi, je remets en lien des choses qui ont déjà été dites par d’autres cinéastes. Je monte des rythmes, pas seulement la narration…
- Vous parlez de Costa Gavras mais dans le film, vous citez un autre cinéaste, Jean-Luc Godard. Pourquoi cette référence directe à son film Ici et ailleurs, réalisé avec Anne-Marie Miéville, en 1978 ?
C’est moins pour moi une référence qu’un dialogue avec ce film. Il parlait de la lutte des Palestiniens. Ici et ailleurs avait été commandé par l’OLP à l’époque, mais en même temps il témoignait d’un constat de la défaite. Le film avait été fait en deux temps et les gens qui ont été filmés par Godard et Mieville étaient pratiquement tous morts pendant Septembre noir, dans un camp, en Jordanie. Révolution Zendj est aussi un constat de la défaite d’un certain discours militant de gauche, qui à l’orée du XXIème siècle, semblait avoir totalement échoué dans ses buts et dans ses ambitions. D’une certaine manière, je renouais le contact avec le film de Godard qui faisait aussi ce constat, il y a plus de 30 ans déjà. Voilà comment connecter les films entre eux, et donc dialoguer avec les films. C’est de l’Histoire mais c’est aussi l’histoire du cinéma.
- Pourquoi donner une place importante à une pièce de théâtre, tirée du texte de Michel Butor, Mobile : Etude pour une représentation des Etats-Unis, de 1962, que répètent les étudiants grecs ?
Le titre de la pièce, c’est Mobile. Le texte de Butor est né précisément d’un voyage à travers les Etats-Unis avec une vision très cartographique, instantanée, éclatée. C’est précisément le projet de Révolution Zendj. Dans le film, on voit des entrepreneurs anglo-saxons s’agiter à refaire les cartes du monde. Ils sont un peu le versant violent et cupide d’un projet politique, néo conservateur américain. En même temps, il y a dans ce que j’ai fait d’autres Amériques. Il y en avait une déjà évoquée dans Rome plutôt que vous, une autre plus manifeste dans Inland à travers la figure de Allen Ginsberg ou tout simplement du road movie qui vient directement de l’histoire américaine du cinéma. Dans celui-là, il y en d’autres. Ce qui m’intéresse, c’est l’Amérique de la cabale, de la pulvérisation. Le film est aussi un hommage à Jackson Pollock dont il faut se souvenir, à la peinture américaine qui me passionne. On a parlé de fragments, de choses qui n’étaient pas d’emblée reliées entre elles. Moi, j’ai fabriqué en quelque sorte, un paysage d’événements. Le livre de Michel Butor est précisément cela, à l’échelle de l’Amérique.
Sortir les armes de l’esprit
- Pensez-vous que le cinéma est là pour regarder le monde ou pour fabriquer un autre monde ?
Pour voir le monde il faut le refabriquer. C’est le principe même de la fiction. Agencer le visible, le réorganiser, essayer de faire percevoir plus que le visible, le réel, c’est difficile. Le moyen de percevoir, de comprendre le visible, le réel, il faut donc le refabriquer, prendre des bouts ici et là. Sans ça, c’est de la télésurveillance. Le processus de la fiction, c’est cette reconstruction, ce creusement.
- C’est ça qui permet de tisser cet univers, de cartographier le monde pour vous ?
La cartographie, c’est une synthèse du visible. C’est comment en deux plans, on fait coexister des espaces très grands. On peut donner à voir des populations, des comportements. D’une certaine manière, je travaille comme un cartographe qui essaie de synthétiser des situations au Proche-Orient, en Europe. Ce film n’est pas seulement un film sur le monde arabe, il est fondamentalement un film sur le monde méditerranéen et donc aussi sur l’Europe. Je ne voudrais pas qu’on le réduise à une lecture des révoltes arabes passées ou en cours. La question, c’était de relier les luttes entre elles. Il y a un phénomène de « mondialisation » comme on dit, du marché, du capital. La question c’est : comment résiste-t-on, qu’est-ce qu’on oppose à ce capital, à ce marché ? On oppose des luttes mais je vois bien qu’elles sont dispersées. Elles ne se connaissent pas. Quand je parlais de mon projet à des étudiants grecs, ils me disaient : « Mais quel rapport crois-tu qu’on a avec le monde arabe ? » Ca leur est devenu plus clair quand ils se sont mis eux-mêmes, à occuper la plus grande place d’Athènes. D’habitude, les Grecs ne font pas ça. Ils défilent, ils marchent et il y a de très grandes manifestations. Occuper la place comme ils l’ont fait, en 2011, comme l’ont fait les Espagnols, comme d’autres ont occupé Wall Street, ça vient du monde arabe. Beaucoup de gens ont compris que ce qui se passait là-bas avait à voir avec ce qui se passait ici. Ici et ailleurs.
- Peut-on dire que quand vous faites Révolution Zendj, c’est une manière de réactiver une attitude citoyenne ?
Oui et même une attitude militante. Même si je dois m’efforcer de trouver des formes puisque je fais des films. Ca prend le détour de la fiction, parfois de la narration, de la peinture, de la musique, du rythme, de la danse. Je fais un film avec tout ce qui me tombe sous la main.
- Aujourd’hui, le cinéma fait-il sa révolution ?
Le cinéma est un objet trop vaste. Il faudrait voir les diverses cinématographies, par exemple ce qui se joue en Amérique du Sud. Je pense qu’il y a un regain, un nouvel intérêt y compris en Europe où ces questions là semblaient avoir été un peu perdues de vue. Je ne parle pas du cinéma militant qui a toujours existé mais je n’ai pas le projet d’en faire. Dans les débats strictement militants, Révolution Zendj n’a pas véritablement sa place parce qu’il ne peut pas servir d’outil de combat. Il n’est pas fait dans cette optique. Il me semble donc qu’il y a un frémissement même en Europe. Mais ce n’est pas le cinéma de lui-même, par lui-même, qui va s’inventer des objets. Je pense que c’est la société qui va les imposer au cinéma, et donc aux cinéastes. Il y a eu un temps où il y avait un questionnement politique qui a produit des films. Moi, si je fais Révolution Zendj, c’est parce que ça me semble comme imposé par des conditions historiques, géographiques, politiques, sociales. C’est lié à l’histoire de l’Algérie, du monde arabe, du monde méditerranéen. Quand les questions vont se poser dans la société, de manière accrue, plus tendue, en France, en Italie, peut-être que des cinéastes reviendront à un cinéma qui se posera des questions de cinéma et de politique.
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
(Africiné / Paris)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(*) Tariq Teguia, films et rencontres, du 6 au 15 mars 2015, au Centre Georges Pompidou à Paris. La programmation propose de découvrir tous les films de l’artiste algérien y compris Kech'mouvement ?, 1992, retrouvé et restauré pour la circonstance. Le cinéaste accompagne les séances en compagnie d’un invité, présente ses films et dialogue avec le public. Une rencontre autour de son travail prend place parmi les séances du cycle. Un film inédit, commandé par le Centre Pompidou et coproduit par la chaine Arte, Où en êtes-vous, Tariq Teguia ?, est réalisé par l’artiste lui-même et dévoilé durant les séances de ses courts- métrages. La rétrospective compte ainsi 8 films, répartis en 8 séances.
(**)Révolution Zendj a obtenu Le grand Prix Jeanine Bazin au festival Entrevues de Belfort 2013, le Prix Scribe pour le Cinéma à Paris, en 2013, le Prix Anno Uno au Festival international de cinéma et d’art de Trieste 2014. Il est distribué par la société Zendj où est impliqué Tariq Teguia, avec le soutien du Groupement National des Cinémas de Recherche.
Photo : Tariq Teguia, réalisateur algérien.
Crédit: DR
Tariq Teguia engage depuis ses courts-métrages tournés en Algérie, Ferrailles d'attente, 1998, La Clôture, 2002, une œuvre indépendante, coproduite par la France, dessinant comme une carte significative des frontières qui aliènent. Son premier long-métrage, Rome plutôt que vous, 2006, esquisse une ligne de fuite en impasse pour sortir d’Alger. Inland, 2008, ouvre des perspectives vers le désert algérien où l’on part se révéler en perdant ses repères.
La question s’élargit avec Révolution Zendj, 2013, en suivant l’enquête d’un journaliste algérien sur le soulèvement d’esclaves noirs contre le Califat abbasside, en Irak, au IXème siècle, les impulsions d’une étudiante en Grèce, qui gagne le Liban pour cerner l’impact de son origine palestinienne, et les manoeuvres d’affairistes américains autour de spéculations immobilières en Irak. Ces trajectoires déplacent l’action en Algérie, au Liban, en Irak, aux Etats-Unis et en Grèce où couvent les feux de la révolte contre les forces du capital.
En parcourant ces espaces, Tariq Teguia semble baliser les lueurs de l’identité arabe et ses questions sur la place à trouver pour l’exprimer sans entraves. Révolution Zendj est une œuvre géographique, organique, pulsionnelle et méditée qui mêle les considérations sur le passé, le présent instable et le devenir à conquérir. La qualité des images sous-tend une approche philosophique, à l’écho politique, à partir d’un scénario écrit en 2009, et des impressions saisies durant les déplacements du cinéaste.
En cumulant des moyens éclectiques, issus d’une production française, aidée par l’Algérie et la structure de Yacine Teguia, son frère, le réalisateur bénéficie d’un soutient du Liban via le cinéaste Ghassan Salhab qui campe aussi un rôle, et de Pays du Golfe. La diffusion du film sur le territoire français, est une occasion de saisir le regard du réalisateur sur ce point de son parcours, la possibilité de produire au Maghreb et dans le monde arabe, mais aussi de s’en émanciper pour célébrer la pulsion de résistance et d’affirmation de soi dans un monde en mutations idéologiques et technologiques.
- Vous êtes au coeur de l’actualité avec la sortie de Révolution Zendj mais aussi cette rétrospective assez exhaustive au Centre Pompidou. C’est une convergence occasionnelle ou étudiée ?
On devait d’abord sortir le film et à la différence des premiers longs-métrages, on a pensé s’en occuper nous mêmes, avec la société Zendj, en France, qui l’a produit. Il y a eu une proposition du Centre de faire une avant-première et cette rétrospective. Donc on a décalé notre sortie qui devait avoir lieu en novembre pour qu’elle coïncide avec la proposition du Centre. Révolution Zendj a été très difficile, très long à faire. Je suis sorti épuisé de ce film. Depuis l’année qui a suivi la première mondiale à Rome, je l’ai accompagné dans des festivals donc ce n’était pas compatible avec une distribution en novembre. Voilà comment ça a coïncidé et c’est tant mieux parce que l’investissement du Centre est crucial.
- Voyez-vous ça comme une reconnaissance ?
J’essaie de voir ça modestement. Ce n’est pas une consécration. Je n’ai fait que trois longs-métrages et quelques courts. Je le prends modestement, ça ne peut pas être autrement.
- Vous venez de faire trois longs-métrages qui se correspondent. Est-ce donc une étape qui clôt quelque chose ou allez-vous continuer dans la même dynamique ?
C’est vrai qu’il a un triptyque, trois panneaux qui forment un ensemble. Rome plutôt que vous, c’est l’Algérie de la guerre lente, de la guerre civile. Inland, c’est l’extension de la carte à l’échelle de l’Algérie qui regarde vers l’Afrique. Révolution Zendj étend à nouveau la carte en s’intéressant à d’autres espaces que partage l’Algérie, c’est à dire le monde de la Méditerranée et le monde arabe. Aujourd’hui, je ne peux pas dire ce que ça clôt. Je ne sais pas où je vais et n’ai aucune idée de ce qui arrivera.
Sortir la production d’un territoire
- Vous semblez libre en disant ne pas savoir ce que vous allez faire. Qu’est-ce qui vous permet de garder cette indépendance dans la manière de gérer vos productions ?
C’est parce que l‘on est pauvres, tout simplement. C’est la très grande pauvreté qui rend indépendant, mais qui entrave aussi par d’autres côtés. Je travaille essentiellement avec mon frère [Yacine Teguia, ndlr] comme coscénariste et comme producteur. Les techniciens des films sont des amis, les acteurs aussi pour la plupart. C’est un peu moins vrai sur Révolution Zendj parce qu’il y a plus de monde mais on travaille avec très peu de moyens, car il en faut. Ce n’est pas un film « no budget ». Son budget est de 400 000 euros, ce qui est très peu d’argent pour faire un film comme celui-là. Ça coûte quand on se déplace d’un pays à un autre, qu’on retourne certaines séquences. On a été obligé de repartir à Beyrouth, en Grèce. J’ai peu d’interlocuteurs sur le projet. On a des coproducteurs comme Le Fresnoy, le studio national des arts contemporains. C’est un endroit très confortable pour travailler le mixage et ils n’interviennent pas dans la matière du film. Ils acceptent un projet tel quel. Sur Inland, cela avait été le même mode de production. Les rapports qu’on a eus avec Philippe Carcassonne qui est pourtant un gros producteur, renommé, ont été du même ordre. Il n’est pas intervenu en disant :« iI ne faut pas faire ça, il faut le faire différemment ». On a fait le film, c’est tout.
- Donc pour Révolution Zendj, vous partez de la petite structure avec votre frère qui a une société en Algérie, et la société en France. Comment agrégez-vous les moyens et les autres participations ?
Le procédé est très simple. On doit écrire un scénario d’une centaine de pages. Moi et mon frère, on sait à peu près où on va s’adresser. On va aux guichets qui nous connaissent un peu. Je pense en particulier au Fonds Hubert Bals dont on a toujours eu le soutien. Les sommes ne sont pas énormes mais elles sont fondamentales car elles impulsent un processus de financement. L’aide au développement commence avec 10 000 euros. Une fois qu’on a acquis ça et qu’on dit qu’on est aidé par le fonds qui est reconnu et appuie des cinéastes conséquents, je vais demander de l’argent au Ministère algérien de la culture. Il y a un fonds pour ça, le FDATIC, avec un plafond d’environ 100 000 euros. On l’a déposé là et ensuite au Fonds Sud qui n’a plus le même nom aujourd’hui. Mais ça, on ne l’a pas obtenu pour Révolution Zendj. On a demandé au Fonds du cinéma du Val-de-Marne qui nous a donné une aide. Puis il y a des fonds arabes qui vont jusqu’à 100 000 euros environ. Ils proviennent des Pays du Golfe, de Abu Dhabi, Dubaï et Doha avec le Doha Film Institute, au Qatar. Ils aident en pré production, en production. Ça tourne en moyenne autour de 100 000 dollars chez eux. Voilà comment ces petites sommes se sont agrégées. Donc on a eu de l’argent public en France avec le Val-de-Marne et le Centre National des Arts Plastiques aussi. C’est un indice : pour Révolution Zendj, on n’a pas eu un fonds de cinéma comme le Fonds Sud qui a rejeté le projet, mais en revanche on a de l’argent qui vient d’un fonds destiné à aider les arts plastiques, c’est à dire les œuvres de musée, les performances, les installations, l’art vidéo, la sculpture. C’est un signe qui indique où certains pensent que le travail doit être, c’est à dire pas nécessairement dans une salle de cinéma mais aussi au musée, dans une galerie…
- Vous situez-vous comme un cinéaste plasticien, un plasticien cinéaste ?
Je me considère comme un cinéaste. Mes longs-métrages sont ceux d’un cinéaste. C’est ce qu’il y a marqué sur mon passeport d’ailleurs. Ceci dit, c’est vrai que dans ces films qui sont ceux d’un cinéaste, cela ne m’interdit pas d’aller regarder du côté de la photographie, de la chorégraphie, de la danse, du côté de la peinture, des installations. Dans les films mêmes, je ne m’interdis pas d’aller voir vers d’autres pratiques.
Sortir l’histoire des frontières
- Avec Révolution Zendj, on sent une tentation de relire l’Histoire, celle des esclaves, de la question palestinienne dans la guère du Liban… Est-ce une manière de la réévaluer ?
En parlant de triptyque à propos de mes longs-métrages, j’ai parlé de géographie, algérienne d’abord. Cette question est fondamentale. Dans Révolution Zendj, le journaliste s’appelle Ibn Battutâ qui est le nom d’un grand voyageur arabe du XIIIème siècle, parti de Tanger pour traverser l’ensemble du monde musulman pendant 30 ans. Il a visité Bagdad, Damas, a été jusqu’en Indonésie, en se posant cette question : « Qu’est-ce que c’est qu’être musulman ? » Notre journaliste algérien ne se pose pas cette question mais il se demande : « Qu’est-ce que c’est qu’être citoyen dans le monde arabe ? » C’est la question sous-jacente à son périple. Il y a donc la question de la géographie et la question de l’Histoire comme vous le dites. Ce que j’ai voulu faire, c’est montrer comment des questionnements très anciens, des oppressions très vieilles, nous éclairaient sur ce qui se joue au présent. Ce n’est pas une relecture, une réévaluation. La révolution Zendj si elle est peu connue dans le monde occidental, c’est un épisode de l’histoire du monde musulman et du monde arabe en particulier, qui y est relativement connu. Les uns les ont très mal jugé, considérant que le maître des Zendjs est un hérétique qui doit être condamné, dont la figure doit être ternie et oubliée. Mais en même temps dans les années 70, dans les gauches arabes, la révolution Zendj a servi de modèle en montrant des opprimés qui se soulèvent contre leurs oppresseurs. De la même manière, la révolte de Spartacus dans le monde romain, a servi de modèle et a même donné son nom à un mouvement révolutionnaire, en Allemagne, dans les années 1910, les Spartakistes. C’est donc moins relire l’Histoire que la reconnecter et montrer qu’il y a des mouvements de l’Histoire que rien n’éteindra. Ce dont je parle dans le film, c’est le refus de l’oppression, c’est qu’il y a une persistance des luttes. Et il y a une nécessité des luttes.
- Vous reliez l’Histoire, vous reliez les temps mais aussi les histoires de ces individus particuliers qui sont les personnages du film. Quelle est la teneur de la trame que vous avez tissée autour ?
C’est une trame relâchée. Peut-être qu’en tant que scénariste, mon frère ne sera pas forcément d’accord sur ce point, mais de toutes manière on s’entend sur l’essentiel. En tant que cinéaste, je peux dire que pour le film, la trame narrative reste relativement lâche. Ce n’est pas ce qui me passionne le plus, ce n’est pas là que je travaille le plus. Ça valait déjà pour Rome plutôt que vous et Inland. Les articulations narratives, la progression restent lâche parce que je veux faire autre chose. Je ne veux pas véritablement raconter une histoire. Ma tentative a été à chaque fois de mettre en forme des sensations.
- Comment avez-vous choisi vos points de chute : le sud de l’Algérie, Beyrouth, Thessalonique, les Etats-Unis, l’Irak ?
Ce sont des endroits que j’ai traversés. Après Inland, en 2009, j’ai été amené à suivre le film dans les festivals. J’ai été en Algérie, dans le monde arabe, aux Etats-Unis, en Europe, à Thessalonique, Beyrouth, Damas, au Caire, à Alexandrie… Une part du travail du cinéaste, c’est de regarder autour de soi ce qui se passe, ce qui se produit, ce qu’il advient et comment ça devient. À partir de ces notes, on a écrit un premier scénario avec mon frère, qui a été déposé dans les commissions plusieurs mois avant que ne débutent les premières émeutes qui vont donner lieu aux révolutions du monde arabe. Le premier jour de tournage a eu lieu à Athènes, quelques jours avant que ça s’enflamme en Tunisie. Les manifestations ont confirmé notre intuition qui était de dire que les oppressions ne peuvent pas durer. On n’en est pas sortis pour autant mais il y a eu un sursaut et il y en aura d’autres. Ce film là avait pour ambition de montrer que les luttes étaient liées entre elles. Elles se répondaient. Ce qui se jouait dans le monde arabe avait des implications en Europe. On l’a vu ensuite avec les occupations des places par les Indignados qui étaient en miroir de ce qui se passait à Tahrir, au Caire.
- Pourquoi malgré tout ce qui s’est passé dans ces pays, avez-vous concentré votre propos sur quatre zones pour réaliser le film ?
Parce que c’est là que ça m’a frappé, notamment en Grèce. Il y avait dans les universités, un appétit politique que je voyais beaucoup moins par exemple, dans les universités françaises dont je suis sorti d’une certaine manière. Cet appétit politique, je le voyais beaucoup moins ailleurs, en Europe. J’ai vu des choses aussi à Damas, à Beyrouth. Après évidemment quand on cartographie avec nos moyens, il n’est pas possible de faire tous les pays. Donc on a choisi des lieux qui à un moment donné, ont porté et continuent à porter un idéal notamment révolutionnaire. C’est le cas de Beyrouth qui dans les années 1970-1980, a vu arriver beaucoup de révolutionnaires du monde arabe mais pas seulement. Il y avait un bouillonnement révolutionnaire. La question est de savoir ce qu’il en est resté.
- Avez-vous travaillé différemment dans chaque zone de tournage ?
Fondamentalement non. C’est toujours une petite équipe, les mêmes techniciens que pour Inland : directeur photo, preneurs de son, script… Il y a mon frère à la production, les acteurs que l’on voyait déjà dans Inland et qu’on retrouve ailleurs dans d’autres rôles. Localement, on se fait aider d’amis. À Beyrouth par exemple, j’ai demandé à Ghassan Salhab s’il ne connaîtrait pas quelqu’un qui pourrait nous aider pour la production, les autorisations. Ça a été la même chose en Grèce, à New York. Donc le cœur est toujours le même, ensuite on va prendre localement deux ou trois personnes. Guère plus en général.
Sortir les images des flots narratifs
- Comment arrivez-vous à relier les blocs de scènes, tournées à des endroits différents, à des époques parfois différentes, qui ressemblent presque à des cellules autonomes mais qui ont des correspondances ?
Par le montage, le rythme, les couleurs. La narration est relativement lâche comme je l’ai dit, mais on arrive à suivre un récit. Il est question malgré tout d’un mobile dans ce film, et de la manière dont les choses se déplacent les unes par rapport aux autres. Elles se recouvrent quelquefois. On passe d’un plan à l’autre, d’une ville à une autre, d’Alger à Thessalonique, sans qu’on sache où l’on se trouve, imperceptiblement. C’est fait pour ça. Les choses se font au montage, en terme de colorimétrie, de mouvements, de textures. Par exemple, Z de Costa-Gavras a été tourné à Alger alors que le récit se passe à Thessalonique où il y a la scène du journaliste assassiné par les Colonels grecs. Moi aussi, je remets en lien des choses qui ont déjà été dites par d’autres cinéastes. Je monte des rythmes, pas seulement la narration…
- Vous parlez de Costa Gavras mais dans le film, vous citez un autre cinéaste, Jean-Luc Godard. Pourquoi cette référence directe à son film Ici et ailleurs, réalisé avec Anne-Marie Miéville, en 1978 ?
C’est moins pour moi une référence qu’un dialogue avec ce film. Il parlait de la lutte des Palestiniens. Ici et ailleurs avait été commandé par l’OLP à l’époque, mais en même temps il témoignait d’un constat de la défaite. Le film avait été fait en deux temps et les gens qui ont été filmés par Godard et Mieville étaient pratiquement tous morts pendant Septembre noir, dans un camp, en Jordanie. Révolution Zendj est aussi un constat de la défaite d’un certain discours militant de gauche, qui à l’orée du XXIème siècle, semblait avoir totalement échoué dans ses buts et dans ses ambitions. D’une certaine manière, je renouais le contact avec le film de Godard qui faisait aussi ce constat, il y a plus de 30 ans déjà. Voilà comment connecter les films entre eux, et donc dialoguer avec les films. C’est de l’Histoire mais c’est aussi l’histoire du cinéma.
- Pourquoi donner une place importante à une pièce de théâtre, tirée du texte de Michel Butor, Mobile : Etude pour une représentation des Etats-Unis, de 1962, que répètent les étudiants grecs ?
Le titre de la pièce, c’est Mobile. Le texte de Butor est né précisément d’un voyage à travers les Etats-Unis avec une vision très cartographique, instantanée, éclatée. C’est précisément le projet de Révolution Zendj. Dans le film, on voit des entrepreneurs anglo-saxons s’agiter à refaire les cartes du monde. Ils sont un peu le versant violent et cupide d’un projet politique, néo conservateur américain. En même temps, il y a dans ce que j’ai fait d’autres Amériques. Il y en avait une déjà évoquée dans Rome plutôt que vous, une autre plus manifeste dans Inland à travers la figure de Allen Ginsberg ou tout simplement du road movie qui vient directement de l’histoire américaine du cinéma. Dans celui-là, il y en d’autres. Ce qui m’intéresse, c’est l’Amérique de la cabale, de la pulvérisation. Le film est aussi un hommage à Jackson Pollock dont il faut se souvenir, à la peinture américaine qui me passionne. On a parlé de fragments, de choses qui n’étaient pas d’emblée reliées entre elles. Moi, j’ai fabriqué en quelque sorte, un paysage d’événements. Le livre de Michel Butor est précisément cela, à l’échelle de l’Amérique.
Sortir les armes de l’esprit
- Pensez-vous que le cinéma est là pour regarder le monde ou pour fabriquer un autre monde ?
Pour voir le monde il faut le refabriquer. C’est le principe même de la fiction. Agencer le visible, le réorganiser, essayer de faire percevoir plus que le visible, le réel, c’est difficile. Le moyen de percevoir, de comprendre le visible, le réel, il faut donc le refabriquer, prendre des bouts ici et là. Sans ça, c’est de la télésurveillance. Le processus de la fiction, c’est cette reconstruction, ce creusement.
- C’est ça qui permet de tisser cet univers, de cartographier le monde pour vous ?
La cartographie, c’est une synthèse du visible. C’est comment en deux plans, on fait coexister des espaces très grands. On peut donner à voir des populations, des comportements. D’une certaine manière, je travaille comme un cartographe qui essaie de synthétiser des situations au Proche-Orient, en Europe. Ce film n’est pas seulement un film sur le monde arabe, il est fondamentalement un film sur le monde méditerranéen et donc aussi sur l’Europe. Je ne voudrais pas qu’on le réduise à une lecture des révoltes arabes passées ou en cours. La question, c’était de relier les luttes entre elles. Il y a un phénomène de « mondialisation » comme on dit, du marché, du capital. La question c’est : comment résiste-t-on, qu’est-ce qu’on oppose à ce capital, à ce marché ? On oppose des luttes mais je vois bien qu’elles sont dispersées. Elles ne se connaissent pas. Quand je parlais de mon projet à des étudiants grecs, ils me disaient : « Mais quel rapport crois-tu qu’on a avec le monde arabe ? » Ca leur est devenu plus clair quand ils se sont mis eux-mêmes, à occuper la plus grande place d’Athènes. D’habitude, les Grecs ne font pas ça. Ils défilent, ils marchent et il y a de très grandes manifestations. Occuper la place comme ils l’ont fait, en 2011, comme l’ont fait les Espagnols, comme d’autres ont occupé Wall Street, ça vient du monde arabe. Beaucoup de gens ont compris que ce qui se passait là-bas avait à voir avec ce qui se passait ici. Ici et ailleurs.
- Peut-on dire que quand vous faites Révolution Zendj, c’est une manière de réactiver une attitude citoyenne ?
Oui et même une attitude militante. Même si je dois m’efforcer de trouver des formes puisque je fais des films. Ca prend le détour de la fiction, parfois de la narration, de la peinture, de la musique, du rythme, de la danse. Je fais un film avec tout ce qui me tombe sous la main.
- Aujourd’hui, le cinéma fait-il sa révolution ?
Le cinéma est un objet trop vaste. Il faudrait voir les diverses cinématographies, par exemple ce qui se joue en Amérique du Sud. Je pense qu’il y a un regain, un nouvel intérêt y compris en Europe où ces questions là semblaient avoir été un peu perdues de vue. Je ne parle pas du cinéma militant qui a toujours existé mais je n’ai pas le projet d’en faire. Dans les débats strictement militants, Révolution Zendj n’a pas véritablement sa place parce qu’il ne peut pas servir d’outil de combat. Il n’est pas fait dans cette optique. Il me semble donc qu’il y a un frémissement même en Europe. Mais ce n’est pas le cinéma de lui-même, par lui-même, qui va s’inventer des objets. Je pense que c’est la société qui va les imposer au cinéma, et donc aux cinéastes. Il y a eu un temps où il y avait un questionnement politique qui a produit des films. Moi, si je fais Révolution Zendj, c’est parce que ça me semble comme imposé par des conditions historiques, géographiques, politiques, sociales. C’est lié à l’histoire de l’Algérie, du monde arabe, du monde méditerranéen. Quand les questions vont se poser dans la société, de manière accrue, plus tendue, en France, en Italie, peut-être que des cinéastes reviendront à un cinéma qui se posera des questions de cinéma et de politique.
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
(Africiné / Paris)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(*) Tariq Teguia, films et rencontres, du 6 au 15 mars 2015, au Centre Georges Pompidou à Paris. La programmation propose de découvrir tous les films de l’artiste algérien y compris Kech'mouvement ?, 1992, retrouvé et restauré pour la circonstance. Le cinéaste accompagne les séances en compagnie d’un invité, présente ses films et dialogue avec le public. Une rencontre autour de son travail prend place parmi les séances du cycle. Un film inédit, commandé par le Centre Pompidou et coproduit par la chaine Arte, Où en êtes-vous, Tariq Teguia ?, est réalisé par l’artiste lui-même et dévoilé durant les séances de ses courts- métrages. La rétrospective compte ainsi 8 films, répartis en 8 séances.
(**)Révolution Zendj a obtenu Le grand Prix Jeanine Bazin au festival Entrevues de Belfort 2013, le Prix Scribe pour le Cinéma à Paris, en 2013, le Prix Anno Uno au Festival international de cinéma et d’art de Trieste 2014. Il est distribué par la société Zendj où est impliqué Tariq Teguia, avec le soutien du Groupement National des Cinémas de Recherche.
Photo : Tariq Teguia, réalisateur algérien.
Crédit: DR
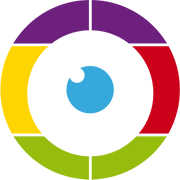 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images