Table-ronde « Diffusion des films du Sud » : Des salles, de la promotion et de la modernité !

Salle comble et débats passionnés, lors de la table-ronde organisée par l’OIF à Cannes le 18 mai 2013.
Voici le compte rendu intégral de cette table-ronde, animée par Youma Fall, avec cinq intervenants principaux : Djo Munga, Gaston Kaboré, Anne-Dominique Toussaint, Daniela Elstner et Yves Bigot (voir présentation de chaque intervenant dans notre article précédent).
Djo Munga (réalisateur du film « Viva Riva ») : « Viva Riva » a été distribué dans de nombreux pays occidentaux : Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, France, Allemagne, Belgique, Royaume Uni. Un véritable conte de fées ! Mais nous avions aussi le désir de sortir le film en Afrique et nous avons eu des accords sur dix-huit pays. À ce jour, le film a pu sortir effectivement dans quinze d’entre eux. Mais quand on y regarde bien, on s’aperçoit que la plupart sont des pays anglophones. Le circuit a commencé par l’Afrique du Sud, puis il y a eu le Lesotho, le Swaziland, la Namibie, le Zimbabwe, l’Ouganda, le Kenya. En revanche, du côté des pays francophones, c’est le trou noir. Il n’y a pas de salles de cinéma à Kinshasa mais c’est la même chose au Sénégal : pas de salles, pas de structures de diffusion. En RDC, je peux comprendre la situation car on a connu la dictature et la guerre mais dans les autres pays francophones qui sont plus avancés, cela a été une grande surprise pour moi de découvrir qu’il n’y avait pratiquement pas de salles de cinéma. Le résultat, c’est que la vraie grande diffusion du film en Afrique a été faite par Canal , il y a deux semaines.
Est-ce que l’on peut reconquérir le public africain par le biais des salles de cinéma ? Je n’y crois pas. Il y a trop de problèmes structurels, à commencer par les coupures d’électricité. Je crois plus aux nouvelles plateformes qui permettent la diffusion de la musique : internet, les réseaux de téléphonie mobile, etc. Ce qu’on a pu constater en RDC comme ailleurs en Afrique, c’est que les gens avaient de l’appétit pour le film. Mais cette demande n’est pas satisfaite. On n’a pas assez de films.
Anne-Dominique Toussaint (Les Films des Tournelles, France ; productrice des films de Nadine Labaki : « Caramel » et « Et maintenant, on va où ? ») : A propos de mon expérience avec Nadine Labaki, on peut parler aussi de conte de fées. A ce sujet, je voudrais souligner à quel point la France joue un rôle important grâce à la multiplicité de ses systèmes d’aide et aussi grâce à sa politique envers les cinémas du monde, ce qui fait, que, contrairement à beaucoup d’autres pays, on peut envisager facilement de travailler avec des cinéastes du Sud.
Ma rencontre avec Nadine Labaki s’est faite à l’occasion d’un voyage à Beyrouth où j’étais allée montrer le film « Respiro » que j’avais produit. Nadine est une jeune femme ravissante et talentueuse qui, à l’époque, faisait surtout des vidéo-clips. Elle avait une grande envie de cinéma mais ne savait pas par où commencer. Elle m’a parlé d’un projet, à propos de femmes et d’un salon de beauté. Elle m’a fait lire un premier synopsis de quinze pages, qui m’a ému. Je lui ai proposé de postuler à la Résidence du festival de Cannes (Cinéfondation), qui permet de passer six mois à Paris dans d’excellentes conditions de prise en charge, pour développer un scénario. Nadine a été sélectionnée et elle a pu travailler sur ce scénario, écrit en arabe. Sa présence à Paris nous a permis de mieux faire connaissance et j’ai décidé de produire son film. Je pensais trouver un partenaire de production au Liban mais cela n’a pas été possible, notamment parce que, là-bas, beaucoup de structures de production appartiennent à des réalisateurs/producteurs orientés vers leur propres projets, comme c’est le cas dans beaucoup de pays du Sud. J’ai alors créé une société, Les Films de Beyrouth, ce qui m’a permis d’entamer des recherches de financement dans les pays arabes.
Mais l’un des premiers soutiens que nous ayons décroché a été celui de l’Organisation internationale de la Francophonie. Au Liban, il n’y a pratiquement pas d’aides publiques. Nous avons tout de même pu mobiliser des fonds de télévisions du Moyen-Orient. En France, il y a plusieurs possibilités pour financer des films en langue étrangère : l’aide aux cinémas du monde, Arte, TV5Monde. Finalement, le film « Caramel » a été tourné en 2006. Je pense sincèrement qu’une productrice française avait de meilleures chances de faire aboutir un projet de film comme celui-là et de lui donner un potentiel international. La chose la plus importante qui soit arrivée au film a été sa sélection à Cannes. « Caramel » a été retenu par la Quinzaine des réalisateurs. A partir de là, les demandes des distributeurs se sont multipliées. A la fin du festival, on avait pratiquement vendu le film dans le monde entier. La sortie en France a été un très gros succès et, à l’arrivée, on a dépassé les deux millions d’entrées dans le monde. Dans ce conte de fées, il y a plusieurs parrains et marraines qui se sont penchés sur le berceau mais Cannes a été très important. Il faut que la politique française ne sacrifie jamais cet aspect-là de l’aide au cinéma.
Gaston Kaboré (cinéaste, directeur de l’Institut Imagine, Burkina Faso) : J’ai été très intéressé par l’expérience atypique de Djo Munga et par son opinion selon laquelle le combat pour les salles de cinéma est dépassé en Afrique. Mais, au Burkina Faso, on a une autre expérience et je crois qu’il faut allier toutes les formes de diffusion pour donner plus de chances à l’expression cinématographique africaine. Chez nous, le développement des outils de production numériques a amené des réalisateurs à faire des films à petit budget qui ont pu être exploités avec succès en salles. Le pionnier dans ce domaine a été Boubakar Diallo mais d’autres, par la suite, lui ont emboîté le pas. Il y a même des séries télévisées qui sont remontées en une heure trente pour passer dans les salles de cinéma. Et si ces salles continuent de vivre, c’est grâce aux spectateurs qui sont friands de ces films faits localement. En tête du Box-office au Burkina, on trouve toujours des productions nationales.
Quand il y a cette possibilité de voir des films de chez soi, avec des réalités que l’on connaît, le public est là. Dans ce contexte, une initiative importante est venue de Suisse. C’est Pierre Alain Meier qui est venu nous voir et nous a demandé ce qui pouvait être fait pour revitaliser le secteur. Cette demande a abouti à la création de l’Association des producteurs burkinabè pour le Fonds de soutien automatique Succès Cinéma du Burkina Faso. On a alors mis en place un système de comptabilisation des entrées permettant un partage des recettes selon des normes professionnelles. Grâce à cela, les recettes en salles sont connues et comptabilisées de façon fiable et contrôlable. L’opération a commencé il y a dix-huit mois et, grâce à elle, des salles de province sont en train de rouvrir. Je salue d’ailleurs la présence dans la salle de Bernie Goldblat, qui est en train de se battre pour faire renaître la salle Guimbi Ouattara à Bobo Dioulasso.
Parallèlement à ces initiatives, il y a un besoin vital de formation. C’est ce que nous faisons depuis dix ans avec l’Institut Imagine car il faut que les gens apprennent très bien leur métier. Enfin, même quand les films ont pu être faits et diffusés, il faut encore songer au patrimoine, à la sauvegarde des oeuvres. C’est pourquoi nous avons créé à Imagine un pôle « archives audiovisuelles », mis en place grâce à une coopération Sud-Sud avec le Centre Bophana créé par Rithy Panh au Cambodge et également grâce à l’expertise de l’INA. Je pense qu’il n’y a pas de recette universelle. Il faut trouver les réponses adéquates dans des lieux donnés pour que les choses se mettent en route. Il n’empêche que la formule du Fonds Succès cinéma peut être reproduite ailleurs, en tenant compte des réalités locales. Le Mali, la Côte d’Ivoire et le Sénégal se sont déjà montrés intéressés.
Daniela Elstner (directrice de Doc & Film International) : Pour moi, l’important, c’est le partage, car le cinéma est un art de partage. J’ai eu l’occasion de séjourner récemment à Dakar avec mes enfants et ils étaient très surpris de constater qu’il n’y avait pas de salles de cinéma. En Afrique, il y a une envie de cinéma mais les lieux n’existent pas toujours et, quoi qu’on dise, la salle reste le meilleur endroit pour montrer les films. On peut aussi travailler sur une articulation entre des festivals et des plateformes VOD. Je travaille également avec TV5 Monde sur beaucoup de mes films. Je propose des films dans toutes sortes de langues, de tous les continents. Le problème n’est pas l’origine des films mais l’accompagnement qu’il faut pouvoir faire.
Cannes est un lieu rêvé mais ça ne suffit pas toujours. Avec « Le repenti » de Merzak Allouache, présenté l’an dernier à Cannes on a eu une presse de rêve. Même Variety a écrit que le film allait se vendre sans problème aux Etats-Unis. Mais aujourd’hui, nous n’avons toujours pas de distributeur américain. Peut-être parce que je ne suis pas une bonne vendeuse... Mais aussi parce qu’il y a maintenant une peur de s’engager. Cannes ne suffit plus. Il faut accompagner un film pendant au minimum un an. Le fait de mettre le film sur une plateforme VOD ne suffit pas. Il faut beaucoup de promotion, toujours plus d’accompagnement. La vente est devenue plus complexe. J’essaie de diversifier. Toutes les idées que l’on peut mettre en commun seront bénéfiques pour les cinématographies qui sont en train de naître.
Yves Bigot (directeur général de TV5 Monde) : Je sors d’un déjeuner avec les organisateurs et les partenaires des Trophées francophones du cinéma, dont le ministre de la Culture du Sénégal et Yamina Benguigi. Cette manifestation aura lieu à Dakar et sera retransmise par la télévision sénégalaise et TV5 Monde. Avant la cérémonie elle-même, une centaine de films feront l’objet de projections publiques à Dakar, ce qui permettra de marquer la présence du cinéma francophone auprès du public et pas seulement auprès des professionnels. Il n’y aura pas que des films africains puisque l’ensemble de la Francophonie sera représenté. Au-delà de cet événement, l’action de TV5 Monde en faveur des cinémas du Sud se situe à plusieurs niveaux. Ce n’est pas sur le plan financier que notre intervention est la plus décisive.
Nous sommes surtout riches de notre réseau de diffusion. TV5 Monde est un très puissant diffuseur culturel avec neuf antennes qui font de nous un diffuseur mondial mais aussi panafricain. Nous permettons, par exemple aux films burkinabès qu’être vus en RDC, ou aux films maliens d’être vus au Gabon. Nous avons aussi une antenne Maghreb et une autre sur le Moyen-Orient. Mais on évite de ghettoïser les œuvres. Nos choix de films se fondent sur leur succès potentiel mais aussi sur notre libre-arbitre. On tient compte, évidemment, de l’accueil du public et pas seulement des œuvres que l’on préfère car, comme dit un proverbe sénégalais, « Ce n’est pas parce que tu n’aimes pas le lièvre que tu peux nier qu’il a de grandes oreilles. » Nous avons une volonté très affirmée de soutenir le cinéma et nous avons intérêt à avoir un maximum de films de qualité. Nos achats concernent toutes les formes de cinéma : longs-métrages, courts-métrages, sans oublier les séries télévisées, qui occupent une place importante. Nous sommes le premier diffuseur francophone du monde et le deuxième diffuseur au niveau international.
Youma Fall (directrice de la Diversité et du développement culturels à l’OIF) : Je salue la présence de Cheick Oumar Sissoko, qui vient d’être élu secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes. Pour revenir à TV5 Monde, on ne peut que saluer le lancement du nouveau magazine « Rendez-vous au maquis » mais on aimerait avoir un « maquis » de TV5 Monde consacré au cinéma du Sud.
Yves Bigot : Je peux déjà vous annoncer que la prochaine émission « Rendez-vous au maquis » aura pour invitée Aïssa Maïga.
Djo Munga : Je voudrais revenir sur la question des salles de cinéma en Afrique francophone. Bien sûr, en RDC, il y a des salles qui diffusent du porno. Mais quand je regarde la carte de l’Afrique, je vois des pays où il y a de vrais réseaux de salles et des gens avec qui on peut signer des contrats mais ces pays se trouvent en zone anglophone. Il ne faut pas se voiler la face. On doit conquérir le public mais si on dit que, pour cela, il faut absolument reconstruire de grandes salles, je n’y crois pas. C’est par les nouvelles plateformes qu’on va pouvoir toucher le public africain.
Boris Van Gils : La genèse du succès, pour moi, est liée aux sujets des films, à leur modernité. Le combat à mener ne se situe pas au niveau des moyens de diffusion mais sur ce qu’on a envie de raconter. Aux Etats-Unis, les gens n’ont pas abordé « Viva Riva » en disant « Ah, voilà un film africain ! ». Ils ont simplement vu une œuvre moderne.
Valérie Mouroux (Directrice du cinéma à l’Institut français) : Si on veut une audience internationale, il faut y penser dès le stade du projet de film. La Fabrique des cinémas du monde, qui est un atelier mené à Cannes par l’Institut français avec le soutien de l’OIF, permet à de jeunes réalisateurs de multiplier les rencontres. Je pense que la Francophonie est intéressante quand elle est ouverte sur les autres zones géographiques. Pour espérer une distribution internationale, il faut « penser international » dès le début. Tous les films ne sont pas faits pour aller à l’international.
Souad Houssein (spécialiste de programme chargée du cinéma à l’OIF) : L’histoire récente a prouvé qu’on est plus forts quand on est unis. C’est pourquoi on doit saluer une initiative comme celle des Trophées francophones. Il est important aussi que la télévision, qui entre dans des millions de foyers, contribue à mettre en valeur nos « stars ». Quel est le meilleur moyen pour cela ?Un magazine sur les films francophones du Sud. Quand je parle à mes enfants de films comme « Viva Riva » ou « La pirogue », leur réflexe est de me demander : « Qui en a parlé ? ». Il faut plus de promotion.
Thierry Michel (cinéaste, Belgique) : En matière de salles de cinéma, un pays a fait un effort énorme, c’est le Tchad, avec le Ciné Normandie à Ndjamena, qui a un projecteur DCP et une salle de 420 places mais il n’y a pas de public, sauf pour des retransmissions de matchs de football. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour le cinéma ? Contrairement à Djo Munga, je ne pense pas qu’internet puisse remplacer les salles. À Kinshasa, il est très difficile de télécharger un film, à cause des problèmes de débit et de coupures d’électricité. Les paramètres indispensables ne sont pas là. Reste la télévision. Mais une autre question se pose : quels films peuvent être diffusés en Afrique ? Avant que je ne sois expulsé de RDC à cause de mon film « L’affaire Chebeya », CFI a dit « Le film est trop polémique ». TV5 l’a acheté mais ne peut pas le diffuser. Parmi les obstacles à la diffusion en Afrique, il ne faut pas oublier celui-là : il y a un rapport de force quotidien entre les créateurs, les intellectuels et les pouvoirs en place.
Cheick Oumar Sissoko (cinéaste, secrétaire général de la FEPACI) : Nos films sont considérés, dans la mentalité courante en Europe et en Amérique, comme des films de seconde zone. Cannes reste la référence. C’est l’événement qui suscite la demande des distributeurs, depuis des années. Nous, à la FEPACI, nous nous préoccupons de la diffusion sur le continent africain. Elle est impossible si nous n’avons pas de salles. Le succès international qu’a connu Djo Munga est exceptionnel. Contrairement à lui, je pense que la question des salles de cinéma est à prendre au sérieux. En RDC, comme l’a dit Djo, il y a eu la guerre militaire mais les autres pays africains ont subi la guerre économique.
Il ne faut pas oublier que le FMI et la Banque mondiale ont imposé, à partir de 1979 la liquidation des entreprises publiques. Or, le plus souvent, les salles de cinéma appartenaient aux Etats. Il nous faut remonter la pente, notamment en formant des exploitants de salles. A Dakar, il y a un homme extraordinaire, Khalilou Ndiaye, qui continue à ramer à contre-courant en exploitant une salle située à la périphérie. Il faut rouvrir une salle de cinéma dans chaque capitale, puis susciter la création d’autres salles. Il n’y aura pas de cinéma sans salles.
Youma Fall : Je refuse de dire que les spectateurs ne peuvent pas payer leur place. C’est une question d’éducation culturelle du public.
Bernie Goldblat (cinéaste suisse, promoteur du projet de réouverture du Ciné Guimbi à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso) : Les grandes salles de cinéma de 500 ou 600 places, c’est fini. Comment faire pour attirer notre public ? Pour moi, ce n’est pas un problème de mettre du football. Le tout est d’attirer le public. Trois millions d’euros ont été investis pour le cinéma Le Normandie à Ndjamena mais le public ne vient pas. Comment l’attirer ? Si on veut rouvrir le Ciné Guimbi à Bobo-Dioulasso, c’est pour créer des vocations, que des jeunes développent l’envie d’être un jour ingénieur du son, parce qu’ils sont allés au cinéma. Il faudra faire venir les enfants des écoles, faire de l’éducation à l’image. Il y a plusieurs centaines de femmes qui vendent au marché situé derrière le ciné Guimbi. Comment attirer ces femmes ? C’est un problème très réel. Gaston Kaboré a grandi juste à côté de ce cinéma. Ce n’est sans doute pas étranger à son parcours.
Enrico Chiesa (promoteur du réseau Mobiciné et du portail VOD Africafilms.tv) : A Dakar, les choses sont en train de changer. Deux projets d’ouverture de complexes sont en train d’aboutir. Cela nous fera six salles. Actuellement, avec Mobiciné, nous sommes le seul exploitant qui fasse remonter des recettes vers les producteurs. Nous avons fait 100 000 entrées en milieu scolaire. Mais le public s’est habitué au sponsoring et à la gratuité. Beaucoup de jeunes n’hésitent pas à investir dans les téléphones portables ou les tablettes numériques mais ont du mal à mettre 300 F CFA dans une séance de cinéma. Nous rencontrons la même difficulté pour diffuser en VOD, alors qu’au même moment TV5Monde Afrique diffuse ses programmes gratuitement.
Marjorie Vella (responsables des achats de films à TV5 Monde) : Il ne faut pas confondre les choses. Il y a, d’une part, la web TV qui est une télévision de rattrapage, disponible gratuitement mais avec des droits payés aux producteurs. TV5Monde a aussi, par ailleurs une offre VOD payante qui s’appelle TV5Monde cinéma. Pour revenir au débat sur la diffusion des films, je n’aime pas parler de cinéma du Sud, comme on parlerait de cinéma belge ou d’ailleurs. Je préfère parler de cinéma, tout simplement. Ce qui est différent au Sud, c’est que le réalisateur est souvent obligé d’être aussi producteur, distributeur, etc. Or, chacun doit revenir à son vrai métier. C’est dans ce sens que les choses doivent se développer. Au Québec, sans la SODEC, le cinéma québécois n’aurait jamais pu atteindre la part de marché qu’il a aujourd’hui. La situation des cinémas du Sud n’est pas un cas particulier.
Youma Fall : D’accord sur l’idée de se concentrer sur son métier. J’ai l’habitude de dire que chacun doit agir là où il est le moins mauvais.
Jean Patoudem (cinéaste, producteur et distributeur, Cameroun/France) : Je voudrais dire, à propos des manières d’attirer le public, que le public africain s’est tourné vers d’autres cinémas et que, contrairement à ce que l’on dit, il est très éduqué. Il faut que le cinéma africain lui propose des films qui soient à la hauteur. Quant à la diffusion sur d’autres marchés, voici mon expérience en Chine. J’y suis allé en 2010 pour chercher un décor pour mon film « L’enfant de rêve ». Et j’y suis retourné parce que le marché est attrayant et que j’ai été bien accueilli. En 2011, on m’a offert un stand au marché du film de Pékin. J’ai constaté que les Chinois ne voyaient les Africains que comme des joueurs de football ou des coureurs de fond. J’ai eu l’occasion de présenter « Le mec idéal » qui est allé dans des festivals. Cette année, je suis retourné à Pékin et j’ai eu des échanges prometteurs avec Media Services Distribution qui fournit des films aux compagnies aériennes.
J’essaie de faire entrer des films africains sur ce secteur : par exemple « Le mec idéal » et «Inspecteur Sori ». J’ai une deuxième piste avec Star Time, qui lance un bouquet concurrent de Canal Sat en Afrique. Ils veulent créer une chaîne de cinéma africain pour l’Afrique. Quant au marché chinois, il faut comprendre une chose : les Chinois travaillent beaucoup et, quand ils s’asseoient, ils veulent se divertir. Il y a là-bas trois gros distributeurs pour la VOD et les smartphones, chacun ayant 5 à 6 millions de clients. Pour prospecter sur ces marchés, il faut commencer par sous-titrer en mandarin. Nous l’avons fait pour « Le mec idéal » et nous sommes en train de le faire pour « Roger Milla ».
Rahmatou Keita (cinéaste, Niger) : Il ne faut pas oublier que le cinéma, c’est de l’art. Il n’y a pas de recette. Chacun a son imaginaire. C’est cela qui fait la richesse du monde et de l’Afrique. Etre moderne, pour moi, c’est faire des films dans des cités bruyantes mais c’est aussi aller dans des villages. Il n’y a pas que le bitume qui soit moderne ! On travaille actuellement pour qu’il y ait un fonds panafricain pour le cinéma. On doit récupérer notre image qui nous échappe. C’est pour cela que le public ne vient plus : parce que notre image ne nous appartient plus. Il y a un préjugé sur nos films à l’étranger, ce qui les empêche de trouver leur public. Mais il ne faut pas oublier qu’il y a des films magnifiques comme « La porte du paradis » qui n’ont pas marché à leur sortie et qui ont connu le succès vingt ans après.
Youma Fall : Il est temps de montrer l’Afrique telle qu’elle est et telle qu’elle doit être.
Alassane Sy (comédien, Sénégal, Restless City réalisé par Andrew Dosunmu) : On a tout ce qu’il faut pour bien faire mais l’important est de le faire à notre manière. Que notre cinéma soit fait par les Africains.
Transcription : Pierre Barrot
Djo Munga (réalisateur du film « Viva Riva ») : « Viva Riva » a été distribué dans de nombreux pays occidentaux : Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, France, Allemagne, Belgique, Royaume Uni. Un véritable conte de fées ! Mais nous avions aussi le désir de sortir le film en Afrique et nous avons eu des accords sur dix-huit pays. À ce jour, le film a pu sortir effectivement dans quinze d’entre eux. Mais quand on y regarde bien, on s’aperçoit que la plupart sont des pays anglophones. Le circuit a commencé par l’Afrique du Sud, puis il y a eu le Lesotho, le Swaziland, la Namibie, le Zimbabwe, l’Ouganda, le Kenya. En revanche, du côté des pays francophones, c’est le trou noir. Il n’y a pas de salles de cinéma à Kinshasa mais c’est la même chose au Sénégal : pas de salles, pas de structures de diffusion. En RDC, je peux comprendre la situation car on a connu la dictature et la guerre mais dans les autres pays francophones qui sont plus avancés, cela a été une grande surprise pour moi de découvrir qu’il n’y avait pratiquement pas de salles de cinéma. Le résultat, c’est que la vraie grande diffusion du film en Afrique a été faite par Canal , il y a deux semaines.
Est-ce que l’on peut reconquérir le public africain par le biais des salles de cinéma ? Je n’y crois pas. Il y a trop de problèmes structurels, à commencer par les coupures d’électricité. Je crois plus aux nouvelles plateformes qui permettent la diffusion de la musique : internet, les réseaux de téléphonie mobile, etc. Ce qu’on a pu constater en RDC comme ailleurs en Afrique, c’est que les gens avaient de l’appétit pour le film. Mais cette demande n’est pas satisfaite. On n’a pas assez de films.
Anne-Dominique Toussaint (Les Films des Tournelles, France ; productrice des films de Nadine Labaki : « Caramel » et « Et maintenant, on va où ? ») : A propos de mon expérience avec Nadine Labaki, on peut parler aussi de conte de fées. A ce sujet, je voudrais souligner à quel point la France joue un rôle important grâce à la multiplicité de ses systèmes d’aide et aussi grâce à sa politique envers les cinémas du monde, ce qui fait, que, contrairement à beaucoup d’autres pays, on peut envisager facilement de travailler avec des cinéastes du Sud.
Ma rencontre avec Nadine Labaki s’est faite à l’occasion d’un voyage à Beyrouth où j’étais allée montrer le film « Respiro » que j’avais produit. Nadine est une jeune femme ravissante et talentueuse qui, à l’époque, faisait surtout des vidéo-clips. Elle avait une grande envie de cinéma mais ne savait pas par où commencer. Elle m’a parlé d’un projet, à propos de femmes et d’un salon de beauté. Elle m’a fait lire un premier synopsis de quinze pages, qui m’a ému. Je lui ai proposé de postuler à la Résidence du festival de Cannes (Cinéfondation), qui permet de passer six mois à Paris dans d’excellentes conditions de prise en charge, pour développer un scénario. Nadine a été sélectionnée et elle a pu travailler sur ce scénario, écrit en arabe. Sa présence à Paris nous a permis de mieux faire connaissance et j’ai décidé de produire son film. Je pensais trouver un partenaire de production au Liban mais cela n’a pas été possible, notamment parce que, là-bas, beaucoup de structures de production appartiennent à des réalisateurs/producteurs orientés vers leur propres projets, comme c’est le cas dans beaucoup de pays du Sud. J’ai alors créé une société, Les Films de Beyrouth, ce qui m’a permis d’entamer des recherches de financement dans les pays arabes.
Mais l’un des premiers soutiens que nous ayons décroché a été celui de l’Organisation internationale de la Francophonie. Au Liban, il n’y a pratiquement pas d’aides publiques. Nous avons tout de même pu mobiliser des fonds de télévisions du Moyen-Orient. En France, il y a plusieurs possibilités pour financer des films en langue étrangère : l’aide aux cinémas du monde, Arte, TV5Monde. Finalement, le film « Caramel » a été tourné en 2006. Je pense sincèrement qu’une productrice française avait de meilleures chances de faire aboutir un projet de film comme celui-là et de lui donner un potentiel international. La chose la plus importante qui soit arrivée au film a été sa sélection à Cannes. « Caramel » a été retenu par la Quinzaine des réalisateurs. A partir de là, les demandes des distributeurs se sont multipliées. A la fin du festival, on avait pratiquement vendu le film dans le monde entier. La sortie en France a été un très gros succès et, à l’arrivée, on a dépassé les deux millions d’entrées dans le monde. Dans ce conte de fées, il y a plusieurs parrains et marraines qui se sont penchés sur le berceau mais Cannes a été très important. Il faut que la politique française ne sacrifie jamais cet aspect-là de l’aide au cinéma.
Gaston Kaboré (cinéaste, directeur de l’Institut Imagine, Burkina Faso) : J’ai été très intéressé par l’expérience atypique de Djo Munga et par son opinion selon laquelle le combat pour les salles de cinéma est dépassé en Afrique. Mais, au Burkina Faso, on a une autre expérience et je crois qu’il faut allier toutes les formes de diffusion pour donner plus de chances à l’expression cinématographique africaine. Chez nous, le développement des outils de production numériques a amené des réalisateurs à faire des films à petit budget qui ont pu être exploités avec succès en salles. Le pionnier dans ce domaine a été Boubakar Diallo mais d’autres, par la suite, lui ont emboîté le pas. Il y a même des séries télévisées qui sont remontées en une heure trente pour passer dans les salles de cinéma. Et si ces salles continuent de vivre, c’est grâce aux spectateurs qui sont friands de ces films faits localement. En tête du Box-office au Burkina, on trouve toujours des productions nationales.
Quand il y a cette possibilité de voir des films de chez soi, avec des réalités que l’on connaît, le public est là. Dans ce contexte, une initiative importante est venue de Suisse. C’est Pierre Alain Meier qui est venu nous voir et nous a demandé ce qui pouvait être fait pour revitaliser le secteur. Cette demande a abouti à la création de l’Association des producteurs burkinabè pour le Fonds de soutien automatique Succès Cinéma du Burkina Faso. On a alors mis en place un système de comptabilisation des entrées permettant un partage des recettes selon des normes professionnelles. Grâce à cela, les recettes en salles sont connues et comptabilisées de façon fiable et contrôlable. L’opération a commencé il y a dix-huit mois et, grâce à elle, des salles de province sont en train de rouvrir. Je salue d’ailleurs la présence dans la salle de Bernie Goldblat, qui est en train de se battre pour faire renaître la salle Guimbi Ouattara à Bobo Dioulasso.
Parallèlement à ces initiatives, il y a un besoin vital de formation. C’est ce que nous faisons depuis dix ans avec l’Institut Imagine car il faut que les gens apprennent très bien leur métier. Enfin, même quand les films ont pu être faits et diffusés, il faut encore songer au patrimoine, à la sauvegarde des oeuvres. C’est pourquoi nous avons créé à Imagine un pôle « archives audiovisuelles », mis en place grâce à une coopération Sud-Sud avec le Centre Bophana créé par Rithy Panh au Cambodge et également grâce à l’expertise de l’INA. Je pense qu’il n’y a pas de recette universelle. Il faut trouver les réponses adéquates dans des lieux donnés pour que les choses se mettent en route. Il n’empêche que la formule du Fonds Succès cinéma peut être reproduite ailleurs, en tenant compte des réalités locales. Le Mali, la Côte d’Ivoire et le Sénégal se sont déjà montrés intéressés.
Daniela Elstner (directrice de Doc & Film International) : Pour moi, l’important, c’est le partage, car le cinéma est un art de partage. J’ai eu l’occasion de séjourner récemment à Dakar avec mes enfants et ils étaient très surpris de constater qu’il n’y avait pas de salles de cinéma. En Afrique, il y a une envie de cinéma mais les lieux n’existent pas toujours et, quoi qu’on dise, la salle reste le meilleur endroit pour montrer les films. On peut aussi travailler sur une articulation entre des festivals et des plateformes VOD. Je travaille également avec TV5 Monde sur beaucoup de mes films. Je propose des films dans toutes sortes de langues, de tous les continents. Le problème n’est pas l’origine des films mais l’accompagnement qu’il faut pouvoir faire.
Cannes est un lieu rêvé mais ça ne suffit pas toujours. Avec « Le repenti » de Merzak Allouache, présenté l’an dernier à Cannes on a eu une presse de rêve. Même Variety a écrit que le film allait se vendre sans problème aux Etats-Unis. Mais aujourd’hui, nous n’avons toujours pas de distributeur américain. Peut-être parce que je ne suis pas une bonne vendeuse... Mais aussi parce qu’il y a maintenant une peur de s’engager. Cannes ne suffit plus. Il faut accompagner un film pendant au minimum un an. Le fait de mettre le film sur une plateforme VOD ne suffit pas. Il faut beaucoup de promotion, toujours plus d’accompagnement. La vente est devenue plus complexe. J’essaie de diversifier. Toutes les idées que l’on peut mettre en commun seront bénéfiques pour les cinématographies qui sont en train de naître.
Yves Bigot (directeur général de TV5 Monde) : Je sors d’un déjeuner avec les organisateurs et les partenaires des Trophées francophones du cinéma, dont le ministre de la Culture du Sénégal et Yamina Benguigi. Cette manifestation aura lieu à Dakar et sera retransmise par la télévision sénégalaise et TV5 Monde. Avant la cérémonie elle-même, une centaine de films feront l’objet de projections publiques à Dakar, ce qui permettra de marquer la présence du cinéma francophone auprès du public et pas seulement auprès des professionnels. Il n’y aura pas que des films africains puisque l’ensemble de la Francophonie sera représenté. Au-delà de cet événement, l’action de TV5 Monde en faveur des cinémas du Sud se situe à plusieurs niveaux. Ce n’est pas sur le plan financier que notre intervention est la plus décisive.
Nous sommes surtout riches de notre réseau de diffusion. TV5 Monde est un très puissant diffuseur culturel avec neuf antennes qui font de nous un diffuseur mondial mais aussi panafricain. Nous permettons, par exemple aux films burkinabès qu’être vus en RDC, ou aux films maliens d’être vus au Gabon. Nous avons aussi une antenne Maghreb et une autre sur le Moyen-Orient. Mais on évite de ghettoïser les œuvres. Nos choix de films se fondent sur leur succès potentiel mais aussi sur notre libre-arbitre. On tient compte, évidemment, de l’accueil du public et pas seulement des œuvres que l’on préfère car, comme dit un proverbe sénégalais, « Ce n’est pas parce que tu n’aimes pas le lièvre que tu peux nier qu’il a de grandes oreilles. » Nous avons une volonté très affirmée de soutenir le cinéma et nous avons intérêt à avoir un maximum de films de qualité. Nos achats concernent toutes les formes de cinéma : longs-métrages, courts-métrages, sans oublier les séries télévisées, qui occupent une place importante. Nous sommes le premier diffuseur francophone du monde et le deuxième diffuseur au niveau international.
Youma Fall (directrice de la Diversité et du développement culturels à l’OIF) : Je salue la présence de Cheick Oumar Sissoko, qui vient d’être élu secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes. Pour revenir à TV5 Monde, on ne peut que saluer le lancement du nouveau magazine « Rendez-vous au maquis » mais on aimerait avoir un « maquis » de TV5 Monde consacré au cinéma du Sud.
Yves Bigot : Je peux déjà vous annoncer que la prochaine émission « Rendez-vous au maquis » aura pour invitée Aïssa Maïga.
Djo Munga : Je voudrais revenir sur la question des salles de cinéma en Afrique francophone. Bien sûr, en RDC, il y a des salles qui diffusent du porno. Mais quand je regarde la carte de l’Afrique, je vois des pays où il y a de vrais réseaux de salles et des gens avec qui on peut signer des contrats mais ces pays se trouvent en zone anglophone. Il ne faut pas se voiler la face. On doit conquérir le public mais si on dit que, pour cela, il faut absolument reconstruire de grandes salles, je n’y crois pas. C’est par les nouvelles plateformes qu’on va pouvoir toucher le public africain.
Boris Van Gils : La genèse du succès, pour moi, est liée aux sujets des films, à leur modernité. Le combat à mener ne se situe pas au niveau des moyens de diffusion mais sur ce qu’on a envie de raconter. Aux Etats-Unis, les gens n’ont pas abordé « Viva Riva » en disant « Ah, voilà un film africain ! ». Ils ont simplement vu une œuvre moderne.
Valérie Mouroux (Directrice du cinéma à l’Institut français) : Si on veut une audience internationale, il faut y penser dès le stade du projet de film. La Fabrique des cinémas du monde, qui est un atelier mené à Cannes par l’Institut français avec le soutien de l’OIF, permet à de jeunes réalisateurs de multiplier les rencontres. Je pense que la Francophonie est intéressante quand elle est ouverte sur les autres zones géographiques. Pour espérer une distribution internationale, il faut « penser international » dès le début. Tous les films ne sont pas faits pour aller à l’international.
Souad Houssein (spécialiste de programme chargée du cinéma à l’OIF) : L’histoire récente a prouvé qu’on est plus forts quand on est unis. C’est pourquoi on doit saluer une initiative comme celle des Trophées francophones. Il est important aussi que la télévision, qui entre dans des millions de foyers, contribue à mettre en valeur nos « stars ». Quel est le meilleur moyen pour cela ?Un magazine sur les films francophones du Sud. Quand je parle à mes enfants de films comme « Viva Riva » ou « La pirogue », leur réflexe est de me demander : « Qui en a parlé ? ». Il faut plus de promotion.
Thierry Michel (cinéaste, Belgique) : En matière de salles de cinéma, un pays a fait un effort énorme, c’est le Tchad, avec le Ciné Normandie à Ndjamena, qui a un projecteur DCP et une salle de 420 places mais il n’y a pas de public, sauf pour des retransmissions de matchs de football. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour le cinéma ? Contrairement à Djo Munga, je ne pense pas qu’internet puisse remplacer les salles. À Kinshasa, il est très difficile de télécharger un film, à cause des problèmes de débit et de coupures d’électricité. Les paramètres indispensables ne sont pas là. Reste la télévision. Mais une autre question se pose : quels films peuvent être diffusés en Afrique ? Avant que je ne sois expulsé de RDC à cause de mon film « L’affaire Chebeya », CFI a dit « Le film est trop polémique ». TV5 l’a acheté mais ne peut pas le diffuser. Parmi les obstacles à la diffusion en Afrique, il ne faut pas oublier celui-là : il y a un rapport de force quotidien entre les créateurs, les intellectuels et les pouvoirs en place.
Cheick Oumar Sissoko (cinéaste, secrétaire général de la FEPACI) : Nos films sont considérés, dans la mentalité courante en Europe et en Amérique, comme des films de seconde zone. Cannes reste la référence. C’est l’événement qui suscite la demande des distributeurs, depuis des années. Nous, à la FEPACI, nous nous préoccupons de la diffusion sur le continent africain. Elle est impossible si nous n’avons pas de salles. Le succès international qu’a connu Djo Munga est exceptionnel. Contrairement à lui, je pense que la question des salles de cinéma est à prendre au sérieux. En RDC, comme l’a dit Djo, il y a eu la guerre militaire mais les autres pays africains ont subi la guerre économique.
Il ne faut pas oublier que le FMI et la Banque mondiale ont imposé, à partir de 1979 la liquidation des entreprises publiques. Or, le plus souvent, les salles de cinéma appartenaient aux Etats. Il nous faut remonter la pente, notamment en formant des exploitants de salles. A Dakar, il y a un homme extraordinaire, Khalilou Ndiaye, qui continue à ramer à contre-courant en exploitant une salle située à la périphérie. Il faut rouvrir une salle de cinéma dans chaque capitale, puis susciter la création d’autres salles. Il n’y aura pas de cinéma sans salles.
Youma Fall : Je refuse de dire que les spectateurs ne peuvent pas payer leur place. C’est une question d’éducation culturelle du public.
Bernie Goldblat (cinéaste suisse, promoteur du projet de réouverture du Ciné Guimbi à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso) : Les grandes salles de cinéma de 500 ou 600 places, c’est fini. Comment faire pour attirer notre public ? Pour moi, ce n’est pas un problème de mettre du football. Le tout est d’attirer le public. Trois millions d’euros ont été investis pour le cinéma Le Normandie à Ndjamena mais le public ne vient pas. Comment l’attirer ? Si on veut rouvrir le Ciné Guimbi à Bobo-Dioulasso, c’est pour créer des vocations, que des jeunes développent l’envie d’être un jour ingénieur du son, parce qu’ils sont allés au cinéma. Il faudra faire venir les enfants des écoles, faire de l’éducation à l’image. Il y a plusieurs centaines de femmes qui vendent au marché situé derrière le ciné Guimbi. Comment attirer ces femmes ? C’est un problème très réel. Gaston Kaboré a grandi juste à côté de ce cinéma. Ce n’est sans doute pas étranger à son parcours.
Enrico Chiesa (promoteur du réseau Mobiciné et du portail VOD Africafilms.tv) : A Dakar, les choses sont en train de changer. Deux projets d’ouverture de complexes sont en train d’aboutir. Cela nous fera six salles. Actuellement, avec Mobiciné, nous sommes le seul exploitant qui fasse remonter des recettes vers les producteurs. Nous avons fait 100 000 entrées en milieu scolaire. Mais le public s’est habitué au sponsoring et à la gratuité. Beaucoup de jeunes n’hésitent pas à investir dans les téléphones portables ou les tablettes numériques mais ont du mal à mettre 300 F CFA dans une séance de cinéma. Nous rencontrons la même difficulté pour diffuser en VOD, alors qu’au même moment TV5Monde Afrique diffuse ses programmes gratuitement.
Marjorie Vella (responsables des achats de films à TV5 Monde) : Il ne faut pas confondre les choses. Il y a, d’une part, la web TV qui est une télévision de rattrapage, disponible gratuitement mais avec des droits payés aux producteurs. TV5Monde a aussi, par ailleurs une offre VOD payante qui s’appelle TV5Monde cinéma. Pour revenir au débat sur la diffusion des films, je n’aime pas parler de cinéma du Sud, comme on parlerait de cinéma belge ou d’ailleurs. Je préfère parler de cinéma, tout simplement. Ce qui est différent au Sud, c’est que le réalisateur est souvent obligé d’être aussi producteur, distributeur, etc. Or, chacun doit revenir à son vrai métier. C’est dans ce sens que les choses doivent se développer. Au Québec, sans la SODEC, le cinéma québécois n’aurait jamais pu atteindre la part de marché qu’il a aujourd’hui. La situation des cinémas du Sud n’est pas un cas particulier.
Youma Fall : D’accord sur l’idée de se concentrer sur son métier. J’ai l’habitude de dire que chacun doit agir là où il est le moins mauvais.
Jean Patoudem (cinéaste, producteur et distributeur, Cameroun/France) : Je voudrais dire, à propos des manières d’attirer le public, que le public africain s’est tourné vers d’autres cinémas et que, contrairement à ce que l’on dit, il est très éduqué. Il faut que le cinéma africain lui propose des films qui soient à la hauteur. Quant à la diffusion sur d’autres marchés, voici mon expérience en Chine. J’y suis allé en 2010 pour chercher un décor pour mon film « L’enfant de rêve ». Et j’y suis retourné parce que le marché est attrayant et que j’ai été bien accueilli. En 2011, on m’a offert un stand au marché du film de Pékin. J’ai constaté que les Chinois ne voyaient les Africains que comme des joueurs de football ou des coureurs de fond. J’ai eu l’occasion de présenter « Le mec idéal » qui est allé dans des festivals. Cette année, je suis retourné à Pékin et j’ai eu des échanges prometteurs avec Media Services Distribution qui fournit des films aux compagnies aériennes.
J’essaie de faire entrer des films africains sur ce secteur : par exemple « Le mec idéal » et «Inspecteur Sori ». J’ai une deuxième piste avec Star Time, qui lance un bouquet concurrent de Canal Sat en Afrique. Ils veulent créer une chaîne de cinéma africain pour l’Afrique. Quant au marché chinois, il faut comprendre une chose : les Chinois travaillent beaucoup et, quand ils s’asseoient, ils veulent se divertir. Il y a là-bas trois gros distributeurs pour la VOD et les smartphones, chacun ayant 5 à 6 millions de clients. Pour prospecter sur ces marchés, il faut commencer par sous-titrer en mandarin. Nous l’avons fait pour « Le mec idéal » et nous sommes en train de le faire pour « Roger Milla ».
Rahmatou Keita (cinéaste, Niger) : Il ne faut pas oublier que le cinéma, c’est de l’art. Il n’y a pas de recette. Chacun a son imaginaire. C’est cela qui fait la richesse du monde et de l’Afrique. Etre moderne, pour moi, c’est faire des films dans des cités bruyantes mais c’est aussi aller dans des villages. Il n’y a pas que le bitume qui soit moderne ! On travaille actuellement pour qu’il y ait un fonds panafricain pour le cinéma. On doit récupérer notre image qui nous échappe. C’est pour cela que le public ne vient plus : parce que notre image ne nous appartient plus. Il y a un préjugé sur nos films à l’étranger, ce qui les empêche de trouver leur public. Mais il ne faut pas oublier qu’il y a des films magnifiques comme « La porte du paradis » qui n’ont pas marché à leur sortie et qui ont connu le succès vingt ans après.
Youma Fall : Il est temps de montrer l’Afrique telle qu’elle est et telle qu’elle doit être.
Alassane Sy (comédien, Sénégal, Restless City réalisé par Andrew Dosunmu) : On a tout ce qu’il faut pour bien faire mais l’important est de le faire à notre manière. Que notre cinéma soit fait par les Africains.
Transcription : Pierre Barrot
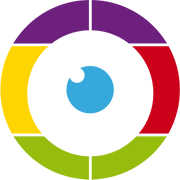 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images