Souad Houssein et l’avenir du cinéma africain

Entretien avec la responsable cinéma de l’OIF publié par le site djiboutien human village.
Les enjeux du cinéma africain aujourd’hui
par Kenza Mohamed, août 2021 (Human Village 42).
Souad Houssein est responsable du programme cinéma au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) depuis 1999, où elle acquière une solide expérience en accompagnant trente sept pays francophones du Sud dans le développement de leur cinématographie. En 2010, elle initie un projet de Fonds panafricain d’aide au cinéma et à l’audiovisuel pour pallier à la baisse des ressources dédiées au cinéma africain, contribuer à diversifier les sources de financement et autonomiser la création cinématographique. En plus des partenariats francophones existants – FESPACO (Burkina Faso), le Festival international du film francophone (FIFF) Namur (Belgique), les journées cinématographiques de Carthage (JCC) (Tunisie), Vues d’Afrique (Québec-Canada) –, elle a établi des collaborations avec des structures basées dans des pays non francophones tels que le Durban Film Festival en Afrique du Sud, le Dubai International Film festival dans les Émirats arabes unis, le Festival de Venise en Italie et l’African Film Festival de New York. Elle a aussi milité en faveur d’un outil dédié spécifiquement à l’histoire et la littérature du continent et un autre dédié aux femmes cinéastes.
Dans le milieu des professionnels africains, elle incarne la figure d’une militante qui poursuit, à sa manière, le combat de réappropriation de l’image que les grands noms du cinéma africain tels que Sembene Ousmane (cinéaste et écrivain sénégalais) et Tahar Chériaa (initiateur de nombreuses structures du cinéma panafricain de Tunisie) avaient engagé. A la suite de la présentation au Festival international de Cannes du film du réalisateur somalien Khadar Ahmed, La femme du fossoyeur, entièrement tourné à Djibouti, nous avons demandé à Souad Houssein de partager avec nos lecteurs son expérience et son décryptage du cinéma africain.
Comment avez-vous été amenée à travailler sur le cinéma africain, qui n’est pas encore suffisamment connu dans beaucoup de pays du continent, et encore moins à Djibouti ?
J’ai été exposé au cinéma dès mon jeune âge. Pendant l’absence de mon père, qui était marin, ma mère nous emmenait le mercredi au cinéma, à Marseille où j’ai grandi, voir des films égyptiens et indiens en guise de garderie. Ma passion du cinéma a dû commencer de manière subliminale avec ces séances. Elle s’est renforcée avec la télévision, notamment le Ciné-club que nous regardions en famille tous les dimanches soir, avec le débat qui suivait le film. Mon défunt frère aîné Saad, qui fut réalisateur à la RTD, était le plus passionné. Lorsque j’étais adolescente, toutes nos discussions portaient sur le cinéma après le Ciné-club du dimanche. Il était devenu un véritable critique de cinéma et m’en expliquait les techniques : les trucages, les bruitages, les doublures. Il m’a donné mes premiers cours de cinéma, en somme.
C’est paradoxalement à Djibouti, dans mon pays natal, que j’ai découvert le cinéma africain en 1986. C’était à l’occasion du premier Festival de cinéma africain organisé dans le pays. Ce fut un véritable coup de foudre pour ce cinéma que je ne connaissais pas. J’ai découvert un cinéma de combat qui me montra la puissance de l’image pour dire des choses importantes sur nos sociétés. Je me souviens notamment du film du sénégalais Sembene Ousmane, La Noire de…, qui raconte l’histoire d’une jeune fille africaine emmenée en France pour travailler comme domestique dans une famille. Le film montre comment elle est maltraitée, présentée comme un trophée exotique lors des diners et surtout comment elle supporte avec une grande dignité la grossièreté du racisme et des préjugés avant de se suicider. La manière sobre et poignante dont ce drame humain était relaté par le réalisateur m’a tout de suite fait comprendre l’importance du cinéma africain.
J’ai eu aussi la grande chance d’avoir discuté, à l’occasion de ce festival de Djibouti, avec le tunisien Tahar Cheriaa, fondateur des Journées cinématographiques de Carthage, le plus ancien festival du continent africain, créé en 1966. A l’époque, Tahar Cheriaa dirigeait le département cinéma de l’ACCT – Agence de coopération culturelle et technique, l’ancêtre de l’OIF, et le destin a voulu que je me retrouve une quinzaine d’années plus tard à travailler dans le programme cinéma qu’il avait créé et à poursuivre en quelque sorte son combat pour la réappropriation de notre image… Quand l’occasion s’est présentée à l’OIF, j’ai donc tout naturellement choisi de travailler dans l’aide au cinéma africain car il abordait des problématiques lourdes de nos sociétés post coloniales qui cherchaient leur voie entre la nostalgie du passé et les mirages de la modernité...
Vous avez accompagné plusieurs films qui ont eu un grand succès. Comme le cinéma demande un investissement financier important, est-il possible d’anticiper si un film aura accueil positif et sera rentabilisé ?
Pour répondre à votre question, je dois dire qu’il n’est pas facile du tout de connaitre en avance l’accueil ou le succès qu’aurait un film. Il y trop de paramètres en jeu pour le déterminer. C’est pourquoi l’investissement sur un film est toujours un pari, comme c’est le cas pour la plupart des œuvres artistiques. On peut y gagner beaucoup comme on peut perdre sa mise. Cependant, un film a plusieurs vies. S’il n’est pas un succès immédiat à sa sortie il peut avoir une autre vie dans la diffusion sur des télévisions ou sur des plateformes.
Quel a été, selon vous, l’âge d’or du cinéma africain ?
Il faut tout d’abord rappeler que le cinéma africain est relativement jeune (on situe sa naissance vers 1955) comparé aux cinématographies d’autres régions du monde. Ensuite, il conviendrait de parler plutôt « des cinémas d’Afrique », car il y a une grande diversité entre les différentes zones linguistiques et géographiques du continent. Le cinéma africain est encore dans une phase de croissance et de développement et n’a pas dit son dernier mot. Sans oublier les nouvelles générations qui ont démontré leur talent ces dernières années, je considère que la période juste après les indépendances a été un grand moment d’effervescence créative. Cette période fut marquée par une remarquable dynamique d’authenticité et de créativité. Ce fut un moment de grande mobilisation intellectuelle et artistique où le cinéma a été utilisé comme outil de conscientisation des peuples, d’émancipation et d’affirmation des identités nationales. Les cinéastes de cette époque étaient surtout des créateurs et créatrices qui avaient acquis des expériences diverses dans d’autres domaines et qui ont choisi le cinéma comme un moyen efficace pour faire passer des messages forts à leurs peuples. Malgré les contraintes techniques, financières et parfois politiques, ils et elles ont su imprimer un style, un souffle au cinéma africain et même au-delà au cinéma mondial. Cette période d’effervescence aussi bien artistique que politique est considérée comme l’âge d’or du cinéma africain. Les fondateurs de ce cinéma, tels que Sembene Ousmane (Sénégal), Med Hondo (Mauritanie), Henri Duparc (Côte d’Ivoire), Gaston Kaboré (Burkina Faso), Férid Boughedir (Tunisie) Raoul Peck (Haiti) et tant d’autres, continuent d’inspirer les différentes générations de cinéastes africains. C’est la période où des films devenus cultes comme Touki Bouki de Djibril Diop Mambeti ont été produits. Ces films figurent aujourd’hui parmi le patrimoine cinématographique africain que la Fondation du Film créée par le cinéaste américain Martin Scorsese a choisi de restaurer.
Pouvez-vous nous parler du projet de Fonds panafricain du cinéma et de l’audiovisuel que vous aviez initié en 2010 pour renforcer le financement des films africains ?
L’idée de lancer un Fonds panafricain dédié au cinéma et à l’audiovisuel répondait à la nécessité de pallier à la fragilité économique du cinéma africain. Le projet aspirait à répondre notamment aux idéaux portés par les pères fondateurs du panafricanisme cinématographique qui avaient créé la Fédération panafricaine des cinéastes (FEPACI) et les grand rendez-vous du cinéma africain tels que les Journées cinématographiques (JCC), le FESPACO (Burkina Faso). C’était une ambition qui remontait à 1969, année où la première recommandation sur la nécessité de mettre en place un fonds panafricain pour le cinéma africain a été adoptée par l’Organisation de l’unité africaine (OUA) lors du Festival panafricain des arts d’Alger. Elle a fait l’objet par la suite de nombreuses recommandations de l’Union africaine.
Le projet consistait à mettre en place un instrument pérenne, fiable et autonome, sous la forme d’une fondation recevant des financements aussi bien public que privé. Fondée sur une coopération Sud/Sud mais aussi Nord/Sud, le Fonds visait à développer à la fois la production de films mais aussi la mise en place de structures nationales qui peuvent rendre cette production viable.
Son principal objectif était donc de favoriser l’émergence de films et de séries panafricaines répondant aux critères de qualité artistique selon le standard international et apporter aux films sélectionnés une contribution financière substantielle, leur offrant ainsi une chance d’avoir une distribution nationale et internationale réelle.
Cette entreprise était ambitieuse et sans doute prématurée pour l’époque. Son but ultime était de contribuer à la renaissance culturelle africaine et l’appropriation par les Africains de leur histoire et de leur littérature à travers l’image. Elle visait aussi à répondre aux aspirations de la jeunesse africaine, de plus en plus éduquée et connectée, qui attend un cinéma qui puisse lui renvoyer une image plus positive de son continent et lui offrir des personnages auxquels elle peut s’identifier. Un cinéma qui renforce leur confiance en eux et leur estime de soi, et illustre les contributions significatives des peuples africains au progrès général de l’humanité. Outre l’appui de l’UNESCO, cette initiative avait reçu le soutien de plus de quinze états membres africains et la Tunisie avait même proposée d’abriter le siège de la Fondation.
Peut-on parler aujourd’hui d’un renouveau du cinéma africain ?
On peut effectivement parler de renouveau du cinéma africain ces dernières années grâce à un nouveau contexte mondial caractérisé par la prise de conscience de nombreux États de l’importance culturelle et économique de cet art et par l’entrée en scène de partenaires privés internationaux. On constate une augmentation de la production cinématographique africaine qui est mieux financée, plus diversifiée, et mieux diffusée sur le marché international. On observe également une africanisation de tous les postes techniques et artistiques. Aujourd’hui, le cinéma africain est entré dans une nouvelle phase de renaissance et de renouvellement non seulement générationnel, mais aussi en termes de contenu. Le film de genre a fait son entrée avec des thématiques plus diversifiées explorant le registre de l’action, de la comédie, de l’anticipation, de l’horreur ou de l’animation. Ii faut signaler aussi la montée en puissance du documentaire de création.
Ce renouveau est aussi marqué par la présence croissante des femmes dans le cinéma africain, ce qui constitue à mes yeux une avancée majeure. Elles y occupent une place de choix et sont actives à tous les maillons de la chaine, comme réalisatrices, actrices, maquilleuses monteuses, mais aussi productrices et directrices de festivals.
Il y a aussi la révolution numérique qui a élargi l’audience internationale au cinéma africain et permis l’accès à un public qui jusque-là était minoré par la rareté des salles de cinéma et la faible implication des télévisions nationales. C’est pourquoi pendant des décennies, les festivals étaient les seuls lieux où le cinéma africain pouvait rayonner et offrir une visibilité et une reconnaissance aux réalisateurs et réalisatrices.
Aujourd’hui, non seulement le cinéma africain s’ouvre à un large public, mais il peut prétendre à de réelles retombées économiques. De manière générale, je dirais que le fait que notre continent soit aujourd’hui fortement courtisé par les pays du monde entier et en plein essor économique constitue un atout indéniable pour stimuler la production et la créativité des réalisateurs africains. Cependant, notre continent gagnerait à se doter d’un outil tel qu’un observatoire de cinéma africain afin de canaliser cet intérêt et de mieux en maitriser l’évolution.
Justement, pouvez-vous nous dire les raisons qui vous ont conduite à militer pour la création d’un Observatoire du cinéma africain ?
Nous assistons actuellement à une ouverture du marché africain de l’image à l’international grâce notamment aux plateformes numériques qui ont contribué à une meilleure exposition et valorisation financière du cinéma africain. Par exemple, l’acquisition par Netflix pour trois millions de dollars du film nigérian Lionheart de Genevieve Nnaji prouve que le marché reconnait le cinéma africain. Or, pour assurer un développement durable du secteur, une plus grande intervention des États africains me semble fondamentale. Pour moi l’embellie actuelle du cinéma africain qui repose pour l’heure essentiellement sur des contributions financières extérieures nécessite la mise en place d’un observatoire du cinéma africain.
En effet, il est crucial que les décideurs africains disposent d’informations fiables leur permettant de mesurer de manière rigoureuse l’impact économique et social du secteur, aussi bien à l’échelle nationale que continentale. Un tel mécanisme permettrait aux États et aux professionnels d’être au fait des évolutions économiques et socioculturelles suscitées par le cinéma, de déchiffrer les enjeux et d’étudier les impacts en termes d’employabilité, de retombées touristiques et de rayonnement culturel. Cela ne pourrait qu’encourager les États à développer une politique volontariste et cohérente en connaissance de cause et d’être en capacité de négocier avec notamment les plateformes numériques en vue d’obtenir qu’elles investissent un pourcentage de leur chiffre d’affaires dans la production locales par exemple, et ce sur la base d’informations solides. Pour toutes ces raisons, la création d’un observatoire du cinéma et de l’audiovisuel africain me parait indispensable.
Comme vous le savez certainement, Djibouti a créé récemment un Centre national du cinéma. Avez-vous été impliquée dans ce projet et quels sont les défis que ce Centre devra relever dans notre pays ?
J’ai été en effet invité en 2020 au lancement du Centre national du cinéma par le ministère de la culture. Par ailleurs, le grand écrivain somalien Nurredin Farah m’avait demandé de l’accompagner dans la préparation d’une adaptation cinématographique de son premier roman Née de la côte d’Adam. Le film devait être tourné à Djibouti avec un financement djiboutien. Si celui-ci n’a pas été encore réalisé, plusieurs films étrangers ont été tournés à Djibouti ces dernières années, faisant de notre pays une terre de tournage. C’est vrai que notre pays est photogénique avec une lumière particulière et des paysages atypiques qui peuvent intéresser les réalisateurs. Par ailleurs l’ouverture au Mall Bawadi d’un complexe de salles de cinéma équipées avec les dernières technologies a offert au public djiboutien l’opportunité de renouer avec la magie du grand écran. Aujourd’hui nous sommes saturés d’images sur nos téléphones et ordinateurs. Il ne nous manquaient que des salles obscures pour apprécier à leur juste valeur les créations cinématographiques. Il est évident donc que les potentialités qu’offrent Djibouti en termes d’infrastructures, de paysages, de diversité culturelle et de stabilité constituent des atouts importants pour l’émergence d’un cinéma et d’une culture cinématographique.
Pour moi, la mise en place d’un Centre national de cinéma à Djibouti me semble donc opportune pour capitaliser tous ces atouts et attirer des jeunes Djiboutiens à se former aux métiers du cinéma, pas seulement comme débouché professionnel mais aussi comme un moyen d’expression de notre spécificité culturelle. Djibouti gagnerait à faire fructifier toutes ces potentialités pour accueillir des rencontres cinématographiques et des tournages, des projections suivies des débats en collaboration avec les municipalités et les milieux scolaire et universitaire, soutenir financièrement la production de films djiboutiens. A ce propos, je suis très fière que notre réalisatrice Lula Ali Ismail ait pu obtenir deux soutiens de l’OIF pour la réalisation de son long métrage Dhalinyaro, (« Jeunesse »), qui a été primé au festival Vues d’Afrique ainsi que pour son court métrage Laan. L’OIF a également accompagné l’organisation d’un festival intitulé « Djibouti fait son cinéma » qui a tenu deux éditions avec l’appui de l’Institut français.
Propos recueillis par Kenza Mohamed
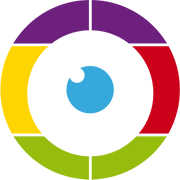 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images