Sortie française de Les Hommes d’argile. Entretien avec Mourad Boucif

«Il y a eu des réticences en Europe à soutenir mon film…» estime le réalisateur belgo-marocain du film, en salles le 20 septembre 2017, France.
Récompensé par la critique africaine à la 13ème édition du Festival International du Film Transsaharien de Zagora - FIFT 2016 au Maroc (du 22 au 26 décembre 2016), le réalisateur du film Les hommes d'argile, réalisé en 2015, Mourad Boucif relate les péripéties rencontrées pendant onze années de production de sa fiction dont sept ans de tournage. C'est un film engagé, trop sensible pour ne pas être soutenu financièrement et surtout préféré à des sujets clichés sur le terrorisme, le djihadisme… Le Bruxellois d’origine marocaine a débuté par des films d’évènements familiaux avec la caméra de son père avant d’atterrir au cinéma. M. Boucif, psychosociologue de formation, raconte comment il a franchi le pas.
Mourad BOUCIF : J’ai fait des études psychosociales, je viens plutôt du social et c’est le social qui m’a amené dans le monde du cinéma. Ce qui m’intéressait, c’est surtout de témoigner de certaines réalités, les faire partager à d’autres, apporter une plus-value. C’est comme cela que je suis rentré dans le cinéma. J’ai réalisé un court, un moyen métrage et trois longs métrages. Les hommes d'argile est mon deuxième long métrage fiction. Le premier, c’était Au-delà de Gibraltar [coréalisé avec Taylan Barman], un film qui rendait hommage à ces hommes qu’on est allé chercher pour reconstruire l’Europe, à travers l’histoire d’un jeune issu de l’émigration, de ceux qu’on appelle la deuxième génération. C’était une sorte de réflexion sociologique, légèrement métaphysique, sur un être qui essaie de trouver sa place dans un monde en pleine mutation. Mon deuxième long métrage (documentaire), La couleur du sacrifice, est un film qui rend hommage à tous ces hommes venus d’ailleurs qu’on a été cherché souvent dans des conditions difficiles, l’enrôlement forcé, des conditions assez rudes, la dureté des combats, les conditions climatiques, le fait qu’on les ait sacrifiés en première ligne… On revisite toute la seconde guerre mondiale à travers le regard de jeunes maliens, sénégalais, marocains, algériens. La couleur du sacrifice est un film assez dur parce qu’on se rend compte qu’on a vraiment utilisé, sacrifié, voire massacré, ces hommes. Je ne pouvais pas ne pas aborder le scandale de Thiaroye, les massacres d’ailleurs. La couleur du sacrifice circule énormément aujourd’hui.
La couleur du sacrifice rejoint-il alors Les hommes d’argile ?
Oui, il rejoint Les hommes d'argile. Il m’a servi d’inspiration, parce que j’ai eu la chance de rencontrer des hommes qui ont marqué l’Histoire, que leur âme repose en paix puisque la majorité nous a quittés. J’étais fort touché et cela a nourri ma réflexion et j’ai voulu aller beaucoup plus loin. J’estimais que ce n’était pas suffisant et je voulais toucher le grand public, c’est comme cela que le film Les hommes d'argile est né. Je ne voulais surtout pas faire la fiction du même sujet, c’est-à-dire du documentaire. Je ne voulais pas non plus faire deux films différents avec des supports divers.
J’ai voulu faire un autre film, différent, en allant plus loin, c’est pourquoi j’ai dépassé la dimension historique qui est présente dans le film, mais on rentre plutôt dans un voyage métaphysique, sur l’être, sur sa condition humaine, sur la terre, sur le rapport à la nature et aux éléments. C’était important, car mes personnages rencontrés durant ce travail depuis 2002, ces hommes qui ont fait l’histoire, en étaient très proches. Ils avaient des formes d’intelligence extraordinaire, de l’ordre de l’irrationnel. Des gamins qui venaient des zones assez reculées de l’Afrique, de l’Asie et des îles du Pacifique et qui étaient très proches de la faune et de la flore. Ils m’ont fort marqué. J’ai vu que le film était là dans l’intériorité, tous les trésors que chacun pouvait posséder et qu’il avait envie de partager. Plutôt que d’être dans la grande reconstitution, le grand film de guerre. En plus, je n’avais pas d’argent. Voilà pourquoi j’ai tourné le dos à la guerre, je suis rentré dans les profondeurs de l’être, de l’âme.
Le manque de financement explique-t-il cette longue durée de dix ans de fabrication du film Les hommes d’argile ? Y a-t-il eu un problème de bouclage du budget ?
C’est un bébé qui a eu un temps de gestation assez important, il a vraiment été à termes. Car c’est presque onze années de production, sept années de tournage. Le principal paramètre, c’est celui financier. Je n’ai pas eu de gros moyens, il y a eu des réticences à soutenir le projet, notamment en Europe, en France. Je n’ai pas eu de sous en France et au niveau de l’Europe. C’est un sujet sensible apparemment et on me l’a fait comprendre. On m’a vite renvoyé à une image, à savoir travailler sur d’autres sujets moins sensibles, notamment des films à caractère plus clichés. On m’a souvent demandé de faire des films de quartier, où il y a des voitures qui crament ou brûlent, des toxicos. Aujourd’hui, on me demande souvent de faire des films sur le Djihad, le terrorisme… Je peux facilement trouver des fonds et aller à Cannes ou très loin, car c’est ce qui marche aujourd’hui. Si vous ne cherchez pas cette forme de complexité, de nuance ou de vérité, si vous êtes dans les gros traits, les clichés, c’est beaucoup plus facile d’avoir de l’argent. Cela ne m’intéresse pas.
Je ne suis pas entré en cinéma pour faire du cinéma. Mais j’estime que je peux apporter quelque chose. C’est pourquoi j’ai mis beaucoup plus de temps. C’était un gros bébé, car je ne voulais pas faire la fiction du documentaire. Ce dernier est assez costaud, dur, je voulais le dépasser et dépasser la dimension historique. Je voulais apporter ma plus-value. Comme ces personnages étaient assez extraordinaires avec leur fragilité, leur vulnérabilité, je n’ai pas de héros dans mon film. Ce n’est pas les héros américains, ou français qui sont dans le nationalisme, le patriotisme, le territorialisme ; tout cela n’est que de la supercherie. Eux sont très vulnérables, fragiles malgré qu’ils aient joué un rôle.
C’est vrai que j’arrête l'action du film au début de la guerre, mais j’aurais pu continuer car, dans le documentaire [La couleur du sacrifice] on le dit bien, sans l’apport des colonies dont notamment de l’Afrique, 945 000 hommes, il n’y a pas de libération. C’est une donnée historique fondamentale dont on ne parle jamais. C’est simple, s’il n’y avait pas cette armée d’Afrique, subsaharienne et maghrébine, il n’y aurait pas de libération. On le dit dans le documentaire, très peu de journalistes d’investigation ou d’historiens le disent. Parce qu’ils ne peuvent pas le dire, certains qui l’ont dit ont été virés de leur structure. C’est vraiment scandaleux, que ce soit en Europe ou en Afrique, qu’on ne transmet pas cette histoire. Il y a une sorte d’intérêt général à ne pas parler de cette histoire, parce qu’on a donné, utilisé, sacrifié, massacré des gamins majoritairement et cela on ne peut pas le dire. Voilà pourquoi ce n’est pas évident de réaliser ces deux films, notamment Les hommes d'argile qui était beaucoup plus difficile et ambitieux.
Était-ce une nécessité, à votre niveau, de réaliser ce film?
Je suis là devant vous mais dans le générique, il y a plus de 750 personnes, une grande équipe, notamment au Maroc. On était très nombreux dans plusieurs pays à avoir cru au projet et on est content que ; malgré qu’il ait mis du temps en termes de gestation, le film circule beaucoup dans différents pays. Il touche énormément. C’était une nécessité, voire un besoin vital.
A combien estimez-vous la production globale ? Car vous avez investi dans les costumes, les décors…
Il n’y a pas de secret, les chiffres sont officiels, on est sur un budget de trois millions quatre-cents cinquante mille euros [3 450 000 euros soit 2, 263 milliards fcfa, ndlr]. On n’a eu qu’un tiers sur la Belgique, le Maroc et un tout petit peu en France dont 80 mille euros de l’Agence de la Francophonie. La différence du budget vient de mes comédiens, techniciens qui sont rentrés comme coproducteurs, ils sont en service. Ils n’ont pas été payés. Sans cet engagement, leur incroyable sensibilité, leur conviction, on n’aurait jamais fait ce film. D’ailleurs, on m’a très vite dissuadé de faire le film. Si on n’avait pas ce délire, on n’en serait pas là. C’est un film super ambitieux comme vous le dites, rien qu’en termes de reconstitution, mais voilà. On est très fiers mais fatigués. Car on dépasse le stade de l’émotion.
Le film touche différents continents. Nous rentrons d’un festival au Brésil où le film a beaucoup été apprécié. Nous essayons, en quelque sorte, de rectifier et d’écrire cette page de l’histoire qui n’a jamais été écrite. En Belgique, un amendement va passer dans les prochaines semaines [cet entretien a été réalisé le 25 décembre 2016], le Ministère de l’Education va revoir les manuels scolaires au niveau de la Seconde Guerre mondiale, notamment pour la diffusion et la transmission de cette page d’Histoire. Le but aussi est de former, avec des modules, des professeurs pour qu’ils soient beaucoup plus sensibilisés sur cette question. En France, on fait la même chose. On a fait une projection au niveau du Parlement européen, il y a quelques jours. Notre travail s’arrêtera lorsqu’on aura écrit cette page de l’Histoire.
Des films de ce genre ont participé à l’éveil des consciences, notamment Indigènes (Rachid Bouchareb), Camp de Thiaroye (Ousmane Sembène et Thierno Faty Sow)….
Je reprends carrément les travaux de Sembène Ousmane que j’ai eu l’honneur de rencontrer, que son âme repose en paix. Il m’a donné des images, j’ai un long chapitre sur Thiaroye. L’art, c’est le garant de la culture, voire même le bras armé de la culture. C’est juste celui qui va préserver la culture. S’il n’y a pas l’artiste, s’il n’y pas de création, une culture et une civilisation sont amenées à disparaitre. On le voit, de grandes civilisations, aztèques et mayas par exemple, ont disparu quand la transmission de leur art et de leur culture s’est arrêtée. Je travaille sur ces questions, c’est un exemple assez dur, et qui menace malheureusement aujourd’hui. Nous devons tirer des enseignements sur ces mécanismes qui ont tendance à décimer des groupes.
Vous êtes-vous inspiré seulement de ces deux films ? Ou bien vous êtes parti de votre propre histoire, car le Maroc, votre pays d’origine, était aussi concerné ?
J’ai eu la chance de rencontrer en 2002 ces hommes qui ont fait l’Histoire, ces oubliés, pendant plusieurs années et c’est comme cela que le documentaire La couleur du sacrifice est né. J’ai eu le privilège d’aller dans les foyers à Paris où ils ont logés avant qu’ils ne disparaissent tous. Cela m’a bouleversé, j’ai écrit. C’est eux qui m’ont nourri et ont changé le cours de ma vie. Pendant quinze ans, je suis sur cette thématique. Je ne terminerais mon engagement que quand au niveau de la mémoire collective, un travail scientifique se fasse. Il faut que les historiens soient à l’œuvre. On a une profonde responsabilité en tant qu’artiste.
Au regard de votre filmographie – Au-delà de Gibraltar, La Couleur du sacrifice, Les hommes d’argile – on est toujours dans cette thématique de double culture. C’est lié à votre personne ou c’est une envie simplement d’en parler ?
Il y a toujours une dimension autobiographique. Je suis dans les entre-deux. C’est une thématique qui est très importante encore plus aujourd’hui. On nous ramène des théories qui sont de la pure supercherie, telle que le choc des civilisations. Des théories mensongères, comme s’il faut se méfier de l’autre. Nous traversons une période difficile. Je vis à Bruxelles et je suis souvent à Paris. Du coup, cela devient une nécessité d’apporter un meilleur éclairage, un peu plus de nuance, de complexité sur cette cohabitation qui est là, qui existe, mais qui n’est pas visible parce que non vendeur au niveau des médias, le monde du politique. C’est l’heure du populisme, de la xénophobie, électorat oblige. Le monde des médias est souvent proche voire appartient aux politiques et donc il sert des agendas. À l’heure où l’extrême droite est en train de monter un peu partout, on a une profonde et terrible responsabilité en tant qu’artiste. Même si on travaille sur des sujets qui sont plus complexes, plus difficiles à mettre en place, à trouver des fonds, on peut jouer un rôle crucial.
Etes-vous toujours déterminé à poursuivre le combat de la mémoire ?
Je suis gonflé à bloc. Quand vous vous trouvez devant 600 à 700 personnes qui sont émues, bouleversées, devant des gens qui ne sont pas concernés comme en Amérique latine, où on ne parle pas notre langue, et à la fin ils viennent vers vous les larmes aux yeux, complètement bouleversés, et vous embrassent. Certains ne trouvent même plus les mots, car ils n’ont pas le vocabulaire, tout cela parce qu’ils ont vécu un moment assez fort. La dimension universelle d’un film est très importante. J’étais assez loin, c’était volontaire soit à côté de la réalisation, de la mise en scène, la bande son, l’écriture, j’avais besoin à travers une thématique bien spécifique, des personnages bien caractérisés qu’ils aient cette dimension universelle. Je suis content car de ce côté-là, le film a touché. C’est dans l’union, pas dans le communautarisme et le sectarisme, qu’on va s’en sortir. Chacun peut préserver ce qui le caractérise, mais tout en s’inscrivant dans une dynamique collective. C’est là le grand défi des artistes que nous sommes.
Pour la séquence de la guerre avez-vous bénéficié d’un coaching de la part d’une quelconque armée ?
J’ai eu le soutien de la Défense en Belgique, car le film a été tourné dans les Ardennes. Le Ministère nous avait offert, en termes d’infrastructure, une réserve privée. Pour reproduire une grande bataille de la seconde guerre mondiale, il fallait un lieu assez important. Les Ardennes étaient extraordinaires. Le reste relève de la débrouille, on a dû s’inspirer, ramener des gens qui pourraient nous aider à reconstituer cette grande bataille, ramener des chars de France, des costumes et d’armes aussi de France. Une grande partie du budget est partie dans l’acquisition de ces éléments. C’est important si l’on a la prétention de faire un film qui ait une dimension historique, il faut suivre cette longue progression sinon ce ne serait pas crédible. Même s’il y a cette dimension intimiste, il y a un dispositif assez lourd et complexe. C’est notamment pour cela qu’on a mis plus de temps. Ce n’est pas un film contemporain, ni un film léger. Je ne souhaitais pas le produire au début. Je l’ai produit avec Vanessa Brichaut qui est une productrice belge et, malheureusement, on n’a pas trouvé de producteur. On était obligé de le faire nous mêmes.
C’est un film qui a duré dans la réalisation. Les comédiens ont changé entre le début du tournage et la fin. Comment l’étalonnage a été fait ?
Nous avons fait des choix assez importants, j’ai voulu que le film soit intemporel. Je ne voulais pas qu’il ait un ancrage seulement en 1940 ou uniquement pendant la Seconde guerre mondiale. Je voulais que le spectateur qui voit le film, qu’il soit en Antarctique, en Amérique Latine ou en Afrique, puisse s’y identifier par rapport à une histoire qu’il aurait vécue, notamment avec des chemins similaires. C’est pourquoi je n’ai pas donné de référence, ni de temps ou de date. Je voulais qu’il ait un sentiment d’identification plus large qui va au-delà du lieu ou du temps. On a beaucoup travaillé sur l’image, on avait un super chef opérateur, on a tourné dans de belles conditions, malgré le peu de moyens. Il y a des choix volontaires, radicaux et assumés.
Vous disiez à l’entame de vos propos que le film tourne. Est-ce qu’il est bien distribué ou demandé dans les pays africains ?
Comme le film commence à circuler, il y a des distributeurs qui sont intéressés. On a une sortie au Brésil […] qui se met en place, il y en a une en France [le 20 septembre 2017, ndlr], on doit enchainer en février aussi pour d’autres pays pour qu’il ait un lien surtout au niveau de la promotion. Le Maroc sera le plus facile pour nous parce qu’on est ici, j’ai pas mal de soutiens et il y a une proximité et une sensibilité pour le sujet. Pour le reste de l’Afrique subsaharienne, actuellement, j’ai un bon distributeur au Sénégal qui est intéressé. Il y a le Ministère de la Culture et la Délégation Wallonie-Bruxelles qui m’ont appelé pour une planification d’une projection au Sénégal et au Burkina Faso. Ce qui est important pour moi, c’est que le film soit vu par le grand public, je fais énormément de projections partout, notamment dans le réseau scolaire et associatif. On est demandeur pour que le film soit partagé avec le grand public. On a une page facebook qui est très active, on peut prendre contact facilement avec nous.
Quels sont vos projets actuels et futurs ?
Il y en a quelques-uns, mais comme on sort du front (rires), on est en train de se calmer et il faut pousser celui-là. On n’a pas mal de boulot et le contexte n’est pas favorable. Il ne faut pas avoir fait de la sociologie pour se rendre compte, il y a des groupes, des réseaux et ce n’est pas évident de s’imposer. Encore plus si le film est engagé et porte des dimensions assez particulières, métaphysiques et philosophiques.
C’est parce vous êtes cinéaste africain ou c’est le secteur qui est morose ?
C’est de façon générale. Le schéma est là, quel que soit le profil qu’on peut avoir. Faire du cinéma, c’est très difficile, produire des films, c’est encore plus compliqué, et des films comme le nôtre le sont encore plus. J’ajouterai le fait que nous soyons des cinéastes issus de la diversité, il y a une forme de paternalisme, ce qui fait que c’est un peu compliqué. C’est comme on vous dit « qui tu es ? » « D’où tu viens ? » « Pourquoi tu viens avec ce sujet ? » « Par contre parle-nous du terrorisme, du Djihad, des sujets qui rapportent plus ». C’est un très grand problème malheureusement. Je le vois surtout dans la conception et dans la chaine de distribution. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des dynamiques qui se font, se créent, les choses sont en train de bouger. Je crois qu’on ira vers des jours meilleurs.
Propos recueillis à Zagora
par Fatou Kiné SÈNE
Dakar, Africiné Magazine
pour Images Francophones
Image : Mourad BOUCIF, cinéaste belgo-marocain.
Crédit : DR.
Mourad BOUCIF : J’ai fait des études psychosociales, je viens plutôt du social et c’est le social qui m’a amené dans le monde du cinéma. Ce qui m’intéressait, c’est surtout de témoigner de certaines réalités, les faire partager à d’autres, apporter une plus-value. C’est comme cela que je suis rentré dans le cinéma. J’ai réalisé un court, un moyen métrage et trois longs métrages. Les hommes d'argile est mon deuxième long métrage fiction. Le premier, c’était Au-delà de Gibraltar [coréalisé avec Taylan Barman], un film qui rendait hommage à ces hommes qu’on est allé chercher pour reconstruire l’Europe, à travers l’histoire d’un jeune issu de l’émigration, de ceux qu’on appelle la deuxième génération. C’était une sorte de réflexion sociologique, légèrement métaphysique, sur un être qui essaie de trouver sa place dans un monde en pleine mutation. Mon deuxième long métrage (documentaire), La couleur du sacrifice, est un film qui rend hommage à tous ces hommes venus d’ailleurs qu’on a été cherché souvent dans des conditions difficiles, l’enrôlement forcé, des conditions assez rudes, la dureté des combats, les conditions climatiques, le fait qu’on les ait sacrifiés en première ligne… On revisite toute la seconde guerre mondiale à travers le regard de jeunes maliens, sénégalais, marocains, algériens. La couleur du sacrifice est un film assez dur parce qu’on se rend compte qu’on a vraiment utilisé, sacrifié, voire massacré, ces hommes. Je ne pouvais pas ne pas aborder le scandale de Thiaroye, les massacres d’ailleurs. La couleur du sacrifice circule énormément aujourd’hui.
La couleur du sacrifice rejoint-il alors Les hommes d’argile ?
Oui, il rejoint Les hommes d'argile. Il m’a servi d’inspiration, parce que j’ai eu la chance de rencontrer des hommes qui ont marqué l’Histoire, que leur âme repose en paix puisque la majorité nous a quittés. J’étais fort touché et cela a nourri ma réflexion et j’ai voulu aller beaucoup plus loin. J’estimais que ce n’était pas suffisant et je voulais toucher le grand public, c’est comme cela que le film Les hommes d'argile est né. Je ne voulais surtout pas faire la fiction du même sujet, c’est-à-dire du documentaire. Je ne voulais pas non plus faire deux films différents avec des supports divers.
J’ai voulu faire un autre film, différent, en allant plus loin, c’est pourquoi j’ai dépassé la dimension historique qui est présente dans le film, mais on rentre plutôt dans un voyage métaphysique, sur l’être, sur sa condition humaine, sur la terre, sur le rapport à la nature et aux éléments. C’était important, car mes personnages rencontrés durant ce travail depuis 2002, ces hommes qui ont fait l’histoire, en étaient très proches. Ils avaient des formes d’intelligence extraordinaire, de l’ordre de l’irrationnel. Des gamins qui venaient des zones assez reculées de l’Afrique, de l’Asie et des îles du Pacifique et qui étaient très proches de la faune et de la flore. Ils m’ont fort marqué. J’ai vu que le film était là dans l’intériorité, tous les trésors que chacun pouvait posséder et qu’il avait envie de partager. Plutôt que d’être dans la grande reconstitution, le grand film de guerre. En plus, je n’avais pas d’argent. Voilà pourquoi j’ai tourné le dos à la guerre, je suis rentré dans les profondeurs de l’être, de l’âme.
Le manque de financement explique-t-il cette longue durée de dix ans de fabrication du film Les hommes d’argile ? Y a-t-il eu un problème de bouclage du budget ?
C’est un bébé qui a eu un temps de gestation assez important, il a vraiment été à termes. Car c’est presque onze années de production, sept années de tournage. Le principal paramètre, c’est celui financier. Je n’ai pas eu de gros moyens, il y a eu des réticences à soutenir le projet, notamment en Europe, en France. Je n’ai pas eu de sous en France et au niveau de l’Europe. C’est un sujet sensible apparemment et on me l’a fait comprendre. On m’a vite renvoyé à une image, à savoir travailler sur d’autres sujets moins sensibles, notamment des films à caractère plus clichés. On m’a souvent demandé de faire des films de quartier, où il y a des voitures qui crament ou brûlent, des toxicos. Aujourd’hui, on me demande souvent de faire des films sur le Djihad, le terrorisme… Je peux facilement trouver des fonds et aller à Cannes ou très loin, car c’est ce qui marche aujourd’hui. Si vous ne cherchez pas cette forme de complexité, de nuance ou de vérité, si vous êtes dans les gros traits, les clichés, c’est beaucoup plus facile d’avoir de l’argent. Cela ne m’intéresse pas.
Je ne suis pas entré en cinéma pour faire du cinéma. Mais j’estime que je peux apporter quelque chose. C’est pourquoi j’ai mis beaucoup plus de temps. C’était un gros bébé, car je ne voulais pas faire la fiction du documentaire. Ce dernier est assez costaud, dur, je voulais le dépasser et dépasser la dimension historique. Je voulais apporter ma plus-value. Comme ces personnages étaient assez extraordinaires avec leur fragilité, leur vulnérabilité, je n’ai pas de héros dans mon film. Ce n’est pas les héros américains, ou français qui sont dans le nationalisme, le patriotisme, le territorialisme ; tout cela n’est que de la supercherie. Eux sont très vulnérables, fragiles malgré qu’ils aient joué un rôle.
C’est vrai que j’arrête l'action du film au début de la guerre, mais j’aurais pu continuer car, dans le documentaire [La couleur du sacrifice] on le dit bien, sans l’apport des colonies dont notamment de l’Afrique, 945 000 hommes, il n’y a pas de libération. C’est une donnée historique fondamentale dont on ne parle jamais. C’est simple, s’il n’y avait pas cette armée d’Afrique, subsaharienne et maghrébine, il n’y aurait pas de libération. On le dit dans le documentaire, très peu de journalistes d’investigation ou d’historiens le disent. Parce qu’ils ne peuvent pas le dire, certains qui l’ont dit ont été virés de leur structure. C’est vraiment scandaleux, que ce soit en Europe ou en Afrique, qu’on ne transmet pas cette histoire. Il y a une sorte d’intérêt général à ne pas parler de cette histoire, parce qu’on a donné, utilisé, sacrifié, massacré des gamins majoritairement et cela on ne peut pas le dire. Voilà pourquoi ce n’est pas évident de réaliser ces deux films, notamment Les hommes d'argile qui était beaucoup plus difficile et ambitieux.
Était-ce une nécessité, à votre niveau, de réaliser ce film?
Je suis là devant vous mais dans le générique, il y a plus de 750 personnes, une grande équipe, notamment au Maroc. On était très nombreux dans plusieurs pays à avoir cru au projet et on est content que ; malgré qu’il ait mis du temps en termes de gestation, le film circule beaucoup dans différents pays. Il touche énormément. C’était une nécessité, voire un besoin vital.
A combien estimez-vous la production globale ? Car vous avez investi dans les costumes, les décors…
Il n’y a pas de secret, les chiffres sont officiels, on est sur un budget de trois millions quatre-cents cinquante mille euros [3 450 000 euros soit 2, 263 milliards fcfa, ndlr]. On n’a eu qu’un tiers sur la Belgique, le Maroc et un tout petit peu en France dont 80 mille euros de l’Agence de la Francophonie. La différence du budget vient de mes comédiens, techniciens qui sont rentrés comme coproducteurs, ils sont en service. Ils n’ont pas été payés. Sans cet engagement, leur incroyable sensibilité, leur conviction, on n’aurait jamais fait ce film. D’ailleurs, on m’a très vite dissuadé de faire le film. Si on n’avait pas ce délire, on n’en serait pas là. C’est un film super ambitieux comme vous le dites, rien qu’en termes de reconstitution, mais voilà. On est très fiers mais fatigués. Car on dépasse le stade de l’émotion.
Le film touche différents continents. Nous rentrons d’un festival au Brésil où le film a beaucoup été apprécié. Nous essayons, en quelque sorte, de rectifier et d’écrire cette page de l’histoire qui n’a jamais été écrite. En Belgique, un amendement va passer dans les prochaines semaines [cet entretien a été réalisé le 25 décembre 2016], le Ministère de l’Education va revoir les manuels scolaires au niveau de la Seconde Guerre mondiale, notamment pour la diffusion et la transmission de cette page d’Histoire. Le but aussi est de former, avec des modules, des professeurs pour qu’ils soient beaucoup plus sensibilisés sur cette question. En France, on fait la même chose. On a fait une projection au niveau du Parlement européen, il y a quelques jours. Notre travail s’arrêtera lorsqu’on aura écrit cette page de l’Histoire.
Des films de ce genre ont participé à l’éveil des consciences, notamment Indigènes (Rachid Bouchareb), Camp de Thiaroye (Ousmane Sembène et Thierno Faty Sow)….
Je reprends carrément les travaux de Sembène Ousmane que j’ai eu l’honneur de rencontrer, que son âme repose en paix. Il m’a donné des images, j’ai un long chapitre sur Thiaroye. L’art, c’est le garant de la culture, voire même le bras armé de la culture. C’est juste celui qui va préserver la culture. S’il n’y a pas l’artiste, s’il n’y pas de création, une culture et une civilisation sont amenées à disparaitre. On le voit, de grandes civilisations, aztèques et mayas par exemple, ont disparu quand la transmission de leur art et de leur culture s’est arrêtée. Je travaille sur ces questions, c’est un exemple assez dur, et qui menace malheureusement aujourd’hui. Nous devons tirer des enseignements sur ces mécanismes qui ont tendance à décimer des groupes.
Vous êtes-vous inspiré seulement de ces deux films ? Ou bien vous êtes parti de votre propre histoire, car le Maroc, votre pays d’origine, était aussi concerné ?
J’ai eu la chance de rencontrer en 2002 ces hommes qui ont fait l’Histoire, ces oubliés, pendant plusieurs années et c’est comme cela que le documentaire La couleur du sacrifice est né. J’ai eu le privilège d’aller dans les foyers à Paris où ils ont logés avant qu’ils ne disparaissent tous. Cela m’a bouleversé, j’ai écrit. C’est eux qui m’ont nourri et ont changé le cours de ma vie. Pendant quinze ans, je suis sur cette thématique. Je ne terminerais mon engagement que quand au niveau de la mémoire collective, un travail scientifique se fasse. Il faut que les historiens soient à l’œuvre. On a une profonde responsabilité en tant qu’artiste.
Au regard de votre filmographie – Au-delà de Gibraltar, La Couleur du sacrifice, Les hommes d’argile – on est toujours dans cette thématique de double culture. C’est lié à votre personne ou c’est une envie simplement d’en parler ?
Il y a toujours une dimension autobiographique. Je suis dans les entre-deux. C’est une thématique qui est très importante encore plus aujourd’hui. On nous ramène des théories qui sont de la pure supercherie, telle que le choc des civilisations. Des théories mensongères, comme s’il faut se méfier de l’autre. Nous traversons une période difficile. Je vis à Bruxelles et je suis souvent à Paris. Du coup, cela devient une nécessité d’apporter un meilleur éclairage, un peu plus de nuance, de complexité sur cette cohabitation qui est là, qui existe, mais qui n’est pas visible parce que non vendeur au niveau des médias, le monde du politique. C’est l’heure du populisme, de la xénophobie, électorat oblige. Le monde des médias est souvent proche voire appartient aux politiques et donc il sert des agendas. À l’heure où l’extrême droite est en train de monter un peu partout, on a une profonde et terrible responsabilité en tant qu’artiste. Même si on travaille sur des sujets qui sont plus complexes, plus difficiles à mettre en place, à trouver des fonds, on peut jouer un rôle crucial.
Etes-vous toujours déterminé à poursuivre le combat de la mémoire ?
Je suis gonflé à bloc. Quand vous vous trouvez devant 600 à 700 personnes qui sont émues, bouleversées, devant des gens qui ne sont pas concernés comme en Amérique latine, où on ne parle pas notre langue, et à la fin ils viennent vers vous les larmes aux yeux, complètement bouleversés, et vous embrassent. Certains ne trouvent même plus les mots, car ils n’ont pas le vocabulaire, tout cela parce qu’ils ont vécu un moment assez fort. La dimension universelle d’un film est très importante. J’étais assez loin, c’était volontaire soit à côté de la réalisation, de la mise en scène, la bande son, l’écriture, j’avais besoin à travers une thématique bien spécifique, des personnages bien caractérisés qu’ils aient cette dimension universelle. Je suis content car de ce côté-là, le film a touché. C’est dans l’union, pas dans le communautarisme et le sectarisme, qu’on va s’en sortir. Chacun peut préserver ce qui le caractérise, mais tout en s’inscrivant dans une dynamique collective. C’est là le grand défi des artistes que nous sommes.
Pour la séquence de la guerre avez-vous bénéficié d’un coaching de la part d’une quelconque armée ?
J’ai eu le soutien de la Défense en Belgique, car le film a été tourné dans les Ardennes. Le Ministère nous avait offert, en termes d’infrastructure, une réserve privée. Pour reproduire une grande bataille de la seconde guerre mondiale, il fallait un lieu assez important. Les Ardennes étaient extraordinaires. Le reste relève de la débrouille, on a dû s’inspirer, ramener des gens qui pourraient nous aider à reconstituer cette grande bataille, ramener des chars de France, des costumes et d’armes aussi de France. Une grande partie du budget est partie dans l’acquisition de ces éléments. C’est important si l’on a la prétention de faire un film qui ait une dimension historique, il faut suivre cette longue progression sinon ce ne serait pas crédible. Même s’il y a cette dimension intimiste, il y a un dispositif assez lourd et complexe. C’est notamment pour cela qu’on a mis plus de temps. Ce n’est pas un film contemporain, ni un film léger. Je ne souhaitais pas le produire au début. Je l’ai produit avec Vanessa Brichaut qui est une productrice belge et, malheureusement, on n’a pas trouvé de producteur. On était obligé de le faire nous mêmes.
C’est un film qui a duré dans la réalisation. Les comédiens ont changé entre le début du tournage et la fin. Comment l’étalonnage a été fait ?
Nous avons fait des choix assez importants, j’ai voulu que le film soit intemporel. Je ne voulais pas qu’il ait un ancrage seulement en 1940 ou uniquement pendant la Seconde guerre mondiale. Je voulais que le spectateur qui voit le film, qu’il soit en Antarctique, en Amérique Latine ou en Afrique, puisse s’y identifier par rapport à une histoire qu’il aurait vécue, notamment avec des chemins similaires. C’est pourquoi je n’ai pas donné de référence, ni de temps ou de date. Je voulais qu’il ait un sentiment d’identification plus large qui va au-delà du lieu ou du temps. On a beaucoup travaillé sur l’image, on avait un super chef opérateur, on a tourné dans de belles conditions, malgré le peu de moyens. Il y a des choix volontaires, radicaux et assumés.
Vous disiez à l’entame de vos propos que le film tourne. Est-ce qu’il est bien distribué ou demandé dans les pays africains ?
Comme le film commence à circuler, il y a des distributeurs qui sont intéressés. On a une sortie au Brésil […] qui se met en place, il y en a une en France [le 20 septembre 2017, ndlr], on doit enchainer en février aussi pour d’autres pays pour qu’il ait un lien surtout au niveau de la promotion. Le Maroc sera le plus facile pour nous parce qu’on est ici, j’ai pas mal de soutiens et il y a une proximité et une sensibilité pour le sujet. Pour le reste de l’Afrique subsaharienne, actuellement, j’ai un bon distributeur au Sénégal qui est intéressé. Il y a le Ministère de la Culture et la Délégation Wallonie-Bruxelles qui m’ont appelé pour une planification d’une projection au Sénégal et au Burkina Faso. Ce qui est important pour moi, c’est que le film soit vu par le grand public, je fais énormément de projections partout, notamment dans le réseau scolaire et associatif. On est demandeur pour que le film soit partagé avec le grand public. On a une page facebook qui est très active, on peut prendre contact facilement avec nous.
Quels sont vos projets actuels et futurs ?
Il y en a quelques-uns, mais comme on sort du front (rires), on est en train de se calmer et il faut pousser celui-là. On n’a pas mal de boulot et le contexte n’est pas favorable. Il ne faut pas avoir fait de la sociologie pour se rendre compte, il y a des groupes, des réseaux et ce n’est pas évident de s’imposer. Encore plus si le film est engagé et porte des dimensions assez particulières, métaphysiques et philosophiques.
C’est parce vous êtes cinéaste africain ou c’est le secteur qui est morose ?
C’est de façon générale. Le schéma est là, quel que soit le profil qu’on peut avoir. Faire du cinéma, c’est très difficile, produire des films, c’est encore plus compliqué, et des films comme le nôtre le sont encore plus. J’ajouterai le fait que nous soyons des cinéastes issus de la diversité, il y a une forme de paternalisme, ce qui fait que c’est un peu compliqué. C’est comme on vous dit « qui tu es ? » « D’où tu viens ? » « Pourquoi tu viens avec ce sujet ? » « Par contre parle-nous du terrorisme, du Djihad, des sujets qui rapportent plus ». C’est un très grand problème malheureusement. Je le vois surtout dans la conception et dans la chaine de distribution. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des dynamiques qui se font, se créent, les choses sont en train de bouger. Je crois qu’on ira vers des jours meilleurs.
Propos recueillis à Zagora
par Fatou Kiné SÈNE
Dakar, Africiné Magazine
pour Images Francophones
Image : Mourad BOUCIF, cinéaste belgo-marocain.
Crédit : DR.
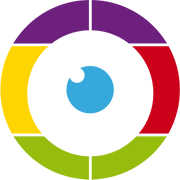 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images