Sortie en France - le 22 janvier 2014 - L'absence de Mama Keïta

Entretien avec le réalisateur Mama Keïta, autour de la distribution de son long-métrage.
La sortie française de L'Absence, quatre ans après sa réalisation, est assurée à bouts de bras par son auteur. Mama Keïta s'est fait distributeur pour défendre sur les écrans une tragédie sénégalaise, filmée comme un polar troublant.
L'engagement et la véhémence de Mama Keïta lui ont permis de tracer une place personnelle au-delà des frontières du cinéma. Habile à manier les codes de la société française dans ses premiers longs-métrages, Ragazzi, 1990, Le 11ème commandement, 1997, il défend résolument ses origines africaines en explorant Le fleuve, 2002, un road movie en Guinée, tourné pour relayer son homologue décédé, David Achkar. Habité par ses rencontres, les contrastes de cultures, les ambiguïtés des sentiments, Mama Keïta développe une aptitude à la production indépendante et légère avec Le sourire du serpent, 2007.
Le désir de se mesurer davantage aux réalités africaines débouche sur L'Absence, 2009, qui suit le retour forcé et provisoire d'un Sénégalais, Adama [William Nadylam, ndlr], venu revoir sa grand-mère et sa sœur cadette, après des années en France. Sa mauvaise conscience perce en retrouvant ses amis, son ancien professeur, et surtout sa sœur qui partage son corps entre les soins familiaux et les passes dans la nuit. La crudité des thèmes abordés est mâtinée par la forme d'un film de genre qui se veut populaire. Avec ses personnages déchirés, ses questions lancées, ses courses dans la nuit, Mama Keïta sait capter l'attention du public même si l'ensemble manque d'une cohérence de ton qui servirait mieux son propos.
Les difficultés de production ont pu peser sur ce film dense qui prétend lancer une réflexion sur l'exode des Africains pour s'éduquer, et la déstructuration sociale qui en découle. Mama Keïta explique ainsi comment il traite un drame familial où la femme se meurtrit en provocant. L'Absence est amplifiée par une histoire tragique, définie dans la problématique africaine qui interpelle le regard métissé et incisif de Mama Keïta. Il revient sur les productions précaires des auteurs africains et les difficultés de distribution qui ont retardé la diffusion commerciale du film, en France. Devenu distributeur, après avoir produit et scénarisé L'Absence, Mama Keïta se révèle un cinéaste pragmatique et offensif. Il vise à s'implanter en Amérique pour mieux faire jaillir sur les écrans les résonances africaines qu'il évoque et revendique ici.
- Quel est pour vous, le sujet principal de L'Absence ?
C'est un film qui marche sur deux pieds. Deux thèmes en sont les soubassements. L'un, c'est le drame intime d'une famille. Il y a deux personnages, un frère et une sœur, que sépare un drame familial, la mort de la mère, un deuil resté inachevé. L'autre thème, c'est celui de l'absence des élites, formées pour la plupart en Occident, qui sont supposées revenir, au terme de leurs études. C'est le contrat moral passé avec le pays qui les subventionne, ou la famille. Ils doivent revenir investir leur savoir dans le pays et réintégrer leur place dans la structure familiale. C'est souvent les aînés mâles qu'on envoie, et leur absence impacte de manière parfois tragique, les familles.
- Qu'est ce qui vous a motivé à aborder ce non-retour ?
J'avais envie, après avoir fait ce film particulier qui est Le fleuve, de revenir en Afrique. Je ne me sentais pas de faire un film folklorique mais au contraire, un film politique qui me parle et qui parle de ça. C'est rarement abordé. En faisant des études, j'ai longtemps fréquenté des étudiants africains. J'ai vu quelle déchirure cela a été pour la plupart. Ils correspondaient tous au même schéma : des étudiants partis plein d'espoir, investis par leur famille, par le pays, qui étaient supposés revenir.
Je notais que nombre d'entre eux ne revenaient pas. S'ils en étaient heureux encore… Mais il y avait un mal d'ordre cancérigène qui les bouffait et qu'ils taisaient, ce qui accroissait encore plus le mal. Ils étaient déchirés avec ce nouveau pays, nouveau système, nouvelle culture qu'ils découvraient où on pouvait se permettre des choses, s'exprimer, vivre sans le tabou, sans le poids de la société. On pouvait être plus libre et garder en tête cette promesse faite, cette responsabilité qui devait être assumée : celle de revenir et reprendre sa place dans sa famille. Je me suis aperçu que cet exil était un écartèlement. Je me suis mis à creuser la question.
J'ai été frappé par le drame d'un ami qui n'est pas revenu, tout simplement parce qu'il avait failli. Il n'avait pas été à la hauteur de sa mission. Avec cette honte au front, il ne pouvait pas revenir. Pourtant les siens étaient prêts à l'accueillir malgré cet échec mais il ne pouvait pas. En plus de sa culpabilité de l'absence, il avait celle de n'avoir pas été là, à la mort de sa mère. Il a rompu et s'est tourné dans l'obscurité du silence qui a épaissi son mal. Ça m'a frappé.
- Oui mais dans le film c'est différent. Vous montrez un personnage qui a bien réussi à s'intégrer à la société française. Pourquoi ?
J'ai préféré aller vers cet extrême, justement, de celui qui réussit. L'émigration économique d'Afrique est constituée en majorité d'analphabètes mais ils s'organisent. Paradoxalement ils font plus pour leur pays. Quantité de leurs salaires repartent automatiquement au pays, par des transferts de fonds. Alors que pour le personnage de polytechnicien que je mets en scène, comme ceux qui accèdent à un certain statut social, l'essentiel de l'assiette de leur pouvoir d'achat est consommé sur place. On se retrouve devant ce paradoxe : ceux pour qui on investit le plus sont ceux pour qui le retour sur investissement est le plus faible. En revanche, ceux qui sont partis par leurs propres moyens, au péril de leur vie, sont ceux qui font le plus.
C'est à partir de là, que je me suis dit que les études macro-économiques sur le sous-développement ne reflètent jamais cette question. Pour moi, c'est un point fondamental du sous-développement. L'absence de ces personnes éduquées impacte le pays de deux manières : intime puis politique et économique. Si on tarit un lieu de toute matière grise, c'est un terreau idéal pour la dictature. Les dictateurs n'aiment que les masses incultes. C'est plus simple pour exercer les pressions les plus brutales.
- Pourquoi avoir doublé cette question politique avec une autre qui est ce problème avec la sœur qui a une double vie ?
Je ne pouvais pas simplement m'en tenir à la conséquence sur le pays. Il me fallait aussi traiter de l'impact sur la famille. Car ce n'est pas n'importe qui que l'on envoie, c'est l'aîné mâle. C'est sur lui qu'on investit, c'est le substitut du père dans la structure familiale africaine. C'est lui qui est supposé être là pour les autres, en cas de défaillance du père, de décès, de maladie. Son absence fait que personne ne tient le gouvernail. Un certain nombre de structures familiales se lézardent. C'est pour ça qu'il fallait aborder ces deux questions de front.
- Qu'est-ce qui pousse sa sœur à entretenir une double vie ?
Ce n'est pas une double vie. Dans ce cas particulier, le frère, pour apaiser sa conscience, envoie suffisamment d'argent à sa grand-mère et à sa sœur. Il est major de promotion, je n'ai pas lésiné sur le diplôme. On sait très bien à combien émargent ces gens. Dans sa façon de penser, un peu terre à terre et vulgaire, il estime qu'il achète sa conscience comme ça. Ainsi la sœur n'a pas le besoin économique de se prostituer, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais son frère fait peser par son absence, la culpabilité de la mort de sa mère sur ses épaules. C'est ça le drame intime, le deuil inachevé. La seule manière d'attirer le regard de ce frère sur elle, pour une fille qui est dépositaire de l'honneur de la famille, c'est de se prostituer. Attenter à l'honneur de la famille, d'une manière ou d'une autre, c'est attirer l'attention de ce frère.
Cette descente aux enfers, pour elle, c'est une manière de se punir car elle prend sur elle cette culpabilité là. Même si elle n'est pour rien dans la mort de leur mère, qui la met au monde et meurt en couches. Quel être équilibré peut penser qu'elle pourrait en être responsable ? Mais ce frère polytechnicien n'a jamais dépassé la douleur de son enfance. Il a eu dix ans de vie affective symbiotique avec sa mère, et lorsque cette petite sœur arrive, sa mère décède. Son cerveau n'a pas évolué et il est resté dans la douleur de l'enfant. Il est dans une immaturité affective. Elle le comprend et va provoquer son retour. C'est un appel au secours. Donc ce n'est pas la prostitution comme un moyen de subsistance que je traite, mais la prostitution comme un moyen d'ébranler le frère, le choquer. D'ailleurs ça ne manque pas, elle atteint ce but.
- Du coup le film politique et psychologique dérive vers le film de genre, dans les rues, dans les nuits urbaines…
Oui, je pense que ça traduit aussi mon goût pour certains films de ce style. C'était une manière, pour moi, d'installer le cadre de cette tragédie.
- Au final, c'est un film africain que vous avez fait ?
Mais qu'est-ce qui fait dire qu'un film est africain ? La nationalité du cinéaste ? Je suis d'un père guinéen et je suis né au Sénégal, d'une mère vietnamienne certes. Je suis d'une culture française aussi mais né au Sénégal d'un père guinéen. Ça pèse de tout son poids. Le lieu est un critère ? Mon film se déroule à 100% au Sénégal. Si l'un des critères, ce sont les acteurs : l'essentiel d'entre eux, excepté l'héroïne, sont africains. Si on prend la langue pour définir si un film est africain, c'est un film parlé en français et en wolof, les deux langues qui ont cours au Sénégal.
Alors pourquoi me demande-t-on si c'est un film africain ? Est-ce que je ne réponds pas à toutes les cases de ces critères ? Ah, certes ce n'est pas fait selon un certain moule ! On ne voit pas le village, les gens décharnés… Il n'y a pas de complaisance, de misérabilisme… Ce serait donc ça qui fait qu'on mérite l'imprimatur " film africain " ? Il faudrait en passer par ces figures imposées ? Eh bien non, je fais une autre proposition. Il y a une surabondance de films qui répondent à ces critères auxquels je ne réponds pas.
Je me souviens d'être allé présenter ce film qui a une certaine crudité, au Sénégal, et j'ai eu le meilleur accueil. Un des comédiens qui joue dans le film, l'homme politique pervers, a pris la parole pour me remercier, ce qui m'a touché, en disant : " Si tu as pu aller au coeur alors que tu es natif d'ici mais que tu n'y vis pas, si tu as pu transcrire cette vérité, notre problématique, c'est probablement parce que tu regardes de l'extérieur. Si tu peux regarder avec cette liberté, c'est que tu n'es pas soumis à tous les interdits auxquels nous sommes soumis, qui pèsent sur notre regard et nous empêchent de nous exprimer comme tu peux le faire. " C'est lui qui m'a donné cette explication. Moi j'ai fait un film sans me poser la question de savoir si c'était un film africain. Je suis un narrateur, comme un griot.
- Pour vous il y a donc une prédominance du regard ?
Oui, moi je fais et je comprends les choses après. Si je fais, c'est que je suis mû par quelque chose. Par exemple, L'absence, je l'ai compris au montage.
- On y retrouve pourtant vos thèmes comme l'amitié trahie. Le prénom du héros est le même que dans un autre film. Ne trouvez-vous pas qu'il y a plein de fils qui relient L'Absence à vos autres films ?
Lorsque je suis dans le bouillonnement de la création, ce n'est pas mon moteur. Je raconte une histoire et il se trouve qu'elle fait écho à celle d'un autre film, et ainsi de suite. La conscience vient après l'acte.
- Et au niveau de la production, y a-t-il quelque chose d'africain ?
Ah toujours cette question… Si ce qui détermine la nationalité d'un film, c'est l'origine des fonds, dans ce cas, aucun des films dits africains de ces 50 dernières années ne pourrait se prévaloir d'être africain. Simplement parce qu'il n'y a pas de fonds qui vienne de l'Afrique sub-saharienne. De Ousmane Sembène à Souleymane Cissé en passant par Idrissa Ouédraogo et Abderrahmane Sissako jusqu'à mon modeste niveau, les fonds viennent principalement de France et de l'Union Européenne. Donc si c'était un critère, on serait dans une impasse. Il faut sortir de cette question.
Je veux bien prendre deux critères qui pourraient nous aider à penser qu'un film est africain, mais avec des pincettes… Je dirais d'abord, l'origine du réalisateur. On est dans un ensemble très particulier où le cinéma africain est beaucoup fait par des métis, biologiques ou culturels comme par exemple Balufu Bakupa-Kanyinda [Congo RDC, ndlr] qui a été élevé à Bruxelles, ou Abderrahmane Sissako [Mauritanie / Mali, ndlr], étudiant en Russie. Aucun autre cinéma n'a cette particularité. Alors qu'on renforce ce critère de l'origine du cinéaste puis celui de la thématique utilisée. Regardons si la thématique ressort du questionnement de l'Afrique. Si je fais un film en France, moi cinéaste d'origine guinéenne, et que mon héros est un immigré sans papiers, selon moi, c'est un film africain.
- Comment avez vous pu produire L'Absence ?
Essentiellement par le Fonds Afrique Images et la Francophonie. J'ai commencé le film avec 113 000 euros et en bout de course, il coûte 300 000 euros. Sont venues ensuite s'agréger des aides à la finition et surtout l'Avance après réalisation que j'ai obtenue dans des conditions assez acrobatiques, qui ont permis de solder les dernières dettes sociales du film. Sans cette aide, nous avions droit à la liquidation. On était en règlement judiciaire…
- Est ce parce que les conditions de production sont précaires que vous êtes obligé de distribuer le film vous-même ?
Oui. Je vis en France. On y produit 280 longs métrages par an, alors qu'en 47 ans, les 17 pays de l'Afrique francophones en totalisent 285… La production française en un an, équivaut à celle des 17 pays en 47 ans. Donc on voit quel est le modèle. Un film français a une moyenne de 4 à 6 millions d'euros alors que le mien coûte 300 00 euros. Ces films sont financés dès le départ. Il y a un agenda : préparation, tournage, postproduction, sortie. Dans nos productions, on segmente tout. On trouve l'argent, on essaie de financer la préparation, souvent réduite au minimum. On n'a pas tout le budget parce qu'on compte sur des aides à la finition pour boucler la production. C'est à dire que quand on arrive à la finition, on est à zéro. Donc, on doit courir à gauche et à droite pour quémander, dans le but de le finir. Il n'est pas rare qu'un film se termine quatre à cinq ans après, et ne sorte jamais parce qu'il a atteint une date de péremption. Le distributeur raisonne en disant qu'il faut de l'argent pour le sortir. Certains des films africains qui ont été portés sur les fonds baptismaux du Festival de Cannes avec 2 millions d'euros de production avancée, ont fait 18 000 entrées France. Et ce sont des films qui ont l'éclairage de Cannes, sa promotion…
- Vous avez eu des prix dans certains festivals internationaux dont celui du scénario au Fespaco. Vous avez eu des aides, des éclairages aussi. Alors pourquoi faut-il attendre quatre ans après que le film soit fini pour que vous puissiez trouver un créneau de distribution ?
Je ne trouve pas de créneau de distribution. Je prends la décision de sortir le film. Il faut que je me batte pour me frayer un petit chemin, pour espérer être sur un écran à Paris et profiter de l'intérêt que pourraient avoir des circuits de salles Art et essai. Le film rentre dans ce créneau, en ayant eu l'agrément français du CNC. Les exploitants de province qui ont moins de pressions économiques que ceux de Paris, sont un peu plus bienveillants. Ce qui les intéresse, c'est que le réalisateur vienne, c'est animer des débats avec les acteurs éventuellement, car ça entraine une meilleure affluence. Ce sont des choses qu'on peut négocier. A Paris, il n'y a pas de place pour ce genre de cinéma.
- Est-ce parce que vous pensez que l'espace du cinéma est trop petit en France que vous vous installez, pour travailler, aux Etats Unis ?
Non, c'est parce que c'est l'un des cinémas qui m'a vertébré, qui a été mon école. Outre les péplums italiens et les westerns, j'ai biberonné les mélos indiens et égyptiens dans mon enfance au Sénégal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toujours un aspect mélo dans mes films. Ça a été ma première école et ensuite le grand cinéma américain, puis le cinéma français de la Nouvelle Vague.
Mais ce n'est pas le fait que je me heurte à des impossibilités en France qui me donne envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je me sens des accointances avec le cinéma américain, et c'est un horizon vers lequel j'ai toujours eu envie d'aller.
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
(Africiné / Paris)
Photo : Aïcha (Jackie Tavernier) sur les genoux de son maquereau (le regretté Mouss Diouf).
Crédit : Kinterfin
L'engagement et la véhémence de Mama Keïta lui ont permis de tracer une place personnelle au-delà des frontières du cinéma. Habile à manier les codes de la société française dans ses premiers longs-métrages, Ragazzi, 1990, Le 11ème commandement, 1997, il défend résolument ses origines africaines en explorant Le fleuve, 2002, un road movie en Guinée, tourné pour relayer son homologue décédé, David Achkar. Habité par ses rencontres, les contrastes de cultures, les ambiguïtés des sentiments, Mama Keïta développe une aptitude à la production indépendante et légère avec Le sourire du serpent, 2007.
Le désir de se mesurer davantage aux réalités africaines débouche sur L'Absence, 2009, qui suit le retour forcé et provisoire d'un Sénégalais, Adama [William Nadylam, ndlr], venu revoir sa grand-mère et sa sœur cadette, après des années en France. Sa mauvaise conscience perce en retrouvant ses amis, son ancien professeur, et surtout sa sœur qui partage son corps entre les soins familiaux et les passes dans la nuit. La crudité des thèmes abordés est mâtinée par la forme d'un film de genre qui se veut populaire. Avec ses personnages déchirés, ses questions lancées, ses courses dans la nuit, Mama Keïta sait capter l'attention du public même si l'ensemble manque d'une cohérence de ton qui servirait mieux son propos.
Les difficultés de production ont pu peser sur ce film dense qui prétend lancer une réflexion sur l'exode des Africains pour s'éduquer, et la déstructuration sociale qui en découle. Mama Keïta explique ainsi comment il traite un drame familial où la femme se meurtrit en provocant. L'Absence est amplifiée par une histoire tragique, définie dans la problématique africaine qui interpelle le regard métissé et incisif de Mama Keïta. Il revient sur les productions précaires des auteurs africains et les difficultés de distribution qui ont retardé la diffusion commerciale du film, en France. Devenu distributeur, après avoir produit et scénarisé L'Absence, Mama Keïta se révèle un cinéaste pragmatique et offensif. Il vise à s'implanter en Amérique pour mieux faire jaillir sur les écrans les résonances africaines qu'il évoque et revendique ici.
L'Absence_BandeAnnonce from sebastien touta on Vimeo.
Acter la fuite des cerveaux en Afrique de l'Ouest
- Quel est pour vous, le sujet principal de L'Absence ?
C'est un film qui marche sur deux pieds. Deux thèmes en sont les soubassements. L'un, c'est le drame intime d'une famille. Il y a deux personnages, un frère et une sœur, que sépare un drame familial, la mort de la mère, un deuil resté inachevé. L'autre thème, c'est celui de l'absence des élites, formées pour la plupart en Occident, qui sont supposées revenir, au terme de leurs études. C'est le contrat moral passé avec le pays qui les subventionne, ou la famille. Ils doivent revenir investir leur savoir dans le pays et réintégrer leur place dans la structure familiale. C'est souvent les aînés mâles qu'on envoie, et leur absence impacte de manière parfois tragique, les familles.
- Qu'est ce qui vous a motivé à aborder ce non-retour ?
J'avais envie, après avoir fait ce film particulier qui est Le fleuve, de revenir en Afrique. Je ne me sentais pas de faire un film folklorique mais au contraire, un film politique qui me parle et qui parle de ça. C'est rarement abordé. En faisant des études, j'ai longtemps fréquenté des étudiants africains. J'ai vu quelle déchirure cela a été pour la plupart. Ils correspondaient tous au même schéma : des étudiants partis plein d'espoir, investis par leur famille, par le pays, qui étaient supposés revenir.
Je notais que nombre d'entre eux ne revenaient pas. S'ils en étaient heureux encore… Mais il y avait un mal d'ordre cancérigène qui les bouffait et qu'ils taisaient, ce qui accroissait encore plus le mal. Ils étaient déchirés avec ce nouveau pays, nouveau système, nouvelle culture qu'ils découvraient où on pouvait se permettre des choses, s'exprimer, vivre sans le tabou, sans le poids de la société. On pouvait être plus libre et garder en tête cette promesse faite, cette responsabilité qui devait être assumée : celle de revenir et reprendre sa place dans sa famille. Je me suis aperçu que cet exil était un écartèlement. Je me suis mis à creuser la question.
J'ai été frappé par le drame d'un ami qui n'est pas revenu, tout simplement parce qu'il avait failli. Il n'avait pas été à la hauteur de sa mission. Avec cette honte au front, il ne pouvait pas revenir. Pourtant les siens étaient prêts à l'accueillir malgré cet échec mais il ne pouvait pas. En plus de sa culpabilité de l'absence, il avait celle de n'avoir pas été là, à la mort de sa mère. Il a rompu et s'est tourné dans l'obscurité du silence qui a épaissi son mal. Ça m'a frappé.
- Oui mais dans le film c'est différent. Vous montrez un personnage qui a bien réussi à s'intégrer à la société française. Pourquoi ?
J'ai préféré aller vers cet extrême, justement, de celui qui réussit. L'émigration économique d'Afrique est constituée en majorité d'analphabètes mais ils s'organisent. Paradoxalement ils font plus pour leur pays. Quantité de leurs salaires repartent automatiquement au pays, par des transferts de fonds. Alors que pour le personnage de polytechnicien que je mets en scène, comme ceux qui accèdent à un certain statut social, l'essentiel de l'assiette de leur pouvoir d'achat est consommé sur place. On se retrouve devant ce paradoxe : ceux pour qui on investit le plus sont ceux pour qui le retour sur investissement est le plus faible. En revanche, ceux qui sont partis par leurs propres moyens, au péril de leur vie, sont ceux qui font le plus.
C'est à partir de là, que je me suis dit que les études macro-économiques sur le sous-développement ne reflètent jamais cette question. Pour moi, c'est un point fondamental du sous-développement. L'absence de ces personnes éduquées impacte le pays de deux manières : intime puis politique et économique. Si on tarit un lieu de toute matière grise, c'est un terreau idéal pour la dictature. Les dictateurs n'aiment que les masses incultes. C'est plus simple pour exercer les pressions les plus brutales.
Ausculter les déséquilibres familiaux
- Pourquoi avoir doublé cette question politique avec une autre qui est ce problème avec la sœur qui a une double vie ?
Je ne pouvais pas simplement m'en tenir à la conséquence sur le pays. Il me fallait aussi traiter de l'impact sur la famille. Car ce n'est pas n'importe qui que l'on envoie, c'est l'aîné mâle. C'est sur lui qu'on investit, c'est le substitut du père dans la structure familiale africaine. C'est lui qui est supposé être là pour les autres, en cas de défaillance du père, de décès, de maladie. Son absence fait que personne ne tient le gouvernail. Un certain nombre de structures familiales se lézardent. C'est pour ça qu'il fallait aborder ces deux questions de front.
- Qu'est-ce qui pousse sa sœur à entretenir une double vie ?
Ce n'est pas une double vie. Dans ce cas particulier, le frère, pour apaiser sa conscience, envoie suffisamment d'argent à sa grand-mère et à sa sœur. Il est major de promotion, je n'ai pas lésiné sur le diplôme. On sait très bien à combien émargent ces gens. Dans sa façon de penser, un peu terre à terre et vulgaire, il estime qu'il achète sa conscience comme ça. Ainsi la sœur n'a pas le besoin économique de se prostituer, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais son frère fait peser par son absence, la culpabilité de la mort de sa mère sur ses épaules. C'est ça le drame intime, le deuil inachevé. La seule manière d'attirer le regard de ce frère sur elle, pour une fille qui est dépositaire de l'honneur de la famille, c'est de se prostituer. Attenter à l'honneur de la famille, d'une manière ou d'une autre, c'est attirer l'attention de ce frère.
Cette descente aux enfers, pour elle, c'est une manière de se punir car elle prend sur elle cette culpabilité là. Même si elle n'est pour rien dans la mort de leur mère, qui la met au monde et meurt en couches. Quel être équilibré peut penser qu'elle pourrait en être responsable ? Mais ce frère polytechnicien n'a jamais dépassé la douleur de son enfance. Il a eu dix ans de vie affective symbiotique avec sa mère, et lorsque cette petite sœur arrive, sa mère décède. Son cerveau n'a pas évolué et il est resté dans la douleur de l'enfant. Il est dans une immaturité affective. Elle le comprend et va provoquer son retour. C'est un appel au secours. Donc ce n'est pas la prostitution comme un moyen de subsistance que je traite, mais la prostitution comme un moyen d'ébranler le frère, le choquer. D'ailleurs ça ne manque pas, elle atteint ce but.
- Du coup le film politique et psychologique dérive vers le film de genre, dans les rues, dans les nuits urbaines…
Oui, je pense que ça traduit aussi mon goût pour certains films de ce style. C'était une manière, pour moi, d'installer le cadre de cette tragédie.
Définir et élargir le cinéma d'Afrique francophone
- Au final, c'est un film africain que vous avez fait ?
Mais qu'est-ce qui fait dire qu'un film est africain ? La nationalité du cinéaste ? Je suis d'un père guinéen et je suis né au Sénégal, d'une mère vietnamienne certes. Je suis d'une culture française aussi mais né au Sénégal d'un père guinéen. Ça pèse de tout son poids. Le lieu est un critère ? Mon film se déroule à 100% au Sénégal. Si l'un des critères, ce sont les acteurs : l'essentiel d'entre eux, excepté l'héroïne, sont africains. Si on prend la langue pour définir si un film est africain, c'est un film parlé en français et en wolof, les deux langues qui ont cours au Sénégal.
Alors pourquoi me demande-t-on si c'est un film africain ? Est-ce que je ne réponds pas à toutes les cases de ces critères ? Ah, certes ce n'est pas fait selon un certain moule ! On ne voit pas le village, les gens décharnés… Il n'y a pas de complaisance, de misérabilisme… Ce serait donc ça qui fait qu'on mérite l'imprimatur " film africain " ? Il faudrait en passer par ces figures imposées ? Eh bien non, je fais une autre proposition. Il y a une surabondance de films qui répondent à ces critères auxquels je ne réponds pas.
Je me souviens d'être allé présenter ce film qui a une certaine crudité, au Sénégal, et j'ai eu le meilleur accueil. Un des comédiens qui joue dans le film, l'homme politique pervers, a pris la parole pour me remercier, ce qui m'a touché, en disant : " Si tu as pu aller au coeur alors que tu es natif d'ici mais que tu n'y vis pas, si tu as pu transcrire cette vérité, notre problématique, c'est probablement parce que tu regardes de l'extérieur. Si tu peux regarder avec cette liberté, c'est que tu n'es pas soumis à tous les interdits auxquels nous sommes soumis, qui pèsent sur notre regard et nous empêchent de nous exprimer comme tu peux le faire. " C'est lui qui m'a donné cette explication. Moi j'ai fait un film sans me poser la question de savoir si c'était un film africain. Je suis un narrateur, comme un griot.
- Pour vous il y a donc une prédominance du regard ?
Oui, moi je fais et je comprends les choses après. Si je fais, c'est que je suis mû par quelque chose. Par exemple, L'absence, je l'ai compris au montage.
- On y retrouve pourtant vos thèmes comme l'amitié trahie. Le prénom du héros est le même que dans un autre film. Ne trouvez-vous pas qu'il y a plein de fils qui relient L'Absence à vos autres films ?
Lorsque je suis dans le bouillonnement de la création, ce n'est pas mon moteur. Je raconte une histoire et il se trouve qu'elle fait écho à celle d'un autre film, et ainsi de suite. La conscience vient après l'acte.
- Et au niveau de la production, y a-t-il quelque chose d'africain ?
Ah toujours cette question… Si ce qui détermine la nationalité d'un film, c'est l'origine des fonds, dans ce cas, aucun des films dits africains de ces 50 dernières années ne pourrait se prévaloir d'être africain. Simplement parce qu'il n'y a pas de fonds qui vienne de l'Afrique sub-saharienne. De Ousmane Sembène à Souleymane Cissé en passant par Idrissa Ouédraogo et Abderrahmane Sissako jusqu'à mon modeste niveau, les fonds viennent principalement de France et de l'Union Européenne. Donc si c'était un critère, on serait dans une impasse. Il faut sortir de cette question.
Je veux bien prendre deux critères qui pourraient nous aider à penser qu'un film est africain, mais avec des pincettes… Je dirais d'abord, l'origine du réalisateur. On est dans un ensemble très particulier où le cinéma africain est beaucoup fait par des métis, biologiques ou culturels comme par exemple Balufu Bakupa-Kanyinda [Congo RDC, ndlr] qui a été élevé à Bruxelles, ou Abderrahmane Sissako [Mauritanie / Mali, ndlr], étudiant en Russie. Aucun autre cinéma n'a cette particularité. Alors qu'on renforce ce critère de l'origine du cinéaste puis celui de la thématique utilisée. Regardons si la thématique ressort du questionnement de l'Afrique. Si je fais un film en France, moi cinéaste d'origine guinéenne, et que mon héros est un immigré sans papiers, selon moi, c'est un film africain.
Se produire et distribuer pour affirmer sa voie
- Comment avez vous pu produire L'Absence ?
Essentiellement par le Fonds Afrique Images et la Francophonie. J'ai commencé le film avec 113 000 euros et en bout de course, il coûte 300 000 euros. Sont venues ensuite s'agréger des aides à la finition et surtout l'Avance après réalisation que j'ai obtenue dans des conditions assez acrobatiques, qui ont permis de solder les dernières dettes sociales du film. Sans cette aide, nous avions droit à la liquidation. On était en règlement judiciaire…
- Est ce parce que les conditions de production sont précaires que vous êtes obligé de distribuer le film vous-même ?
Oui. Je vis en France. On y produit 280 longs métrages par an, alors qu'en 47 ans, les 17 pays de l'Afrique francophones en totalisent 285… La production française en un an, équivaut à celle des 17 pays en 47 ans. Donc on voit quel est le modèle. Un film français a une moyenne de 4 à 6 millions d'euros alors que le mien coûte 300 00 euros. Ces films sont financés dès le départ. Il y a un agenda : préparation, tournage, postproduction, sortie. Dans nos productions, on segmente tout. On trouve l'argent, on essaie de financer la préparation, souvent réduite au minimum. On n'a pas tout le budget parce qu'on compte sur des aides à la finition pour boucler la production. C'est à dire que quand on arrive à la finition, on est à zéro. Donc, on doit courir à gauche et à droite pour quémander, dans le but de le finir. Il n'est pas rare qu'un film se termine quatre à cinq ans après, et ne sorte jamais parce qu'il a atteint une date de péremption. Le distributeur raisonne en disant qu'il faut de l'argent pour le sortir. Certains des films africains qui ont été portés sur les fonds baptismaux du Festival de Cannes avec 2 millions d'euros de production avancée, ont fait 18 000 entrées France. Et ce sont des films qui ont l'éclairage de Cannes, sa promotion…
- Vous avez eu des prix dans certains festivals internationaux dont celui du scénario au Fespaco. Vous avez eu des aides, des éclairages aussi. Alors pourquoi faut-il attendre quatre ans après que le film soit fini pour que vous puissiez trouver un créneau de distribution ?
Je ne trouve pas de créneau de distribution. Je prends la décision de sortir le film. Il faut que je me batte pour me frayer un petit chemin, pour espérer être sur un écran à Paris et profiter de l'intérêt que pourraient avoir des circuits de salles Art et essai. Le film rentre dans ce créneau, en ayant eu l'agrément français du CNC. Les exploitants de province qui ont moins de pressions économiques que ceux de Paris, sont un peu plus bienveillants. Ce qui les intéresse, c'est que le réalisateur vienne, c'est animer des débats avec les acteurs éventuellement, car ça entraine une meilleure affluence. Ce sont des choses qu'on peut négocier. A Paris, il n'y a pas de place pour ce genre de cinéma.
- Est-ce parce que vous pensez que l'espace du cinéma est trop petit en France que vous vous installez, pour travailler, aux Etats Unis ?
Non, c'est parce que c'est l'un des cinémas qui m'a vertébré, qui a été mon école. Outre les péplums italiens et les westerns, j'ai biberonné les mélos indiens et égyptiens dans mon enfance au Sénégal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toujours un aspect mélo dans mes films. Ça a été ma première école et ensuite le grand cinéma américain, puis le cinéma français de la Nouvelle Vague.
Mais ce n'est pas le fait que je me heurte à des impossibilités en France qui me donne envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je me sens des accointances avec le cinéma américain, et c'est un horizon vers lequel j'ai toujours eu envie d'aller.
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
(Africiné / Paris)
Photo : Aïcha (Jackie Tavernier) sur les genoux de son maquereau (le regretté Mouss Diouf).
Crédit : Kinterfin
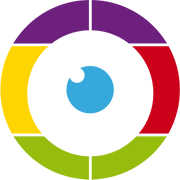 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images