Sortie de Wallay de Berni Goldblat

27/06/2017
Entretien avec un cinéaste multi cultures et multi casquettes. La distribution en France de Wallay de Berni Goldblat éclaire avec tonus l'apprentissage d'un gamin noir de banlieue française, propulsé dans sa famille africaine, au Burkina Faso, pour acquérir de meilleures manières.
Sur les écrans français le 28 juin 217, Wallay est une bouffée d'air bienvenue dans la production africaine actuelle. Découvert à la Berlinale 2017, vu au FESPACO, à Milan, Tarifa et d'autres festivals internationaux, le film de Berni Goldblat marie le sens du cinéma et celui des valeurs africaines. D'ailleurs, le réalisateur est intimement lié au Burkina Faso depuis les années 2000. Il y a fondé Cinomade, avec Daphné Serelle, une association qui organise des ateliers d'intervention et de sensibilisation par le cinéma.
Réalisateur, monteur et producteur, Berni Goldblat soutient des films sous des formes diverses et crée sa société, Les Films du Djabadjah, à Bobo-Dioulasso où il vit. Ses multiples réalisations révèlent un regard curieux et incisif sur les réalités du Burkina comme l'indique Ceux de la colline, 2009, qui le fait remarquer en abordant la condition des employés travaillant dans les mines d'or du pays.
Berni Goldblat est en phase avec la culture du Burkina qu'il a épousée ardemment. Ce Suisse, né à Stockholm, en Suède, naturalisé citoyen burkinabé, n'en finit pas d'agiter le monde du cinéma. On le voit partout depuis 2012, écumer les festivals et les financeurs pour "sauver le Ciné Guimbi" de Bobo-Dioulasso. Son association a racheté le terrain de l'ancien cinéma pour bâtir une salle polyvalente grâce à une collecte participative intense qui porte ses fruits.
Derrière ses actions collectives, le cinéaste reprend le dessus avec Wallay. Cette fiction, coproduite en France avec le concours du Ministère de la culture du Burkina, atteste de la capacité de Berni Goldblat à proposer un film tout public, attrayant et porteur de valeurs. Il suit Ady, un jeune noir de la banlieue lyonnaise, envoyé par son père à Gaoua, au sud-ouest du Burkina, pour apprendre la vie chez son oncle et sa famille.
L'oncle est décidé à casser son insolence, l'initier pour le faire changer. Le garçon se rebelle, découvrant la vie locale, guidé par son cousin, touché par l'affection de sa grand-mère qu'on l'envoie visiter. L'oncle veut le faire travailler à la pêche pour qu'il rembourse des dettes et apprenne la dignité. Ady s'amende, sensible au charme de sa cousine, à la simplicité du monde rural.
Berni Goldblat revient sur cette immersion dans le Burkina profond et explique le montage de sa coproduction africaine tonique, très demandée sur les écrans.
- Pourquoi le film s'intitule Wallay ?
C'est une expression qu'on utilise très souvent en Afrique de l'Ouest : au Sénégal, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Elle vient de l'arabe et veut dire : "Je prends Dieu à témoin. Je te jure, c'est vrai". On met ce mot à la fin des phrases pour renforcer le propos. C'est un mot qu'on utilise aussi en France, dans les banlieues. Mon personnage principal le dit assez souvent et pour moi, c'était une évidence : c'est un titre de film, facile à se souvenir. D'ailleurs, c'est un mot que j'utilise tout le temps. Les gens qui me connaissent sourient quand ils voient que j'ai fait un film qui a ce titre.
- C'est un titre positif ?
Absolument. Ça me ressemble un peu.
- Pourquoi avoir situé le film entre deux continents, dans la banlieue lyonnaise et dans un village reculé du Burkina ?
Ce qui m'intéresse depuis plusieurs années, c'est la question de l'identité et du métissage. Je suis moi-même métis culturel. Je suis né en Suède, mon père était polonais, ma mère suisse. J'ai vécu en Suisse et passé ces 25 dernières années en Afrique de l'Ouest. Je me pose pas mal de questions sur ce qu'on est, ce qu'on devient après avoir connu et embrassé plusieurs cultures. Ce qui m'intéressait dans Wallay, c'est la dialectique Nord - Sud. C'est un gamin de la deuxième génération, qui a 13 ans, qui est métis. Il sait qu'il est à moitié africain mais il a toujours vécu en France. Par un malentendu, il pense qu'il part en vacances dans la famille de son père mais celui-ci a manigancé un coup parce qu'il ne sait plus comment le tenir. L'idée, c'est qu'il soit dressé dans sa famille. Ce qui m'intéressait, c'est le voyage du Nord au Sud, pour retrouver ses origines, savoir qui il est. C'est en quelque sorte un voyage initiatique.
- Comment ce déplacement peut-il modifier la considération pour le rôle de la famille ?
C'est un regard sur l'éducation aussi. Je n'avais pas envie de tomber dans le piège d'un endroit idéalisé par rapport à un autre. Là, on parle d'un gamin qui n'a plus de mère, qui vit seul avec son père. On en sait assez peu car le film part très vite en Afrique. Au bout de deux minutes trente, on est déjà arrivé sur le tarmac de Bobo-Dioulasso. Tout au long du film, on sent qu'il a un manque. Au départ, il ne comprend rien, il n'a pas les codes, il est dans la représentation. Au mieux, il accepte sans comprendre et au pire, il rejette parce que ça le dépasse. Celle par qui il va retrouver ses origines, sa famille, c'est le personnage de la grand-mère. Quand il se réveille pour la première fois, dans la maison où son père est né, j'ai voulu le mettre en scène comme une naissance pour une renaissance, la maison symbolisant un peu un ventre, avec la musique de Vincent Ségal. Le film tourne autour de la rencontre avec la grand-mère qui est le personnage objectivement le plus éloigné de lui puisqu'elle est vieille, ne parle pas le français mais le dioula. Finalement, ce sont les deux personnes qui vont se rapprocher. C'est par elle que l'initiation a réellement lieu, la découverte de qui il est.
- Elle dit une phrase qui interpelle : " Hélas, de nos jours, on est plus le fils de son époque que celui de son père ". C'est pour rectifier ça que vous envoyez ce gamin dans un village rural du Burkina ?
C'est vrai que cette phrase est importante et interpelle. Pour la grand-mère, même s'ils ne se comprennent pas, s'il est né loin de là, c'est important qu'il reste pour connaître qui il est, savoir d'où il vient. Ce qu'elle veut dire, c'est que le petit a peut-être été plus élevé par le quartier de Vaulx-en-Velin que par son papa, ou sa mère. À cause de ça, elle a beaucoup d'empathie pour lui donc elle ne le juge pas, elle n'a pas d'aversion. Au contraire, elle l'aime. Elle le prend tel qu'il est, et lui n'a pas d'autre choix que de se laisser embrasser, de se laisser emporter par cette tendresse, cette acceptation, cette tolérance aussi.
- N'y a-t-il pas une opposition avec ce qu'il a vécu dans une banlieue française, où on est plutôt seul, avec les copains, où les règles et les valeurs sont un peu dispersées ? Quand on est concentré dans la famille africaine, vous abordez toutes les règles avec le personnage du grand-père qui structure la famille ou tente de le faire, et tout ce maillage de rapports entre ses membres. Pourquoi souligner ainsi ce contraste ?
En fait, la banlieue d'où vient Ady, c'est son village avec ses codes, ses repères. Puis, il arrive dans cette cour familiale africaine banale. Celui qui connaît l'Afrique sait que c'est comme ça qu'on vit avec des maisons et un grand espace commun, au milieu, où on mange, on passe du temps ensemble. Il y a des places assez figées d'où le personnage de l'oncle qui représente l'autorité, le patriarcat, qui, par moments aussi, dysfonctionne. C'est ce que montre le film. Malgré sa stature de donneur de leçons, il se retrouve comme un gros menteur. Finalement, c'est le mensonge de l'oncle qui fait qu'il tombe à l'eau et que le petit s'initie en le sauvant, et non par d'autres rituels qui sont plus ancestraux et un peu figés. Le propos du film est aussi de dire que l'initiation peut se passer de différentes manières et qu'on ne grandit pas uniquement en suivant des dogmes, écrits il y a plus de 2 000 ans. L'être humain a sa place en tant qu'individu. Mais c'est vrai que des fois, en Afrique, c'est plus difficile parce que l'individu a plus de mal à exister dans une communauté.
- Cette autorité patriarcale, faut-il la pousser, la déboulonner, la jeter à l'eau pour repartir sur autre chose ?
Des fois oui, pourquoi pas. C'est ce qu'on appelle une révolution. Mais dans mon film, ce n'est pas vraiment ça… L'oncle tombe à l'eau de lui-même… La tradition a de bonnes choses, et des mauvaises qu'il faut mettre de côté, balayer. Tout au long du récit, on se rend compte que Ady s'attache à des individus : sa grand-mère, sa cousine toujours un peu omniprésente qui est la copine de Jean. Lui, c'est une figure très importante parce qu'il représente aussi le grand frère, cette jeunesse qui est instruite mais qui est aussi le cul entre deux chaises. Jean est entre l'oncle Amadou et Ady qu'il comprend très bien. Ce sont des gens auxquels Ady s'attache sans parler de Yéli, sa petite copine, flirt des vacances. Tout ça fait qu'il avance et aura un vrai ancrage. D'où cette lettre au début du film, qu'il écrit à Yéli, et où il demande des nouvelles de la grand-mère.
Élaborer un récit sur la durée
- Cette scène indique que tout le film est un flash-back. Pourquoi cette construction ?
Au départ, le film n'a pas été tourné de cette manière. C'est au montage qu'on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose au début, qu'on s'attachait un peu trop tard à l'enfant. On était trop longtemps dans la représentation et du coup, j'avais besoin qu'on sente immédiatement qu'on a affaire à un gamin qui a une intériorité, qu'on entende sa voix, que le spectateur puisse être avec lui, dans son cerveau dès le départ, quitte à le lâcher après dans les rues de Vaulx-en-Vélin, quand il arrive dans la cour à Gaoua, ou avec ses histoires de poste… Dès le départ, on s'attache à quelqu'un qui est lui-même attaché à quelque chose et à des gens. C'est venu assez tard dans le montage, et on a refait des plans pour ça.
- Comment est né le scénario ?
À la base, il a été écrit il y a dix ans, par David Bouchet, le scénariste de La Pirogue, puis il est passé entre les mains de Gahité Fofana qui l'a adapté et me l'a passé. Donc il a été réécrit à plusieurs reprises et le film qui existe aujourd'hui est loin du projet original mais reste dans son intention. Puis, ça a beaucoup évolué au tournage, en particulier pour les dialogues, et au montage ça a été autre chose. C'est le travail du cinéma.
- Ce n'est pas un problème de partir d'un scénario pour arriver à quelque chose de différent ?
Au contraire, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps sur ce projet. Quand il sort en France, en juin 2017, cela fait sept ans que j'ai eu le scénario pour la première fois entre les mains. Entretemps, j'ai travaillé, fait d'autres choses et j'ai évolué pendant ces sept ans avec le scénario. Si je l'avais tourné il y a quatre ans comme ça aurait dû se faire, je pense que le film n'aurait pas été aussi abouti qu'aujourd'hui. C'est un travail de maturité.
Produire en cumulant les moyens
- Comment s'est fait le montage financier de Wallay ?
Au départ, le projet a été soutenu par la Suisse. C'était une coproduction Burkina - Suisse. Mais il n'y a pas eu assez d'argent réuni en Suisse, et on a cherché une coproduction en France. Le temps a tellement passé que les fonds suisses n'étaient plus disponibles car les délais n'ont pu être respectés. Du coup, c'est une production France - Burkina. Les Films du Djabadjah, ma boîte basée à Bobo-Dioulasso, assure la coproduction avec la société Bathysphère productions, basée à Paris. On a véritablement une coproduction. Les Films du Djabadjah ont apporté une certaine somme et ont les droits au Burkina. Bathysphère a les droits pour la France et le reste du monde. C'est un partage à 65 - 35 %.
- Quelles aides institutionnelles avez-vous obtenues ?
On a eu l'Avance sur recettes du CNC, une belle nouvelle qui nous a apporté 450 000 euros, puis Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, TV5 Monde, obtenu depuis le départ par Les Films du Djabadjah, Doha Film Institute, au Qatar, qui nous a aidés pour la post production. On a eu l'OIF à travers le fonds de l'Atelier Takmil en Tunisie, lié aux Journées Cinématographiques de Carthage. Rezo films qui distribue Wallay, est aussi producteur et a mis de l'argent dans le tournage. Et comme chaîne télé, on a Canal Plus. L'État du Burkina Faso a participé via son Ministère de la Culture. Donc on a réussi à faire un montage financier fragile même si on n'est pas parvenu au budget initial. Ce n'était pas facile, c'était une équipe mixte. Il y avait beaucoup de techniciens burkinabés mais aussi des Français imposés pour des raisons de financements. Le plateau était aussi métissé que le film peut l'être. On avait des Burkinabés, des Maliens, des Ivoiriens, des Béninois, des Sénégalais, des Français. Tout ce petit monde a dû travailler ensemble pendant presque deux mois et demi. C'était intense !
- Globalement, vous arrivez à un budget de combien pour Wallay ?
À peu près 850 000 euros [environ 557,56 millions francs cfa, ndlr]. On a tourné 32 jours dont 28 au Burkina et 4 en France qui se résument finalement à deux minutes trente dans le film. On aurait pu en faire un quart d'heure mais ça ne fonctionnait pas car il fallait vite qu'on arrive au Burkina. J'avais aussi assez peur de la représentation de la banlieue avec ce que ça peut colporter comme images. Je n'avais pas envie qu'on risque de se tromper de film. Je préférais qu'on emmène le spectateur comme on emmène Ady, au Burkina et qu'on découvre avec lui, à travers ses yeux, ses origines.
Une histoire de vécu
- C'est quelque chose qui vous est personnel, cette plongée presque brusque, profonde, dans le Burkina ?
Oui, c'est un mélange de pas mal d'expériences que j'ai eu à vivre entre la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali. À 20 ans, je suis parti à l'aventure et j'ai dû aussi me confronter à moi-même, sans avoir de choix. Évidemment, il y a énormément de petites choses dans le film qui sont vécues. Je tenais aussi à ce que le film soit raconté de la manière la plus réelle possible dans sa mise en scène, son tournage. Je viens plutôt de la famille du documentaire, c'est mon premier long-métrage de fiction cinéma. Je puise beaucoup dans mes expériences documentaires et j'avais besoin de ce réel qui rythme un peu le film. À la Berlinale 2017 où le film a été découvert, on a appelé ça un "docudrama" [docufiction, en français, ndlr], ce qui m'a fait sourire. Mais il y a un peu de ça avec tous ces décors naturels, dans les rues de Gaoua. J'ai essayé de donner aussi beaucoup de liberté aux comédiens et on a changé beaucoup de choses, fait des improvisations par moments, surtout dans les dialogues avec le petit. C'était important que chacun s'approprie le récit au maximum.
- Mais à qui s'adresse en priorité, Wallay ?
Le défi, c'était que ce film puisse parler au public en Occident mais aussi en Afrique et ailleurs. Ayant vécu en Afrique depuis plus de 20 ans, étant d'origine occidentale, j'ai toujours ces regards qui sont un peu mélangés. Quand on a montré Wallay au FESPACO 2017, dans une salle de 500 personnes, j'étais très nerveux, beaucoup plus qu'à Berlin, parce que le film rentrait chez lui, d'une certaine manière. C'était super, le film a été très bien reçu et j'en suis soulagé. On peut voir Wallay à partir de regard de Ady, de celui de Jean, celui de la petite copine…
- A partir de ces différents points de vue, et sur le fonctionnement de la famille à Gaoua, il y a un côté documentaire, presque pédagogique. Avez-vous recherché à montrer comment fonctionne une cellule familiale ?
C'est ma manière de raconter des histoires. J'avais vraiment le souci majeur de rester juste. Et la justesse est parfois dans les détails. Des fois, on a refait des scènes parce que culturellement ça n'allait pas. Par exemple, quand la grand-mère avait une intonation qui ne marchait pas par rapport au gamin… Si je suis pédagogique, je ne l'ai pas vraiment fait exprès. Je voulais que ce soit juste et sobre. Une sobriété que j'ai essayé de rechercher dans la forme.
Un casting multi ethnique
- Qu'est-ce qui a guidé le choix des acteurs ?
L'acteur principal, Makan Nathan Diarra, on l'a trouvé après avoir cherché parmi 80 métis à Paris. On a fait du casting sauvage ou organisé avec des agences. On l'a quasiment rencontré dans la rue, et quand je l'ai vu, j'ai su que c'était Ady. Il m'est arrivé un truc très fort et j'étais sûr de moi. Il avait quelque chose qui m'a frappé le cœur et l'esprit. Pour le rôle de Jean, j'ai cherché au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, puis je me suis dit, il faut que je trouve en France parce que je voulais voir si ça fonctionnait entre le petit et Jean. J'avais besoin qu'ils travaillent au moins six mois au préalable, pour qu'on croit à cette complicité qui se développe au fil du film. J'ai rencontré Ibrahim Koma qui m'a bien plu car j'ai trouvé qu'il a ce calme en lui, cette classe. J'aime beaucoup sa manière de bouger dans l'espace et c'est un vrai comédien professionnel. Jean a beaucoup servi pendant le tournage car il a réellement été un grand frère. Makan l'a tout de suite reconnu pour l'avoir vu dans La Cité rose (de Julien Abraham, 2012), Le Crocodile du Botswanga (de Fabrice Eboué et Lionel Steketeer, 2014) et tous ses films. Il était fier qu'Ibrahim incarne Jean. Il a fallu que Ibrahim apprenne les répliques en dioula car il est franco-malien et parle soninké. Il a fallu qu'il prenne l'accent puis on a fait de la post synchro en postproduction.
- Pourquoi accordez-vous une attention si particulière à la langue ?
C'est une thématique intéressante dans ce film. Je voulais avoir le dioula comme une langue importante et qu'on reste aussi parfois dans une situation où on a besoin d'un traducteur. Là, on touche à quelque chose du réel. Pour moi, c'était important d'être avec le petit parce que lui ne comprend rien. Et la langue fait partie de la culture. À un moment donné, il dit : "Mais moi je ne suis pas d'ici, je ne comprends même pas la langue". Il aurait pu la connaître si le père à Vaulx-en-Velin, lui avait enseigné, ou parlé, le dioula depuis son bas âge. Il aurait eu en lui ce bagage culturel. Même s'il n'était jamais venu au Burkina, s'il était arrivé en parlant le dioula, il aurait eu dans cette langue, l'humour, la compréhension de l'autre, les réflexes, le bagage et l'histoire. Sans le savoir, il l'aurait eu et n'aurait pas été décalé. Je le crois vraiment. Moi, je parle cinq langues, mon père en parlait huit, ma mère était interprète aux conférences donc j'étais toujours baigné dans ces histoires de langues et toujours fasciné par le rôle qu'elle a. Je vois tellement d'Africains en Europe, qui ne transmettent pas leur propre langue à leurs enfants… C'est fou : une langue, c'est gratuit, c'est cadeau, un énorme cadeau…
- Comment marriez-vous des acteurs d'origine malienne comme Hamadoun Kassogué, Habib Dembélé qui a un petit rôle, avec des comédiens du Burkina Faso plus connus comme Georgette Paré ou Abdoulaye Abdoulaye Komboudri, alors que tout est censé se passer au Burkina ?
Je ne l'ai pas exprès mais les premiers rôles comme Makan Nathan Diarra ou Ibrahim Koma, sont franco-maliens, et Hamadoun Kassogué est malien. Lui, je le voulais depuis cinq ans, et ce rôle a été quasiment écrit pour lui. Il parle bambara qui est la même langue que le dioula sauf qu'il y a un accent différent. Sur le tournage, il a fallu casser un peu son accent bambara. À Gaoua, on n'est pas loin du Mali, tout près de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Dans le film, on est chez la famille Traoré qui peut être d'origine malienne, comme d'origine guinéenne. On est dans cette vaste région du Mandé où ça ne gêne pas d'avoir ce métissage, au contraire. Bobo-Dioulasso a été construit par des peuplades qui venaient de Guinée, du Mali, de Côte d'Ivoire. On n'a pas fait quelque chose d'artificiel.
Georgette Paré qui joue Fanta, a été ma directrice de casting pour le Burkina. C'est une amie de longue date. C'est quelqu'un de solide, avec une énorme expérience. C'est la première fois qu'elle tient un rôle comme celui de la tante Fanta parce qu'elle joue plutôt des femmes modernes, même dans les films de Henri Duparc à l'époque. Ce qui était passionnant c'était ce mélange d'amateurs, de professionnels sur le plateau. Abdoulaye Komboudri est pour moi, un des plus grands comédiens du Burkina. Il a joué dans tant de films depuis 30 ans. Il peut faire tous les rôles. Dans Wallay, il est Vieux Somé le guérisseur, qui n'est pas un grand rôle mais qui est très important. Il fallait vraiment qu'il soit juste. À côté, on est avec des filles comme Mounira Kankolé qui est Yéli, la petite copine de Ady. Elle n'a jamais joué au cinéma et je l'ai repérée à Bobo-Dioulasso, un peu par hasard. Il y a aussi Nafi Koné qui fait la cousine et n'a jamais joué. On est dans un métissage de pays et de formations mais je trouve que ça enrichit le propos. Qu'on soit à Bobo-Dioulasso, à Gaoua, à Ségou, la géographie est essentielle mais une fois qu'on y croit, ça va.
Investir sa propre géographie
- Quand on voit le film, on est frappé de voir qu'il y a une mobilité constante de lieux et d'espaces. Wallay est assez découpé avec beaucoup de mouvements dans les plans. Avez-vous recherché ça par effet de style ?
Comme j'aime beaucoup les plans-séquences, avec le chef opérateur, Martin Rit, on a eu de grandes réflexions sur le travail des frères Dardenne, le cinéma du réel… Du coup, on a opté souvent pour le plan-séquence mais heureusement on le sécurisait. On a fait d'autres plans pour dynamiser, et parfois au montage, on coupait le plan-séquence. Donc on a quelques plans-séquences entiers, et d'autres qui sont interrompus. Comme le personnage principal est un peu énervé, on est plus avec lui comme ça. J'avais envie de faire un film de cinéma et pas du champ-contrechamp. Le meilleur plan-séquence pour moi, est celui où Jean s'énerve dans sa maison, et dit à Ady qu'il ne veut pas avoir de problèmes avec ses voisins quand il vend ses objets. Là, on est dans une chorégraphie intéressante où la caméra danse avec ces deux personnages dans un espace réduit, avec une lumière sombre. Il y a très peu de plans sur pied dans le film. Il y en a trois : l'atterrissage de l'avion, un plan droite - gauche quand ils arrivent en moto, et un autre à Gaoua quand le taxi arrive. Sinon tout le reste est fait à l'épaule par Martin Rit. C'était important d'avoir cette caméra qui respire et qui peut à tout moment, bouger de manière organique.
- Comment gérez-vous la mobilité de la caméra alors que vous êtes handicapé et circulez en fauteuil roulant, quand vous dirigez des scènes sur des routes caillouteuses, dans des reliefs escarpés comme quand Ady va voir la grand-mère ?
C'est vrai qu'on a beaucoup tourné dans des endroits difficiles d'accès. Par exemple, le village de la grand-mère, ça a été compliqué pour elle [Joséphine Kaboré, ndlr] qui a 83 ans. Elle ne marche pas très bien et c'était assez escarpé comme vous dites. Pour moi, il a fallu trouver des porteurs pour certains endroits. C'était compliqué aussi de tourner sur le lac, dans des pirogues. Moi, j'ai toujours tendance à ne pas voir de limites à mon propre travail. Quand j'ai tourné Ceux de la colline, les gens rigolaient sur le plateau en disant que je cherche toujours des coins impossibles. C'est vrai que pour ce film-là, j'ai passé un mois sur un lieu difficile d'accès à tous les niveaux. Il y a un peu de ça dans Wallay mais ce qui s'est passé, c'est que nos décors nous ont été interdits à deux mois du tournage. Le 15 janvier 2016, il y a eu les attaques djihadistes à Ouagadougou qui ont changé la donne et enterré tous les décors que j'avais préparés depuis deux ans, dans la région de Sindou, à la frontière du Mali et de la Côte d'Ivoire. Il a fallu prendre la voiture et chercher d'autres décors jusqu'à l'intérieur du Bénin. Le Ministère français des Affaires étrangères, l'Institut français, l'ambassade de France, même la DASS qui donnait les autorisations pour la venue du garçon, nous avaient donné pour consigne de pas tout tourner au même endroit. Des fois, quand on est obligé, on trouve autre chose de mieux et je ne regrette aucun décor. Par exemple, le lac est à 700 kilomètres de Gaoua alors que dans le film, il est censé être à 20 minutes de moto. On a reconstitué une géographie propre au film.
Un film pour diversifier l'engagement
- Wallay se situerait donc dans la lignée des films que vous avez faits, plutôt documentaires, pris sur le vif et qui travaillent le réel avec les gens. Serait-ce un style personnel ?
J'ai la sensation d'être un jeune cinéaste donc je n'ai encore envie de jeter un regard sur ma filmographie et de tirer des conclusions. Je m'intéresse beaucoup à l'Histoire et il n'est pas exclu que je traite de choses qui ne se passent pas forcément aujourd'hui.
- Il semble vous ayez mis en veilleuse vos activités à Cinomade comme le tournage de films d'intervention, pour vous occuper du Ciné Guimbi. Maintenant que Wallay est terminé, de quoi allez-vous vous occuper : la construction de cette salle à Bobo-Dioulasso ou la réalisation d'un autre film ?
Je n'ai jamais laissé la construction de la salle même si j'ai dû m'absenter pendant le tournage. Je suis au quotidien avec l'équipe du Ciné Guimbi pour cette lutte phénoménale qui consiste à le faire renaître sur les cendres de l'ancienne salle. Je suis le président de l'association de soutien du cinéma au Burkina Faso qui porte ce projet. J'assure des rendez-vous au Festival de Cannes 2017 pour ça, pendant que j'accompagne des projections de Wallay à Cannes Junior. Donc ce ne sont pas des choses antinomiques mais qu'on peut faire ensemble. Bien sûr, quand on tourne un film, on ne fait que ça. On oublie tout y compris la famille… Mais ça ne dure que deux mois. Le reste du temps, je me consacre beaucoup au Ciné Guimbi et j'y tiens. Le rêve, ce serait de projeter Wallay au Ciné Guimbi. La boucle serait bouclée. Cinomade continue ses activités de sensibilisation et je les suis. Je suis moins présent mais je suis toujours dans le bureau. Mon objectif est de faire un autre film. J'ai des idées, je réfléchis, je lis. Ça reste encore très embryonnaire car Wallay vient de sortir en février, je vais l'accompagner pendant quelques temps. Quand j'étais à Berlin, j'ai été reçu par l'ambassadeur du Burkina Faso qui m'a dit : " Votre film fait beaucoup mieux le travail que moi, en tant qu'ambassadeur, pour le pays. "
- Quelle a été la meilleure expérience de Wallay pour vous ?
Je suis très content des comédiens et très fier de la musique. Avec Vincent Ségal qui l'a composée, ça a été une aventure. Il a intégré le film qu'il a adoré dès le départ. Il a vu le film un grand nombre de fois pour que, quand on est rentré en studio, le 13 janvier 2017, on fasse une journée de 12 heures où il a tout enregistré, d'un coup. J'étais là et c'était quasiment du live. Cette musique apporte quelque chose dans la sobriété. J'avais besoin d'une musique qui sorte du vent, qui se confonde aux bruits des feuilles, une musique douce, tendre, qui par moments, ait des résonances comme celle de la kora. Je n'avais pas envie que ce soit trop connoté africain et des fois, on part dans de la musique presque tzigane, gitane, après on revient vers quelque chose de beaucoup plus simple avec des cordes. La musique du générique du début est aussi un hommage à Victor Démé, disparu en 2015, un grand musicien burkinabé. Et Wallay est aussi dédié à mes parents. Il y a une dédicace pour eux parce qu'ils sont décédés dans la période de fabrication du film.
- C'est donc un hommage à la famille, aux ancêtres, aux parents…
Exactement. Quand on a tourné la séquence très sobre des au-revoir avec la grand-mère, à la fin du film, la moitié du plateau était en pleurs. C'était vraiment fort. Cette scène m'a totalement bouleversé. Quand on a quitté le plateau, c'était une évidence que ce film, je le dédie aux parents. C'est un hommage à la famille, c'est clair. La grande famille, celle qu'on subit, celle qu'on choisit…
par Michel AMARGER
Africiné Magazine / Paris
pour Images Francophones
en collaboration avec Africultures
Lire la critique du film : Wallay - Initiation vitale au Burkina, par Michel Amarger (Africiné Magazine)
Image : Berni Goldblat, réalisateur/producteur burkinabè
Crédit : gracieuseté Berlinale 2017
Réalisateur, monteur et producteur, Berni Goldblat soutient des films sous des formes diverses et crée sa société, Les Films du Djabadjah, à Bobo-Dioulasso où il vit. Ses multiples réalisations révèlent un regard curieux et incisif sur les réalités du Burkina comme l'indique Ceux de la colline, 2009, qui le fait remarquer en abordant la condition des employés travaillant dans les mines d'or du pays.
Berni Goldblat est en phase avec la culture du Burkina qu'il a épousée ardemment. Ce Suisse, né à Stockholm, en Suède, naturalisé citoyen burkinabé, n'en finit pas d'agiter le monde du cinéma. On le voit partout depuis 2012, écumer les festivals et les financeurs pour "sauver le Ciné Guimbi" de Bobo-Dioulasso. Son association a racheté le terrain de l'ancien cinéma pour bâtir une salle polyvalente grâce à une collecte participative intense qui porte ses fruits.
Derrière ses actions collectives, le cinéaste reprend le dessus avec Wallay. Cette fiction, coproduite en France avec le concours du Ministère de la culture du Burkina, atteste de la capacité de Berni Goldblat à proposer un film tout public, attrayant et porteur de valeurs. Il suit Ady, un jeune noir de la banlieue lyonnaise, envoyé par son père à Gaoua, au sud-ouest du Burkina, pour apprendre la vie chez son oncle et sa famille.
L'oncle est décidé à casser son insolence, l'initier pour le faire changer. Le garçon se rebelle, découvrant la vie locale, guidé par son cousin, touché par l'affection de sa grand-mère qu'on l'envoie visiter. L'oncle veut le faire travailler à la pêche pour qu'il rembourse des dettes et apprenne la dignité. Ady s'amende, sensible au charme de sa cousine, à la simplicité du monde rural.
Berni Goldblat revient sur cette immersion dans le Burkina profond et explique le montage de sa coproduction africaine tonique, très demandée sur les écrans.
- Pourquoi le film s'intitule Wallay ?
C'est une expression qu'on utilise très souvent en Afrique de l'Ouest : au Sénégal, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Elle vient de l'arabe et veut dire : "Je prends Dieu à témoin. Je te jure, c'est vrai". On met ce mot à la fin des phrases pour renforcer le propos. C'est un mot qu'on utilise aussi en France, dans les banlieues. Mon personnage principal le dit assez souvent et pour moi, c'était une évidence : c'est un titre de film, facile à se souvenir. D'ailleurs, c'est un mot que j'utilise tout le temps. Les gens qui me connaissent sourient quand ils voient que j'ai fait un film qui a ce titre.
- C'est un titre positif ?
Absolument. Ça me ressemble un peu.
- Pourquoi avoir situé le film entre deux continents, dans la banlieue lyonnaise et dans un village reculé du Burkina ?
Ce qui m'intéresse depuis plusieurs années, c'est la question de l'identité et du métissage. Je suis moi-même métis culturel. Je suis né en Suède, mon père était polonais, ma mère suisse. J'ai vécu en Suisse et passé ces 25 dernières années en Afrique de l'Ouest. Je me pose pas mal de questions sur ce qu'on est, ce qu'on devient après avoir connu et embrassé plusieurs cultures. Ce qui m'intéressait dans Wallay, c'est la dialectique Nord - Sud. C'est un gamin de la deuxième génération, qui a 13 ans, qui est métis. Il sait qu'il est à moitié africain mais il a toujours vécu en France. Par un malentendu, il pense qu'il part en vacances dans la famille de son père mais celui-ci a manigancé un coup parce qu'il ne sait plus comment le tenir. L'idée, c'est qu'il soit dressé dans sa famille. Ce qui m'intéressait, c'est le voyage du Nord au Sud, pour retrouver ses origines, savoir qui il est. C'est en quelque sorte un voyage initiatique.
- Comment ce déplacement peut-il modifier la considération pour le rôle de la famille ?
C'est un regard sur l'éducation aussi. Je n'avais pas envie de tomber dans le piège d'un endroit idéalisé par rapport à un autre. Là, on parle d'un gamin qui n'a plus de mère, qui vit seul avec son père. On en sait assez peu car le film part très vite en Afrique. Au bout de deux minutes trente, on est déjà arrivé sur le tarmac de Bobo-Dioulasso. Tout au long du film, on sent qu'il a un manque. Au départ, il ne comprend rien, il n'a pas les codes, il est dans la représentation. Au mieux, il accepte sans comprendre et au pire, il rejette parce que ça le dépasse. Celle par qui il va retrouver ses origines, sa famille, c'est le personnage de la grand-mère. Quand il se réveille pour la première fois, dans la maison où son père est né, j'ai voulu le mettre en scène comme une naissance pour une renaissance, la maison symbolisant un peu un ventre, avec la musique de Vincent Ségal. Le film tourne autour de la rencontre avec la grand-mère qui est le personnage objectivement le plus éloigné de lui puisqu'elle est vieille, ne parle pas le français mais le dioula. Finalement, ce sont les deux personnes qui vont se rapprocher. C'est par elle que l'initiation a réellement lieu, la découverte de qui il est.
- Elle dit une phrase qui interpelle : " Hélas, de nos jours, on est plus le fils de son époque que celui de son père ". C'est pour rectifier ça que vous envoyez ce gamin dans un village rural du Burkina ?
C'est vrai que cette phrase est importante et interpelle. Pour la grand-mère, même s'ils ne se comprennent pas, s'il est né loin de là, c'est important qu'il reste pour connaître qui il est, savoir d'où il vient. Ce qu'elle veut dire, c'est que le petit a peut-être été plus élevé par le quartier de Vaulx-en-Velin que par son papa, ou sa mère. À cause de ça, elle a beaucoup d'empathie pour lui donc elle ne le juge pas, elle n'a pas d'aversion. Au contraire, elle l'aime. Elle le prend tel qu'il est, et lui n'a pas d'autre choix que de se laisser embrasser, de se laisser emporter par cette tendresse, cette acceptation, cette tolérance aussi.
- N'y a-t-il pas une opposition avec ce qu'il a vécu dans une banlieue française, où on est plutôt seul, avec les copains, où les règles et les valeurs sont un peu dispersées ? Quand on est concentré dans la famille africaine, vous abordez toutes les règles avec le personnage du grand-père qui structure la famille ou tente de le faire, et tout ce maillage de rapports entre ses membres. Pourquoi souligner ainsi ce contraste ?
En fait, la banlieue d'où vient Ady, c'est son village avec ses codes, ses repères. Puis, il arrive dans cette cour familiale africaine banale. Celui qui connaît l'Afrique sait que c'est comme ça qu'on vit avec des maisons et un grand espace commun, au milieu, où on mange, on passe du temps ensemble. Il y a des places assez figées d'où le personnage de l'oncle qui représente l'autorité, le patriarcat, qui, par moments aussi, dysfonctionne. C'est ce que montre le film. Malgré sa stature de donneur de leçons, il se retrouve comme un gros menteur. Finalement, c'est le mensonge de l'oncle qui fait qu'il tombe à l'eau et que le petit s'initie en le sauvant, et non par d'autres rituels qui sont plus ancestraux et un peu figés. Le propos du film est aussi de dire que l'initiation peut se passer de différentes manières et qu'on ne grandit pas uniquement en suivant des dogmes, écrits il y a plus de 2 000 ans. L'être humain a sa place en tant qu'individu. Mais c'est vrai que des fois, en Afrique, c'est plus difficile parce que l'individu a plus de mal à exister dans une communauté.
- Cette autorité patriarcale, faut-il la pousser, la déboulonner, la jeter à l'eau pour repartir sur autre chose ?
Des fois oui, pourquoi pas. C'est ce qu'on appelle une révolution. Mais dans mon film, ce n'est pas vraiment ça… L'oncle tombe à l'eau de lui-même… La tradition a de bonnes choses, et des mauvaises qu'il faut mettre de côté, balayer. Tout au long du récit, on se rend compte que Ady s'attache à des individus : sa grand-mère, sa cousine toujours un peu omniprésente qui est la copine de Jean. Lui, c'est une figure très importante parce qu'il représente aussi le grand frère, cette jeunesse qui est instruite mais qui est aussi le cul entre deux chaises. Jean est entre l'oncle Amadou et Ady qu'il comprend très bien. Ce sont des gens auxquels Ady s'attache sans parler de Yéli, sa petite copine, flirt des vacances. Tout ça fait qu'il avance et aura un vrai ancrage. D'où cette lettre au début du film, qu'il écrit à Yéli, et où il demande des nouvelles de la grand-mère.
Élaborer un récit sur la durée
- Cette scène indique que tout le film est un flash-back. Pourquoi cette construction ?
Au départ, le film n'a pas été tourné de cette manière. C'est au montage qu'on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose au début, qu'on s'attachait un peu trop tard à l'enfant. On était trop longtemps dans la représentation et du coup, j'avais besoin qu'on sente immédiatement qu'on a affaire à un gamin qui a une intériorité, qu'on entende sa voix, que le spectateur puisse être avec lui, dans son cerveau dès le départ, quitte à le lâcher après dans les rues de Vaulx-en-Vélin, quand il arrive dans la cour à Gaoua, ou avec ses histoires de poste… Dès le départ, on s'attache à quelqu'un qui est lui-même attaché à quelque chose et à des gens. C'est venu assez tard dans le montage, et on a refait des plans pour ça.
- Comment est né le scénario ?
À la base, il a été écrit il y a dix ans, par David Bouchet, le scénariste de La Pirogue, puis il est passé entre les mains de Gahité Fofana qui l'a adapté et me l'a passé. Donc il a été réécrit à plusieurs reprises et le film qui existe aujourd'hui est loin du projet original mais reste dans son intention. Puis, ça a beaucoup évolué au tournage, en particulier pour les dialogues, et au montage ça a été autre chose. C'est le travail du cinéma.
- Ce n'est pas un problème de partir d'un scénario pour arriver à quelque chose de différent ?
Au contraire, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps sur ce projet. Quand il sort en France, en juin 2017, cela fait sept ans que j'ai eu le scénario pour la première fois entre les mains. Entretemps, j'ai travaillé, fait d'autres choses et j'ai évolué pendant ces sept ans avec le scénario. Si je l'avais tourné il y a quatre ans comme ça aurait dû se faire, je pense que le film n'aurait pas été aussi abouti qu'aujourd'hui. C'est un travail de maturité.
Produire en cumulant les moyens
- Comment s'est fait le montage financier de Wallay ?
Au départ, le projet a été soutenu par la Suisse. C'était une coproduction Burkina - Suisse. Mais il n'y a pas eu assez d'argent réuni en Suisse, et on a cherché une coproduction en France. Le temps a tellement passé que les fonds suisses n'étaient plus disponibles car les délais n'ont pu être respectés. Du coup, c'est une production France - Burkina. Les Films du Djabadjah, ma boîte basée à Bobo-Dioulasso, assure la coproduction avec la société Bathysphère productions, basée à Paris. On a véritablement une coproduction. Les Films du Djabadjah ont apporté une certaine somme et ont les droits au Burkina. Bathysphère a les droits pour la France et le reste du monde. C'est un partage à 65 - 35 %.
- Quelles aides institutionnelles avez-vous obtenues ?
On a eu l'Avance sur recettes du CNC, une belle nouvelle qui nous a apporté 450 000 euros, puis Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, TV5 Monde, obtenu depuis le départ par Les Films du Djabadjah, Doha Film Institute, au Qatar, qui nous a aidés pour la post production. On a eu l'OIF à travers le fonds de l'Atelier Takmil en Tunisie, lié aux Journées Cinématographiques de Carthage. Rezo films qui distribue Wallay, est aussi producteur et a mis de l'argent dans le tournage. Et comme chaîne télé, on a Canal Plus. L'État du Burkina Faso a participé via son Ministère de la Culture. Donc on a réussi à faire un montage financier fragile même si on n'est pas parvenu au budget initial. Ce n'était pas facile, c'était une équipe mixte. Il y avait beaucoup de techniciens burkinabés mais aussi des Français imposés pour des raisons de financements. Le plateau était aussi métissé que le film peut l'être. On avait des Burkinabés, des Maliens, des Ivoiriens, des Béninois, des Sénégalais, des Français. Tout ce petit monde a dû travailler ensemble pendant presque deux mois et demi. C'était intense !
- Globalement, vous arrivez à un budget de combien pour Wallay ?
À peu près 850 000 euros [environ 557,56 millions francs cfa, ndlr]. On a tourné 32 jours dont 28 au Burkina et 4 en France qui se résument finalement à deux minutes trente dans le film. On aurait pu en faire un quart d'heure mais ça ne fonctionnait pas car il fallait vite qu'on arrive au Burkina. J'avais aussi assez peur de la représentation de la banlieue avec ce que ça peut colporter comme images. Je n'avais pas envie qu'on risque de se tromper de film. Je préférais qu'on emmène le spectateur comme on emmène Ady, au Burkina et qu'on découvre avec lui, à travers ses yeux, ses origines.
Une histoire de vécu
- C'est quelque chose qui vous est personnel, cette plongée presque brusque, profonde, dans le Burkina ?
Oui, c'est un mélange de pas mal d'expériences que j'ai eu à vivre entre la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali. À 20 ans, je suis parti à l'aventure et j'ai dû aussi me confronter à moi-même, sans avoir de choix. Évidemment, il y a énormément de petites choses dans le film qui sont vécues. Je tenais aussi à ce que le film soit raconté de la manière la plus réelle possible dans sa mise en scène, son tournage. Je viens plutôt de la famille du documentaire, c'est mon premier long-métrage de fiction cinéma. Je puise beaucoup dans mes expériences documentaires et j'avais besoin de ce réel qui rythme un peu le film. À la Berlinale 2017 où le film a été découvert, on a appelé ça un "docudrama" [docufiction, en français, ndlr], ce qui m'a fait sourire. Mais il y a un peu de ça avec tous ces décors naturels, dans les rues de Gaoua. J'ai essayé de donner aussi beaucoup de liberté aux comédiens et on a changé beaucoup de choses, fait des improvisations par moments, surtout dans les dialogues avec le petit. C'était important que chacun s'approprie le récit au maximum.
- Mais à qui s'adresse en priorité, Wallay ?
Le défi, c'était que ce film puisse parler au public en Occident mais aussi en Afrique et ailleurs. Ayant vécu en Afrique depuis plus de 20 ans, étant d'origine occidentale, j'ai toujours ces regards qui sont un peu mélangés. Quand on a montré Wallay au FESPACO 2017, dans une salle de 500 personnes, j'étais très nerveux, beaucoup plus qu'à Berlin, parce que le film rentrait chez lui, d'une certaine manière. C'était super, le film a été très bien reçu et j'en suis soulagé. On peut voir Wallay à partir de regard de Ady, de celui de Jean, celui de la petite copine…
- A partir de ces différents points de vue, et sur le fonctionnement de la famille à Gaoua, il y a un côté documentaire, presque pédagogique. Avez-vous recherché à montrer comment fonctionne une cellule familiale ?
C'est ma manière de raconter des histoires. J'avais vraiment le souci majeur de rester juste. Et la justesse est parfois dans les détails. Des fois, on a refait des scènes parce que culturellement ça n'allait pas. Par exemple, quand la grand-mère avait une intonation qui ne marchait pas par rapport au gamin… Si je suis pédagogique, je ne l'ai pas vraiment fait exprès. Je voulais que ce soit juste et sobre. Une sobriété que j'ai essayé de rechercher dans la forme.
Un casting multi ethnique
- Qu'est-ce qui a guidé le choix des acteurs ?
L'acteur principal, Makan Nathan Diarra, on l'a trouvé après avoir cherché parmi 80 métis à Paris. On a fait du casting sauvage ou organisé avec des agences. On l'a quasiment rencontré dans la rue, et quand je l'ai vu, j'ai su que c'était Ady. Il m'est arrivé un truc très fort et j'étais sûr de moi. Il avait quelque chose qui m'a frappé le cœur et l'esprit. Pour le rôle de Jean, j'ai cherché au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, puis je me suis dit, il faut que je trouve en France parce que je voulais voir si ça fonctionnait entre le petit et Jean. J'avais besoin qu'ils travaillent au moins six mois au préalable, pour qu'on croit à cette complicité qui se développe au fil du film. J'ai rencontré Ibrahim Koma qui m'a bien plu car j'ai trouvé qu'il a ce calme en lui, cette classe. J'aime beaucoup sa manière de bouger dans l'espace et c'est un vrai comédien professionnel. Jean a beaucoup servi pendant le tournage car il a réellement été un grand frère. Makan l'a tout de suite reconnu pour l'avoir vu dans La Cité rose (de Julien Abraham, 2012), Le Crocodile du Botswanga (de Fabrice Eboué et Lionel Steketeer, 2014) et tous ses films. Il était fier qu'Ibrahim incarne Jean. Il a fallu que Ibrahim apprenne les répliques en dioula car il est franco-malien et parle soninké. Il a fallu qu'il prenne l'accent puis on a fait de la post synchro en postproduction.
- Pourquoi accordez-vous une attention si particulière à la langue ?
C'est une thématique intéressante dans ce film. Je voulais avoir le dioula comme une langue importante et qu'on reste aussi parfois dans une situation où on a besoin d'un traducteur. Là, on touche à quelque chose du réel. Pour moi, c'était important d'être avec le petit parce que lui ne comprend rien. Et la langue fait partie de la culture. À un moment donné, il dit : "Mais moi je ne suis pas d'ici, je ne comprends même pas la langue". Il aurait pu la connaître si le père à Vaulx-en-Velin, lui avait enseigné, ou parlé, le dioula depuis son bas âge. Il aurait eu en lui ce bagage culturel. Même s'il n'était jamais venu au Burkina, s'il était arrivé en parlant le dioula, il aurait eu dans cette langue, l'humour, la compréhension de l'autre, les réflexes, le bagage et l'histoire. Sans le savoir, il l'aurait eu et n'aurait pas été décalé. Je le crois vraiment. Moi, je parle cinq langues, mon père en parlait huit, ma mère était interprète aux conférences donc j'étais toujours baigné dans ces histoires de langues et toujours fasciné par le rôle qu'elle a. Je vois tellement d'Africains en Europe, qui ne transmettent pas leur propre langue à leurs enfants… C'est fou : une langue, c'est gratuit, c'est cadeau, un énorme cadeau…
- Comment marriez-vous des acteurs d'origine malienne comme Hamadoun Kassogué, Habib Dembélé qui a un petit rôle, avec des comédiens du Burkina Faso plus connus comme Georgette Paré ou Abdoulaye Abdoulaye Komboudri, alors que tout est censé se passer au Burkina ?
Je ne l'ai pas exprès mais les premiers rôles comme Makan Nathan Diarra ou Ibrahim Koma, sont franco-maliens, et Hamadoun Kassogué est malien. Lui, je le voulais depuis cinq ans, et ce rôle a été quasiment écrit pour lui. Il parle bambara qui est la même langue que le dioula sauf qu'il y a un accent différent. Sur le tournage, il a fallu casser un peu son accent bambara. À Gaoua, on n'est pas loin du Mali, tout près de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Dans le film, on est chez la famille Traoré qui peut être d'origine malienne, comme d'origine guinéenne. On est dans cette vaste région du Mandé où ça ne gêne pas d'avoir ce métissage, au contraire. Bobo-Dioulasso a été construit par des peuplades qui venaient de Guinée, du Mali, de Côte d'Ivoire. On n'a pas fait quelque chose d'artificiel.
Georgette Paré qui joue Fanta, a été ma directrice de casting pour le Burkina. C'est une amie de longue date. C'est quelqu'un de solide, avec une énorme expérience. C'est la première fois qu'elle tient un rôle comme celui de la tante Fanta parce qu'elle joue plutôt des femmes modernes, même dans les films de Henri Duparc à l'époque. Ce qui était passionnant c'était ce mélange d'amateurs, de professionnels sur le plateau. Abdoulaye Komboudri est pour moi, un des plus grands comédiens du Burkina. Il a joué dans tant de films depuis 30 ans. Il peut faire tous les rôles. Dans Wallay, il est Vieux Somé le guérisseur, qui n'est pas un grand rôle mais qui est très important. Il fallait vraiment qu'il soit juste. À côté, on est avec des filles comme Mounira Kankolé qui est Yéli, la petite copine de Ady. Elle n'a jamais joué au cinéma et je l'ai repérée à Bobo-Dioulasso, un peu par hasard. Il y a aussi Nafi Koné qui fait la cousine et n'a jamais joué. On est dans un métissage de pays et de formations mais je trouve que ça enrichit le propos. Qu'on soit à Bobo-Dioulasso, à Gaoua, à Ségou, la géographie est essentielle mais une fois qu'on y croit, ça va.
Investir sa propre géographie
- Quand on voit le film, on est frappé de voir qu'il y a une mobilité constante de lieux et d'espaces. Wallay est assez découpé avec beaucoup de mouvements dans les plans. Avez-vous recherché ça par effet de style ?
Comme j'aime beaucoup les plans-séquences, avec le chef opérateur, Martin Rit, on a eu de grandes réflexions sur le travail des frères Dardenne, le cinéma du réel… Du coup, on a opté souvent pour le plan-séquence mais heureusement on le sécurisait. On a fait d'autres plans pour dynamiser, et parfois au montage, on coupait le plan-séquence. Donc on a quelques plans-séquences entiers, et d'autres qui sont interrompus. Comme le personnage principal est un peu énervé, on est plus avec lui comme ça. J'avais envie de faire un film de cinéma et pas du champ-contrechamp. Le meilleur plan-séquence pour moi, est celui où Jean s'énerve dans sa maison, et dit à Ady qu'il ne veut pas avoir de problèmes avec ses voisins quand il vend ses objets. Là, on est dans une chorégraphie intéressante où la caméra danse avec ces deux personnages dans un espace réduit, avec une lumière sombre. Il y a très peu de plans sur pied dans le film. Il y en a trois : l'atterrissage de l'avion, un plan droite - gauche quand ils arrivent en moto, et un autre à Gaoua quand le taxi arrive. Sinon tout le reste est fait à l'épaule par Martin Rit. C'était important d'avoir cette caméra qui respire et qui peut à tout moment, bouger de manière organique.
- Comment gérez-vous la mobilité de la caméra alors que vous êtes handicapé et circulez en fauteuil roulant, quand vous dirigez des scènes sur des routes caillouteuses, dans des reliefs escarpés comme quand Ady va voir la grand-mère ?
C'est vrai qu'on a beaucoup tourné dans des endroits difficiles d'accès. Par exemple, le village de la grand-mère, ça a été compliqué pour elle [Joséphine Kaboré, ndlr] qui a 83 ans. Elle ne marche pas très bien et c'était assez escarpé comme vous dites. Pour moi, il a fallu trouver des porteurs pour certains endroits. C'était compliqué aussi de tourner sur le lac, dans des pirogues. Moi, j'ai toujours tendance à ne pas voir de limites à mon propre travail. Quand j'ai tourné Ceux de la colline, les gens rigolaient sur le plateau en disant que je cherche toujours des coins impossibles. C'est vrai que pour ce film-là, j'ai passé un mois sur un lieu difficile d'accès à tous les niveaux. Il y a un peu de ça dans Wallay mais ce qui s'est passé, c'est que nos décors nous ont été interdits à deux mois du tournage. Le 15 janvier 2016, il y a eu les attaques djihadistes à Ouagadougou qui ont changé la donne et enterré tous les décors que j'avais préparés depuis deux ans, dans la région de Sindou, à la frontière du Mali et de la Côte d'Ivoire. Il a fallu prendre la voiture et chercher d'autres décors jusqu'à l'intérieur du Bénin. Le Ministère français des Affaires étrangères, l'Institut français, l'ambassade de France, même la DASS qui donnait les autorisations pour la venue du garçon, nous avaient donné pour consigne de pas tout tourner au même endroit. Des fois, quand on est obligé, on trouve autre chose de mieux et je ne regrette aucun décor. Par exemple, le lac est à 700 kilomètres de Gaoua alors que dans le film, il est censé être à 20 minutes de moto. On a reconstitué une géographie propre au film.
Un film pour diversifier l'engagement
- Wallay se situerait donc dans la lignée des films que vous avez faits, plutôt documentaires, pris sur le vif et qui travaillent le réel avec les gens. Serait-ce un style personnel ?
J'ai la sensation d'être un jeune cinéaste donc je n'ai encore envie de jeter un regard sur ma filmographie et de tirer des conclusions. Je m'intéresse beaucoup à l'Histoire et il n'est pas exclu que je traite de choses qui ne se passent pas forcément aujourd'hui.
- Il semble vous ayez mis en veilleuse vos activités à Cinomade comme le tournage de films d'intervention, pour vous occuper du Ciné Guimbi. Maintenant que Wallay est terminé, de quoi allez-vous vous occuper : la construction de cette salle à Bobo-Dioulasso ou la réalisation d'un autre film ?
Je n'ai jamais laissé la construction de la salle même si j'ai dû m'absenter pendant le tournage. Je suis au quotidien avec l'équipe du Ciné Guimbi pour cette lutte phénoménale qui consiste à le faire renaître sur les cendres de l'ancienne salle. Je suis le président de l'association de soutien du cinéma au Burkina Faso qui porte ce projet. J'assure des rendez-vous au Festival de Cannes 2017 pour ça, pendant que j'accompagne des projections de Wallay à Cannes Junior. Donc ce ne sont pas des choses antinomiques mais qu'on peut faire ensemble. Bien sûr, quand on tourne un film, on ne fait que ça. On oublie tout y compris la famille… Mais ça ne dure que deux mois. Le reste du temps, je me consacre beaucoup au Ciné Guimbi et j'y tiens. Le rêve, ce serait de projeter Wallay au Ciné Guimbi. La boucle serait bouclée. Cinomade continue ses activités de sensibilisation et je les suis. Je suis moins présent mais je suis toujours dans le bureau. Mon objectif est de faire un autre film. J'ai des idées, je réfléchis, je lis. Ça reste encore très embryonnaire car Wallay vient de sortir en février, je vais l'accompagner pendant quelques temps. Quand j'étais à Berlin, j'ai été reçu par l'ambassadeur du Burkina Faso qui m'a dit : " Votre film fait beaucoup mieux le travail que moi, en tant qu'ambassadeur, pour le pays. "
- Quelle a été la meilleure expérience de Wallay pour vous ?
Je suis très content des comédiens et très fier de la musique. Avec Vincent Ségal qui l'a composée, ça a été une aventure. Il a intégré le film qu'il a adoré dès le départ. Il a vu le film un grand nombre de fois pour que, quand on est rentré en studio, le 13 janvier 2017, on fasse une journée de 12 heures où il a tout enregistré, d'un coup. J'étais là et c'était quasiment du live. Cette musique apporte quelque chose dans la sobriété. J'avais besoin d'une musique qui sorte du vent, qui se confonde aux bruits des feuilles, une musique douce, tendre, qui par moments, ait des résonances comme celle de la kora. Je n'avais pas envie que ce soit trop connoté africain et des fois, on part dans de la musique presque tzigane, gitane, après on revient vers quelque chose de beaucoup plus simple avec des cordes. La musique du générique du début est aussi un hommage à Victor Démé, disparu en 2015, un grand musicien burkinabé. Et Wallay est aussi dédié à mes parents. Il y a une dédicace pour eux parce qu'ils sont décédés dans la période de fabrication du film.
- C'est donc un hommage à la famille, aux ancêtres, aux parents…
Exactement. Quand on a tourné la séquence très sobre des au-revoir avec la grand-mère, à la fin du film, la moitié du plateau était en pleurs. C'était vraiment fort. Cette scène m'a totalement bouleversé. Quand on a quitté le plateau, c'était une évidence que ce film, je le dédie aux parents. C'est un hommage à la famille, c'est clair. La grande famille, celle qu'on subit, celle qu'on choisit…
par Michel AMARGER
Africiné Magazine / Paris
pour Images Francophones
en collaboration avec Africultures
Lire la critique du film : Wallay - Initiation vitale au Burkina, par Michel Amarger (Africiné Magazine)
Image : Berni Goldblat, réalisateur/producteur burkinabè
Crédit : gracieuseté Berlinale 2017
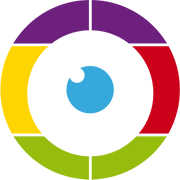 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images