Sidiki Bakaba fait son cinéma. Rencontre avec l'acteur ivoirien multiforme

Sidiki Bakaba revient sur le devant de la scène. On le retrouve dans plusieurs films tandis qu'il se prépare à réaliser une nouvelle fiction.
Le célèbre comédien ivoirien déborde de projets. Il a la santé et il le prouve. Les blessures reçues lors du bombardement de Palais présidentiel d'Abidjan d'où il s'est extrait en 2011, pour gagner la France, sont cicatrisées. Il en garde des éclats de balles et surtout l'envie d'être réhabilité après les accusations d'incitation à la violence pour Laurent Gbagbo, qu'il a publiquement réfutées devant les tribunaux français.
Aujourd'hui, l'artiste relève la tête, en forçant le respect des partis de tous bords, et en recevant des reconnaissances multiples de la part des autorités françaises. Le pied à Paris, le coeur à Abidjan, Sidiki Bakaba brasse les cultures dans une carrière de comédien, de metteur en scène, impressionnante et exigeante. Et ce n'est pas fini !
Auteur de scénographies de pièces françaises (En attendant Godot de Samuel Becket, 1969) comme de ses propres textes (C'est quoi même ?, 1971), il revitalise le Palais de la Culture d'Abidjan en y orchestrant des spectacles de 2000 à 2011. Ses films secouent avec succès les écrans ivoiriens, emportés par Les Guérisseurs, 1988, Tanowé des lagunes, 1994, ou Roues libres, 2002.
Mais la renommée du créateur n'éclipse pas la notoriété de l'acteur. Révélé par le sulfureux Visages de femmes, de Désiré Ecaré, 1971, Bako, l'autre rive de Jacques Champreux, 1977, il multiplie les rôles avec brio aussi bien dans les films moteurs du cinéma français L'État sauvage de Francis Girod, 1978, Le professionnel de Georges Lautner, 1981) que les fictions d'auteurs africains radicaux (Pétanqui de Yeo Kozoloa, 1982, Camp de Thiaroye de Ousmane Sembène et Thierno Faty Sow, 1988).
Sa longévité et l'éclectisme de ses compositions font de Sidiki Bakaba un exemple. Aujourd'hui, il étudie un scénario de Jo Gaï Ramaka et un projet de Léandre-Alain Baker. Il vient de tourner Ni dieu ni maître, un film franco-italien de Enrico Alexander Giordano, mais est déjà à l'affiche d'une coproduction chinoise. Il tient aussi l'un des premiers rôles de la nouvelle fiction de Christian Lara, Esclave et courtisane, 2017.
Avant de se consacrer à la réalisation d'un scénario écrit par Ayala, sa compagne, Sidiki Bakaba revient sur ses engagements d'artiste et son personnage le plus récent. Elégant et affable comme lui.
Jouer dans un film d'Histoire contemporain
- De quoi traite Esclave et courtisane dont vous êtes un des héros ?
Ça parle de l'esclavage, celui des femmes. On ne montre jamais que des femmes ont été aussi capturées et c'est une violence qu'on ne voit pas. Christian Lara voulait mettre en avant l'histoire d'une esclave qui raconte sa captivité, son transport. Comme elle dit, beaucoup se sont laissé mourir, elle, elle veut vivre.
- Mais n'y a-t-il pas aussi une revisitation de l'Histoire au présent ?
Oui, Christian Lara a pris l'option de faire ça comme une sorte de huis clos, un peu à la Hitchcock, en noir et blanc. Dans un château, il y a quatre personnages : un Français, une Russe, une Chinoise et un Noir. La Chinoise va recevoir un livre qui s'appelle justement Esclave et courtisane, et quand elle le lit, surgissent les images de l'esclavage, en couleur. L'histoire contemporaine est là, et on parle aussi de l'esclavage moderne. On va découvrir que la Chinoise a échappé à sa maquerelle, qu'elle est dans une histoire d'amour avec un jeune Français. Elle attend un enfant et elle veut vivre ça. Donc il ne s'agit pas que de l'esclavage des femmes noires qui est traité dans l'aspect contemporain du récit. On va du livre qui est de l'histoire passée, au présent qui est là.
- Le film prend sens dans un endroit qui a été le témoin de l'histoire ancienne et qui est aussi le lieu où se retrouvent ces personnages différents aujourd'hui. Comment voyez-vous cette relation ?
Ce qui est intéressant, c'est d'avoir choisi un château qui a vécu dans le passé, l'esclavage, les orgies, les abus avec les esclaves qui transitaient là. Christian Lara a voulu montrer que ce château était comme hanté par les fantômes de l'esclavage d'où ce côté suspect du présent. On ne sait jamais qui est qui. Le Noir qui est dedans, on pense que c'est un évadé de prison parce qu'il y a de la suspicion et ce n'est qu'à la fin qu'on va le découvrir. J'ai beaucoup aimé le scénario car il a beaucoup de complexité et ce n'est pas ce qu'on voit habituellement de l'esclavage. Il laisse entrevoir que notre présent est rempli d'esclavage.
- Au final, votre personnage semble dénoncer l'esclavage dont l'Afrique a été la victime politique. Parle-t-il seulement d'esclavage ?
Il parle de ça mais il laisse s'ouvrir aussi un espoir. Tout se passe durant un week-end et il est dans ce château, devenu une pension, parce qu'il voulait se retirer pour rédiger un texte. C'est un président qui a disparu lors d'une conférence en France. On croit qu'il a été kidnappé. La télévision parle de sa disparition mais c'est parce qu'il ne voulait pas signer à l'aveuglette, un contrat avec la France où il serait perdant et son peuple aussi. Il ne voulait pas braquer la France donc il a disparu pour prendre le temps de réfléchir au bonheur du peuple. D'ailleurs quand il écrit, l'encre goutte sur le mot bonheur, il déchire la feuille et il le réécrit. Une fois qu'il a trouvé la solution, il revient et tout le monde est content. La France sait qu'elle va avoir sa part et devenir producteur du produit trouvé en Afrique mais son peuple à lui, pourra en profiter. Au lieu d'émettre un refus déclenchant une guerre, il l'évite. Il a cette vision de dire que quand on trouve une bonne richesse, il faut que ça profite à tout le monde sans qu'on soit lésé. Mais il parle aussi de l'esclavage, il sait ce qui s'est passé. Christian Lara a ce rapport à l'esclavage qu'il traite dans Héritage perdu (2005) où je joue. Il y a un Antillais qui vient sauver l'Afrique, et qui repart… C'est à dire que l'Afrique doit compter sur sa diaspora pour s'en sortir. Et les Noirs américains ont beaucoup aimé. Je rappelle que Christian Lara vient d'une famille d'historiens.
- D'ailleurs on remarque que le film est dédié à ses ancêtres.
Oui, il est descendant d'esclaves. Il navigue dans l'Histoire et quand il la touche, c'est toujours très riche. On a fait deux films ensemble et on en prépare un autre, il voit ce que vit l'Afrique, le drame, les histoires de division, de tribalisme. Là il n'y a plus le Blanc qui domine mais on est dans une autre problématique. Christian Lara est métis et il fait une proposition indirecte dans ses films. Il n'impose pas.
Forger une image d'acteur au delà des frontières
- Votre personnage a beaucoup de retenue dans Esclave et courtisane. On ne sait pas ce qu'il fait, il est sur la réserve. Ce genre de rôle vous est-il facile à interpréter ?
Oh ce n'est pas facile. Mais les rôles que j'aime beaucoup, ce sont ceux où il y a de la retenue. J'aime dire aux élèves que je forme : " Le jeu commence là où s'arrête le texte ". Dans Esclave et courtisane, le Noir parle peu donc tout est là. C'est comme pour le personnage muet que j'ai joué pour Ousmane Sembène [et Thierno Faty Sow, ndlr] dans Camp de Thiaroye (1998). C'est un rôle magnifique parce que justement, il est retenu et il faut le vivre. Ce qui est très fort au cinéma, c'est ce que la caméra va prendre dans le regard, dans le silence. C'est là où il faut que ce soit vécu de l'intérieur. On ne peut pas tricher avec la caméra, ça ne ment pas. Ce genre de personnage n'est pas facile mais c'est justement pour ça que pour moi, il est intéressant. J'adore le challenge et ce genre de figures très intenses… Voilà pourquoi dans Esclave et courtisane, Christian Lara lui laisse l'épilogue où il ne dit rien. Il fait partie des réalisateurs qui aiment vraiment les acteurs. Il donne une part importante au silence de l'acteur. C'est pourquoi on a des projets très forts ensemble.
- Avez-vous l'impression qu'il y a une image qui se dessine de l'acteur francophone que vous êtes dans l'espace africain et européen francophone ?
Oui, il y a quelque chose. Nos aînés ont beaucoup ramé depuis de grands acteurs comme Habib Benglia, Douta Seck et les autres. Ils ont plutôt travaillé dans les salles obscures pour les doublages et ont plus prêté leur voix qu'on ne les a vus jouer. Ma génération vient juste un peu après et je suis un des plus chanceux d'avoir pu faire une carrière entre l'Afrique et la France, jouant en bambara, en dioula… et des personnages impensables pour un Parisien. J'ai pu courir aussi avec bonheur, aux côtés de gens comme Jean-Paul Belmondo dans l'action, ou être en face de Pierre Brasseur et Sophie Marceau en tant que maître chanteur, ou avec Jeanne Moreau sur scène. J'ai eu beaucoup de chance de jouer avec eux et surtout pour de grands réalisateurs qui m'ont fait confiance. " Il n'y a pas de petits rôles, il y a de petits acteurs ", comme disait un de mes professeurs de l'Actors Studio. Quand on a eu tout cela, on est plein d'espoir. Je ne peux pas me plaindre d'avoir manqué de rôles et quand il n'y en avait pas en France, j'étais prêt à payer pour aller tourner en Afrique. Comme j'ai payé les cigarettes d'un réalisateur pendant tout un tournage… Mais ces films m'ont rapporté des prix d'interprétations parce qu'on me donnait de vrais rôles qui me procuraient beaucoup de satisfaction pour mon métier, et puis en France, ça me rapportait de l'argent. En Afrique, j'ai dû aider mes partenaires qui n'étaient pas des comédiens, donc j'étais à la fois un coach, un professeur pour eux. Et puis il a eu l'Amérique avec des gens comme Danny Glover qui m'ont fait miroiter le fait de rester aux Etats-Unis. Mais je leur ai dit : " Non vous, vous êtes des Afro-américains et moi, je suis un Africain français. " C'est ça qui faisait ma particularité parce je n'étais pas venu pour leur prendre le territoire qu'ils essayaient d'imposer au fur et à mesure. Et donc ils laisseraient très difficilement la porte ouverte aux Africains, ce que les autres acteurs du continent ne savent pas. Moi, mon rêve, c'est de voir ce qui se profile en ce moment en France, avec les réalisateurs. Malheureusement ceux qui avaient commencé à employer des Africains sont partis comme Georges Lautner, Francis Girod. Mais avec la nouvelle génération, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils ont été à la crèche, à la maternelle avec des Noirs… Ils ont fait des études ensemble. Ils commencent à voir leurs camarades simplement comme des esprits humains et des personnalités plutôt que des races différentes.
Laisser sa marque dans le spectacle
- Mais cette nouvelle génération de réalisateurs vous connaît peut-être moins parce que dans les années 2000, vous étiez occupé à diriger le Palais de la Culture d'Abidjan. A-t_elle vu les rôles que vous avez fait avant puisque là, vous étiez occupé au théâtre ?
Hélas, la plupart des films ne sont pas passés, ils ne les ont pas vus. C'est pour ça que mon retour maintenant est assez compliqué. Je reviens après avoir beaucoup travaillé durant ces dix années. Je me suis donné tous les rôles possibles, j'ai essayé tous les répertoires à la fois dans la mise en scène, la direction d'acteurs, et dans le jeu. Je n'ai jamais cessé de jouer. Ce que j'ai fait en 10 ans en Côte d'Ivoire, il m'aurait peut-être fallu 40 ans pour le faire en France. En contrepartie comme le dit Bernard Dadié dans une de ses pièces : "Les cris poussés dans les pays d'Outremer n'arrivent pas en Occident. Ils se perdent dans les hurlements des tempêtes et des sables des déserts." C'est vrai qu'on peut faire des choses magnifiques mais si ce n'est pas vu, ce n'est pas vu.
- Est-ce pour laisser une trace de votre travail que vous avez réalisé des captations théâtrales de ce que vous avez dirigé et interprété à Abidjan ?
Oui, j'en ai fait beaucoup, en effet. J'en ai offert une à la télévision sénégalaise, au mois d'avril 2017. J'étais venu pour une série sur les enfances coloniales et j'en ai profité pour offrir un document sur leur plus grand héros de la résistance, le dernier roi Alboury Ndiaye que j'ai joué et mis en scène, et dont j'ai fait la captation. Peut-être que ça va contribuer à de la visibilité. J'ai fait les captations de toutes ces pièces et je cherche la possibilité de les diffuser. Il y en a une sur Toussaint Louverture, jouée par des acteurs noirs, habillés comme des Blancs, qui a été diffusée à un festival de cinéma à Khouribga, au Maroc. C'était présenté comme une dramatique filmée mais ce n'était pas en compétition.
- Aujourd'hui, avez-vous plus envie de revenir vers le théâtre ou vers la réalisation de films ?
Ah, les deux ! Depuis que je suis arrivé en France, j'essaie de reprendre mon métier mais mes agents ne sont plus vivants, des acteurs de ma génération comme Philippe Léotard, sont partis. Quand je fais un casting, je me retrouve parfois devant une jeune directrice qui me demande si j'ai déjà joué devant une caméra… Quand je dis que j'ai une quarantaine de films derrière moi, elle se demande si c'est vrai. Alors je montre sur mon mobile : "Tiens, là c'est Jeanne Moreau, là c'est Belmondo…". Il n'y a pas de mémoire en fait, c'est l'un des inconvénients. Pourtant en 2015, par exemple, quelqu'un m'a appelé de Brasilia et il connaissait ma carrière mieux que personne en Afrique. Il m'a cité un " seul en scène ", Les Déconnards de Koffi Kwahulé (1999), la dernière pièce que j'ai jouée à Avignon avant de partir en Côte d'Ivoire, et m'a invité à venir dans un festival de théâtre contemporain dont il s'occupe à Brasilia. Mais il suffit d'aller sur des sites pour voir qui je suis, et comme me l'a dit Danny Glover, je suis même sur Hollywood.com. En ce moment, je cherche une salle pour me produire et aussi ouvrir des cours de formation d'acteur mais c'est en attente.
- Quels sont les nouveaux rôles qu'on vous propose au cinéma ?
J'ai eu deux propositions quand je suis allé au Sénégal. L'une est l'adaptation de Combat de Nègres et de chiens de Bernard-Marie Coltès, par Jo Gaï Ramaka. L'autre est une production de Moctar Ndiouga Bâ qui va générer une série de quatre épisodes où j'ai le deuxième rôle. Ils veulent simplement savoir si je suis en bonne santé après tout ce qu'ils ont pu imaginer que j'ai traversé…
- Et que venez-vous de tourner dernièrement ?
Je viens de tourner en Chine, récemment. Quand je suis revenu du festival de théâtre au Brésil, j'ai sauté dans un avion pour aller en Mongolie, faire le rôle d'un général soudanais. La production a préféré reconstituer le Soudan en Mongolie plutôt que d'aller y tourner. Et ça s'appelle China Salesman de Tan Bing avec Steven Seagal, Mike Tyson et Eriq Ebouaney qui joue un rôle important. C'est un film en anglais qui est à l'affiche en Chine depuis cet été. On a travaillé sur la post synchro en France et je croyais que c'était pour être doublé en français mais non, il est interprété en anglais et en chinois.
- Donc on vous voit en Chine, vous avez des projets au Sénégal, vous travaillez en France… Ne dirait on pas que vous êtes visible sur la plupart des continents ?
Ah oui, et même en Amérique où j'ai joué le monologue de la pièce Les Déconnards, en français devant des Brésiliens. Le texte défilait traduit en brésilien au-dessus de ma tête. Et les gens réagissaient bien.
S'aguerrir dans la réalisation de films
- Avec tous ces rôles divers, comment avez-vous pu envisager de passer à la réalisation, en fait ?
Avant le mouvement suscité par Les Guérisseurs, Ayala, ma femme, me disait : " Il ne faut pas que tu sois assis, en train d'attendre. Tu as une double formation d'acteur et de metteur en scène importante. Tu peux faire des films. " Et c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer devant de grands réalisateurs comme Jacques Champreux, Georges Lautner, qui me disaient de regarder dans l'objectif et me laissaient venir jusque dans la salle de montage jusqu'à la finition, aux trucages.... Finalement, j'apprenais aussi mon métier de réalisateur. J'apprenais à convertir mon métier de metteur en scène en celui de réalisateur de cinéma. Les Guérisseurs (1988) a été l'un des plus gros budget du cinéma africain de l'époque avec un milliard de francs cfa lourds, avant la dévaluation. Après ça, j'ai fait un film de deux minutes trente pour CFI, puis une trentaine de courts-métrages de huit minutes pour TV5, qui passaient tous les samedis. C'était Le Nord est tombé sur la tête dont j'étais l'acteur principal et j'en ai réalisé un bon nombre d'épisodes. Puis j'ai fait mon deuxième long-métrage, Tanowé des lagunes (1994), que je vais essayer de remastériser. C'est peut-être le film que je préfère de toutes mes réalisations. Ça aborde l‘écologie et l'ACCT m'a aidé à produire avant que ça devienne l'OIF. Je vais essayer de le retravailler à partir de leur master. Mais le film béni de ma carrière de réalisateur, c'est Roues libres (2002). On a eu le soutien du CNC, ARTE, l'Europe, la Francophonie. Il a été sous-titré en anglais et diffusé aux États-Unis, au Pan African Film Festival. Il vient de passer au dernier Festival du Film Francophone d'Angoulême durant l'été 2017. Mon quatrième film sera celui qui est écrit entièrement pas Ayala, et elle y a mis son "trip"…
- Où en est ce projet, basé sur le scénario de Ayala ?
Ça s'appelle Au bout du chemin et c'est le quatrième long-métrage que je dois réaliser. Elle l'a écrit pour que je le mette en scène. Là, il faut que la production se réunisse et que je puisse le réaliser sans tarder.
- Et de quoi traite Au bout du chemin ?
La toile de fond, c'est l'Afrique avec ses multiples problèmes qu'on connaît : des coups d'État, des enfants soldats… Ce qui est sur le devant du film, c'est une jeunesse pétillante qu'on trouve sur les campus universitaires. Ils sont de milieux différents mais n'ont qu'un rêve : comment faire avancer l'Afrique pour que ce ne soit pas toujours le drame. Le drame est là, il existe, il est vivant, on le sent, on le voit en filigrane. Deux des personnages importants du film sont un musicien rappeur, et une fille qui étudie l'architecture en aimant fredonner. Elle sera jouée par une vraie chanteuse. C'est une jeunesse pleine de discussions, de challenges entre elle, qui ne compte pas sur les dirigeants car ils commencent à vieillir quand même sur ce continent ! Depuis 1960, ce ne sont plus les mêmes mais la méthode n'a pas changé. Je suis bien placé pour le savoir puisque j'étais adolescent quand les pays d'Afrique de l'Ouest sont devenus indépendants. On est un peu les aînés de nos indépendances. Ce qui est important dans le film écrit par Ayala, c'est qu'il y en ait qui comprennent que quand il y a le feu à la demeure chez le voisin, c'est chez eux. Donc ouvrez les frontières, donnez-vous la main, aidez ceux qui sont en difficulté et là vous sauverez un continent, et donc une partie du monde. Le rêve de Ayala, c'est que ce bout de chemin arrive. Donc ça s'appelle Au bout du chemin… Ca suggère comme je le pense, que celui qui ne sait pas recevoir ne saura jamais rien donner.
Elargir son rôle de médiateur culturel
- Vous sentez-vous comme un ambassadeur culturel lorsque vous faites ce genre de déclaration ? Avec tous vos voyages, vos cultures, peut-on prendre ce que vous dites comme une sorte de message ?
Oui, mais c'est plus un destin qui me caractérise. Je suis parti d'une petite ville où je n'ai pas porté de chaussures jusqu'à l'âge de 13 ans, pour me retrouver dans les grands salons de Paris et être sur scène à 22 ans, avec un monstre sacré comme Jeanne Moreau. D'ailleurs Jack Lang m'a vu quand j'avais une vingtaine d'années et il me disait : " Tu es comme un ambassadeur culturel, et il faut que tu dises la même chose. " A l'époque, il dirigeait le Festival mondial du théâtre de Nancy qu'il avait créé, et il venait souvent à Abidjan. Puis il a été plusieurs fois ministre en France, et il m'a même vu me pendre avec les dents au cirque pour le Gala de l'Union des Artistes. A l'origine, j'étais parti pour deux ans au Palais de la Culture d'Abidjan et à la fin de mon mandat, dix après, avec les ouvertures que j'ai pu avoir tant avec les Européens que les Américains, j'ai préféré donner ma démission. Et puis je n'aime pas rester au même endroit. C'est ce qui me pousse souvent à changer et à ce moment-là, on m'a proposé d'être ambassadeur. J'ai été nommé avec un décret présidentiel, ambassadeur de la culture itinérant. C'est le poste que je devais assumer et puis il y a eu la crise en Côte d'Ivoire et je suis venu en France. Maintenant je suis en attente que cette réhabilitation se fasse puisque le rêve de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est de dire : " On est fatigués de la guerre, des rivalités, jusqu'à être fatiguées de la fatigue de ça… " Il y a des pays qui ont connu des crises plus violentes que les nôtres et qui sont aujourd'hui sur les rails, qui ont avancé. Se pardonner, avancer, c'est mon rêve en tant qu'ambassadeur. L'artiste que je suis, puisque je suis toujours resté sur mon terrain qui est artistique et je ne suis jamais allé dans le domaine de la politique, apprécie tous ceux qui disent : "Il faut que ce pays se réconcilie, que des enfants viennent, que des gens ne meurent pas à l'étranger parce qu'ils sont exilés". Dans la pièce Les Déconnards que j'ai été jouée au Brésil, le personnage qui est asthmatique, pense toujours à l'Afrique dans sa chambre de bonne. Il dit : " Mourir à l'étranger, c'est comme si on n'avait jamais vécu. Parce qu'un étranger, c'est quelqu'un qui accroche sa vie comme on accroche son manteau à l'entrée d'une maison. C'est quelqu'un qui attend de vivre. "
- Cette citation s'applique t'elle à la Côte d'Ivoire ?
Je souhaite non seulement que ça s'arrange pour la Côte d'Ivoire mais pour tous les pays d'Afrique ou du monde, où les gens sont exilés. Avant toute chose, l'ambassadeur que je suis, et qui aujourd'hui va au-delà du simple ambassadeur de la culture, pense que la culture, c'est ce qui est le plus fédérateur que ce soit à travers la musique, la peinture, le théâtre, le cinéma… Parfois on doit montrer des atrocités pour dire : " Plus jamais ça ! ". Certes quand on témoigne, on prend parfois des coups très durs mais justement, si on témoigne, c'est pour éviter qu'on ne refasse nos erreurs constamment. Témoigner ne veut pas dire qu'on prend parti pour quelqu'un. Mais qui dans un conflit, n'a pas fait quelque chose ? Qui n'a pas fait du tort et n'a pas raison en même temps ? Oui, je suis ambassadeur depuis avant les élections ivoiriennes mais pour l'instant je suis sans portefeuille. Alors je n'attends pas le portefeuille mais j'attends de continuer à faire mon travail tant à travers les oeuvres comme le film de Ayala que je souhaite réaliser, que collaborer avec deux réalisateurs sénégalais, ou Christian Lara qui a encore deux films à faire avec moi dont peut-être un James Bond à sa façon. Là, je suis dans ces projets de cinéma mais j'adore encore plus le théâtre parce que c'est direct. Sentir le public, sentir les parfums qui se dégagent de la salle, la chaleur même des silences… Cette communion directe avec le public n'a pas de prix pour moi. Le cinéma, c'est autre chose, ça va beaucoup plus loin. Mais le théâtre, j'aime beaucoup parce que c'est de là que je viens !
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
Paris, Africiné Magazine
pour Images Francophones
Image : Sidiki Bakaba, acteur et réalisateur ivoirien.
Crédit : Michel Amarger, Africiné Magazine
Aujourd'hui, l'artiste relève la tête, en forçant le respect des partis de tous bords, et en recevant des reconnaissances multiples de la part des autorités françaises. Le pied à Paris, le coeur à Abidjan, Sidiki Bakaba brasse les cultures dans une carrière de comédien, de metteur en scène, impressionnante et exigeante. Et ce n'est pas fini !
Auteur de scénographies de pièces françaises (En attendant Godot de Samuel Becket, 1969) comme de ses propres textes (C'est quoi même ?, 1971), il revitalise le Palais de la Culture d'Abidjan en y orchestrant des spectacles de 2000 à 2011. Ses films secouent avec succès les écrans ivoiriens, emportés par Les Guérisseurs, 1988, Tanowé des lagunes, 1994, ou Roues libres, 2002.
Mais la renommée du créateur n'éclipse pas la notoriété de l'acteur. Révélé par le sulfureux Visages de femmes, de Désiré Ecaré, 1971, Bako, l'autre rive de Jacques Champreux, 1977, il multiplie les rôles avec brio aussi bien dans les films moteurs du cinéma français L'État sauvage de Francis Girod, 1978, Le professionnel de Georges Lautner, 1981) que les fictions d'auteurs africains radicaux (Pétanqui de Yeo Kozoloa, 1982, Camp de Thiaroye de Ousmane Sembène et Thierno Faty Sow, 1988).
Sa longévité et l'éclectisme de ses compositions font de Sidiki Bakaba un exemple. Aujourd'hui, il étudie un scénario de Jo Gaï Ramaka et un projet de Léandre-Alain Baker. Il vient de tourner Ni dieu ni maître, un film franco-italien de Enrico Alexander Giordano, mais est déjà à l'affiche d'une coproduction chinoise. Il tient aussi l'un des premiers rôles de la nouvelle fiction de Christian Lara, Esclave et courtisane, 2017.
Avant de se consacrer à la réalisation d'un scénario écrit par Ayala, sa compagne, Sidiki Bakaba revient sur ses engagements d'artiste et son personnage le plus récent. Elégant et affable comme lui.
Jouer dans un film d'Histoire contemporain
- De quoi traite Esclave et courtisane dont vous êtes un des héros ?
Ça parle de l'esclavage, celui des femmes. On ne montre jamais que des femmes ont été aussi capturées et c'est une violence qu'on ne voit pas. Christian Lara voulait mettre en avant l'histoire d'une esclave qui raconte sa captivité, son transport. Comme elle dit, beaucoup se sont laissé mourir, elle, elle veut vivre.
- Mais n'y a-t-il pas aussi une revisitation de l'Histoire au présent ?
Oui, Christian Lara a pris l'option de faire ça comme une sorte de huis clos, un peu à la Hitchcock, en noir et blanc. Dans un château, il y a quatre personnages : un Français, une Russe, une Chinoise et un Noir. La Chinoise va recevoir un livre qui s'appelle justement Esclave et courtisane, et quand elle le lit, surgissent les images de l'esclavage, en couleur. L'histoire contemporaine est là, et on parle aussi de l'esclavage moderne. On va découvrir que la Chinoise a échappé à sa maquerelle, qu'elle est dans une histoire d'amour avec un jeune Français. Elle attend un enfant et elle veut vivre ça. Donc il ne s'agit pas que de l'esclavage des femmes noires qui est traité dans l'aspect contemporain du récit. On va du livre qui est de l'histoire passée, au présent qui est là.
- Le film prend sens dans un endroit qui a été le témoin de l'histoire ancienne et qui est aussi le lieu où se retrouvent ces personnages différents aujourd'hui. Comment voyez-vous cette relation ?
Ce qui est intéressant, c'est d'avoir choisi un château qui a vécu dans le passé, l'esclavage, les orgies, les abus avec les esclaves qui transitaient là. Christian Lara a voulu montrer que ce château était comme hanté par les fantômes de l'esclavage d'où ce côté suspect du présent. On ne sait jamais qui est qui. Le Noir qui est dedans, on pense que c'est un évadé de prison parce qu'il y a de la suspicion et ce n'est qu'à la fin qu'on va le découvrir. J'ai beaucoup aimé le scénario car il a beaucoup de complexité et ce n'est pas ce qu'on voit habituellement de l'esclavage. Il laisse entrevoir que notre présent est rempli d'esclavage.
- Au final, votre personnage semble dénoncer l'esclavage dont l'Afrique a été la victime politique. Parle-t-il seulement d'esclavage ?
Il parle de ça mais il laisse s'ouvrir aussi un espoir. Tout se passe durant un week-end et il est dans ce château, devenu une pension, parce qu'il voulait se retirer pour rédiger un texte. C'est un président qui a disparu lors d'une conférence en France. On croit qu'il a été kidnappé. La télévision parle de sa disparition mais c'est parce qu'il ne voulait pas signer à l'aveuglette, un contrat avec la France où il serait perdant et son peuple aussi. Il ne voulait pas braquer la France donc il a disparu pour prendre le temps de réfléchir au bonheur du peuple. D'ailleurs quand il écrit, l'encre goutte sur le mot bonheur, il déchire la feuille et il le réécrit. Une fois qu'il a trouvé la solution, il revient et tout le monde est content. La France sait qu'elle va avoir sa part et devenir producteur du produit trouvé en Afrique mais son peuple à lui, pourra en profiter. Au lieu d'émettre un refus déclenchant une guerre, il l'évite. Il a cette vision de dire que quand on trouve une bonne richesse, il faut que ça profite à tout le monde sans qu'on soit lésé. Mais il parle aussi de l'esclavage, il sait ce qui s'est passé. Christian Lara a ce rapport à l'esclavage qu'il traite dans Héritage perdu (2005) où je joue. Il y a un Antillais qui vient sauver l'Afrique, et qui repart… C'est à dire que l'Afrique doit compter sur sa diaspora pour s'en sortir. Et les Noirs américains ont beaucoup aimé. Je rappelle que Christian Lara vient d'une famille d'historiens.
- D'ailleurs on remarque que le film est dédié à ses ancêtres.
Oui, il est descendant d'esclaves. Il navigue dans l'Histoire et quand il la touche, c'est toujours très riche. On a fait deux films ensemble et on en prépare un autre, il voit ce que vit l'Afrique, le drame, les histoires de division, de tribalisme. Là il n'y a plus le Blanc qui domine mais on est dans une autre problématique. Christian Lara est métis et il fait une proposition indirecte dans ses films. Il n'impose pas.
Forger une image d'acteur au delà des frontières
- Votre personnage a beaucoup de retenue dans Esclave et courtisane. On ne sait pas ce qu'il fait, il est sur la réserve. Ce genre de rôle vous est-il facile à interpréter ?
Oh ce n'est pas facile. Mais les rôles que j'aime beaucoup, ce sont ceux où il y a de la retenue. J'aime dire aux élèves que je forme : " Le jeu commence là où s'arrête le texte ". Dans Esclave et courtisane, le Noir parle peu donc tout est là. C'est comme pour le personnage muet que j'ai joué pour Ousmane Sembène [et Thierno Faty Sow, ndlr] dans Camp de Thiaroye (1998). C'est un rôle magnifique parce que justement, il est retenu et il faut le vivre. Ce qui est très fort au cinéma, c'est ce que la caméra va prendre dans le regard, dans le silence. C'est là où il faut que ce soit vécu de l'intérieur. On ne peut pas tricher avec la caméra, ça ne ment pas. Ce genre de personnage n'est pas facile mais c'est justement pour ça que pour moi, il est intéressant. J'adore le challenge et ce genre de figures très intenses… Voilà pourquoi dans Esclave et courtisane, Christian Lara lui laisse l'épilogue où il ne dit rien. Il fait partie des réalisateurs qui aiment vraiment les acteurs. Il donne une part importante au silence de l'acteur. C'est pourquoi on a des projets très forts ensemble.
- Avez-vous l'impression qu'il y a une image qui se dessine de l'acteur francophone que vous êtes dans l'espace africain et européen francophone ?
Oui, il y a quelque chose. Nos aînés ont beaucoup ramé depuis de grands acteurs comme Habib Benglia, Douta Seck et les autres. Ils ont plutôt travaillé dans les salles obscures pour les doublages et ont plus prêté leur voix qu'on ne les a vus jouer. Ma génération vient juste un peu après et je suis un des plus chanceux d'avoir pu faire une carrière entre l'Afrique et la France, jouant en bambara, en dioula… et des personnages impensables pour un Parisien. J'ai pu courir aussi avec bonheur, aux côtés de gens comme Jean-Paul Belmondo dans l'action, ou être en face de Pierre Brasseur et Sophie Marceau en tant que maître chanteur, ou avec Jeanne Moreau sur scène. J'ai eu beaucoup de chance de jouer avec eux et surtout pour de grands réalisateurs qui m'ont fait confiance. " Il n'y a pas de petits rôles, il y a de petits acteurs ", comme disait un de mes professeurs de l'Actors Studio. Quand on a eu tout cela, on est plein d'espoir. Je ne peux pas me plaindre d'avoir manqué de rôles et quand il n'y en avait pas en France, j'étais prêt à payer pour aller tourner en Afrique. Comme j'ai payé les cigarettes d'un réalisateur pendant tout un tournage… Mais ces films m'ont rapporté des prix d'interprétations parce qu'on me donnait de vrais rôles qui me procuraient beaucoup de satisfaction pour mon métier, et puis en France, ça me rapportait de l'argent. En Afrique, j'ai dû aider mes partenaires qui n'étaient pas des comédiens, donc j'étais à la fois un coach, un professeur pour eux. Et puis il a eu l'Amérique avec des gens comme Danny Glover qui m'ont fait miroiter le fait de rester aux Etats-Unis. Mais je leur ai dit : " Non vous, vous êtes des Afro-américains et moi, je suis un Africain français. " C'est ça qui faisait ma particularité parce je n'étais pas venu pour leur prendre le territoire qu'ils essayaient d'imposer au fur et à mesure. Et donc ils laisseraient très difficilement la porte ouverte aux Africains, ce que les autres acteurs du continent ne savent pas. Moi, mon rêve, c'est de voir ce qui se profile en ce moment en France, avec les réalisateurs. Malheureusement ceux qui avaient commencé à employer des Africains sont partis comme Georges Lautner, Francis Girod. Mais avec la nouvelle génération, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils ont été à la crèche, à la maternelle avec des Noirs… Ils ont fait des études ensemble. Ils commencent à voir leurs camarades simplement comme des esprits humains et des personnalités plutôt que des races différentes.
Laisser sa marque dans le spectacle
- Mais cette nouvelle génération de réalisateurs vous connaît peut-être moins parce que dans les années 2000, vous étiez occupé à diriger le Palais de la Culture d'Abidjan. A-t_elle vu les rôles que vous avez fait avant puisque là, vous étiez occupé au théâtre ?
Hélas, la plupart des films ne sont pas passés, ils ne les ont pas vus. C'est pour ça que mon retour maintenant est assez compliqué. Je reviens après avoir beaucoup travaillé durant ces dix années. Je me suis donné tous les rôles possibles, j'ai essayé tous les répertoires à la fois dans la mise en scène, la direction d'acteurs, et dans le jeu. Je n'ai jamais cessé de jouer. Ce que j'ai fait en 10 ans en Côte d'Ivoire, il m'aurait peut-être fallu 40 ans pour le faire en France. En contrepartie comme le dit Bernard Dadié dans une de ses pièces : "Les cris poussés dans les pays d'Outremer n'arrivent pas en Occident. Ils se perdent dans les hurlements des tempêtes et des sables des déserts." C'est vrai qu'on peut faire des choses magnifiques mais si ce n'est pas vu, ce n'est pas vu.
- Est-ce pour laisser une trace de votre travail que vous avez réalisé des captations théâtrales de ce que vous avez dirigé et interprété à Abidjan ?
Oui, j'en ai fait beaucoup, en effet. J'en ai offert une à la télévision sénégalaise, au mois d'avril 2017. J'étais venu pour une série sur les enfances coloniales et j'en ai profité pour offrir un document sur leur plus grand héros de la résistance, le dernier roi Alboury Ndiaye que j'ai joué et mis en scène, et dont j'ai fait la captation. Peut-être que ça va contribuer à de la visibilité. J'ai fait les captations de toutes ces pièces et je cherche la possibilité de les diffuser. Il y en a une sur Toussaint Louverture, jouée par des acteurs noirs, habillés comme des Blancs, qui a été diffusée à un festival de cinéma à Khouribga, au Maroc. C'était présenté comme une dramatique filmée mais ce n'était pas en compétition.
- Aujourd'hui, avez-vous plus envie de revenir vers le théâtre ou vers la réalisation de films ?
Ah, les deux ! Depuis que je suis arrivé en France, j'essaie de reprendre mon métier mais mes agents ne sont plus vivants, des acteurs de ma génération comme Philippe Léotard, sont partis. Quand je fais un casting, je me retrouve parfois devant une jeune directrice qui me demande si j'ai déjà joué devant une caméra… Quand je dis que j'ai une quarantaine de films derrière moi, elle se demande si c'est vrai. Alors je montre sur mon mobile : "Tiens, là c'est Jeanne Moreau, là c'est Belmondo…". Il n'y a pas de mémoire en fait, c'est l'un des inconvénients. Pourtant en 2015, par exemple, quelqu'un m'a appelé de Brasilia et il connaissait ma carrière mieux que personne en Afrique. Il m'a cité un " seul en scène ", Les Déconnards de Koffi Kwahulé (1999), la dernière pièce que j'ai jouée à Avignon avant de partir en Côte d'Ivoire, et m'a invité à venir dans un festival de théâtre contemporain dont il s'occupe à Brasilia. Mais il suffit d'aller sur des sites pour voir qui je suis, et comme me l'a dit Danny Glover, je suis même sur Hollywood.com. En ce moment, je cherche une salle pour me produire et aussi ouvrir des cours de formation d'acteur mais c'est en attente.
- Quels sont les nouveaux rôles qu'on vous propose au cinéma ?
J'ai eu deux propositions quand je suis allé au Sénégal. L'une est l'adaptation de Combat de Nègres et de chiens de Bernard-Marie Coltès, par Jo Gaï Ramaka. L'autre est une production de Moctar Ndiouga Bâ qui va générer une série de quatre épisodes où j'ai le deuxième rôle. Ils veulent simplement savoir si je suis en bonne santé après tout ce qu'ils ont pu imaginer que j'ai traversé…
- Et que venez-vous de tourner dernièrement ?
Je viens de tourner en Chine, récemment. Quand je suis revenu du festival de théâtre au Brésil, j'ai sauté dans un avion pour aller en Mongolie, faire le rôle d'un général soudanais. La production a préféré reconstituer le Soudan en Mongolie plutôt que d'aller y tourner. Et ça s'appelle China Salesman de Tan Bing avec Steven Seagal, Mike Tyson et Eriq Ebouaney qui joue un rôle important. C'est un film en anglais qui est à l'affiche en Chine depuis cet été. On a travaillé sur la post synchro en France et je croyais que c'était pour être doublé en français mais non, il est interprété en anglais et en chinois.
- Donc on vous voit en Chine, vous avez des projets au Sénégal, vous travaillez en France… Ne dirait on pas que vous êtes visible sur la plupart des continents ?
Ah oui, et même en Amérique où j'ai joué le monologue de la pièce Les Déconnards, en français devant des Brésiliens. Le texte défilait traduit en brésilien au-dessus de ma tête. Et les gens réagissaient bien.
S'aguerrir dans la réalisation de films
- Avec tous ces rôles divers, comment avez-vous pu envisager de passer à la réalisation, en fait ?
Avant le mouvement suscité par Les Guérisseurs, Ayala, ma femme, me disait : " Il ne faut pas que tu sois assis, en train d'attendre. Tu as une double formation d'acteur et de metteur en scène importante. Tu peux faire des films. " Et c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer devant de grands réalisateurs comme Jacques Champreux, Georges Lautner, qui me disaient de regarder dans l'objectif et me laissaient venir jusque dans la salle de montage jusqu'à la finition, aux trucages.... Finalement, j'apprenais aussi mon métier de réalisateur. J'apprenais à convertir mon métier de metteur en scène en celui de réalisateur de cinéma. Les Guérisseurs (1988) a été l'un des plus gros budget du cinéma africain de l'époque avec un milliard de francs cfa lourds, avant la dévaluation. Après ça, j'ai fait un film de deux minutes trente pour CFI, puis une trentaine de courts-métrages de huit minutes pour TV5, qui passaient tous les samedis. C'était Le Nord est tombé sur la tête dont j'étais l'acteur principal et j'en ai réalisé un bon nombre d'épisodes. Puis j'ai fait mon deuxième long-métrage, Tanowé des lagunes (1994), que je vais essayer de remastériser. C'est peut-être le film que je préfère de toutes mes réalisations. Ça aborde l‘écologie et l'ACCT m'a aidé à produire avant que ça devienne l'OIF. Je vais essayer de le retravailler à partir de leur master. Mais le film béni de ma carrière de réalisateur, c'est Roues libres (2002). On a eu le soutien du CNC, ARTE, l'Europe, la Francophonie. Il a été sous-titré en anglais et diffusé aux États-Unis, au Pan African Film Festival. Il vient de passer au dernier Festival du Film Francophone d'Angoulême durant l'été 2017. Mon quatrième film sera celui qui est écrit entièrement pas Ayala, et elle y a mis son "trip"…
- Où en est ce projet, basé sur le scénario de Ayala ?
Ça s'appelle Au bout du chemin et c'est le quatrième long-métrage que je dois réaliser. Elle l'a écrit pour que je le mette en scène. Là, il faut que la production se réunisse et que je puisse le réaliser sans tarder.
- Et de quoi traite Au bout du chemin ?
La toile de fond, c'est l'Afrique avec ses multiples problèmes qu'on connaît : des coups d'État, des enfants soldats… Ce qui est sur le devant du film, c'est une jeunesse pétillante qu'on trouve sur les campus universitaires. Ils sont de milieux différents mais n'ont qu'un rêve : comment faire avancer l'Afrique pour que ce ne soit pas toujours le drame. Le drame est là, il existe, il est vivant, on le sent, on le voit en filigrane. Deux des personnages importants du film sont un musicien rappeur, et une fille qui étudie l'architecture en aimant fredonner. Elle sera jouée par une vraie chanteuse. C'est une jeunesse pleine de discussions, de challenges entre elle, qui ne compte pas sur les dirigeants car ils commencent à vieillir quand même sur ce continent ! Depuis 1960, ce ne sont plus les mêmes mais la méthode n'a pas changé. Je suis bien placé pour le savoir puisque j'étais adolescent quand les pays d'Afrique de l'Ouest sont devenus indépendants. On est un peu les aînés de nos indépendances. Ce qui est important dans le film écrit par Ayala, c'est qu'il y en ait qui comprennent que quand il y a le feu à la demeure chez le voisin, c'est chez eux. Donc ouvrez les frontières, donnez-vous la main, aidez ceux qui sont en difficulté et là vous sauverez un continent, et donc une partie du monde. Le rêve de Ayala, c'est que ce bout de chemin arrive. Donc ça s'appelle Au bout du chemin… Ca suggère comme je le pense, que celui qui ne sait pas recevoir ne saura jamais rien donner.
Elargir son rôle de médiateur culturel
- Vous sentez-vous comme un ambassadeur culturel lorsque vous faites ce genre de déclaration ? Avec tous vos voyages, vos cultures, peut-on prendre ce que vous dites comme une sorte de message ?
Oui, mais c'est plus un destin qui me caractérise. Je suis parti d'une petite ville où je n'ai pas porté de chaussures jusqu'à l'âge de 13 ans, pour me retrouver dans les grands salons de Paris et être sur scène à 22 ans, avec un monstre sacré comme Jeanne Moreau. D'ailleurs Jack Lang m'a vu quand j'avais une vingtaine d'années et il me disait : " Tu es comme un ambassadeur culturel, et il faut que tu dises la même chose. " A l'époque, il dirigeait le Festival mondial du théâtre de Nancy qu'il avait créé, et il venait souvent à Abidjan. Puis il a été plusieurs fois ministre en France, et il m'a même vu me pendre avec les dents au cirque pour le Gala de l'Union des Artistes. A l'origine, j'étais parti pour deux ans au Palais de la Culture d'Abidjan et à la fin de mon mandat, dix après, avec les ouvertures que j'ai pu avoir tant avec les Européens que les Américains, j'ai préféré donner ma démission. Et puis je n'aime pas rester au même endroit. C'est ce qui me pousse souvent à changer et à ce moment-là, on m'a proposé d'être ambassadeur. J'ai été nommé avec un décret présidentiel, ambassadeur de la culture itinérant. C'est le poste que je devais assumer et puis il y a eu la crise en Côte d'Ivoire et je suis venu en France. Maintenant je suis en attente que cette réhabilitation se fasse puisque le rêve de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est de dire : " On est fatigués de la guerre, des rivalités, jusqu'à être fatiguées de la fatigue de ça… " Il y a des pays qui ont connu des crises plus violentes que les nôtres et qui sont aujourd'hui sur les rails, qui ont avancé. Se pardonner, avancer, c'est mon rêve en tant qu'ambassadeur. L'artiste que je suis, puisque je suis toujours resté sur mon terrain qui est artistique et je ne suis jamais allé dans le domaine de la politique, apprécie tous ceux qui disent : "Il faut que ce pays se réconcilie, que des enfants viennent, que des gens ne meurent pas à l'étranger parce qu'ils sont exilés". Dans la pièce Les Déconnards que j'ai été jouée au Brésil, le personnage qui est asthmatique, pense toujours à l'Afrique dans sa chambre de bonne. Il dit : " Mourir à l'étranger, c'est comme si on n'avait jamais vécu. Parce qu'un étranger, c'est quelqu'un qui accroche sa vie comme on accroche son manteau à l'entrée d'une maison. C'est quelqu'un qui attend de vivre. "
- Cette citation s'applique t'elle à la Côte d'Ivoire ?
Je souhaite non seulement que ça s'arrange pour la Côte d'Ivoire mais pour tous les pays d'Afrique ou du monde, où les gens sont exilés. Avant toute chose, l'ambassadeur que je suis, et qui aujourd'hui va au-delà du simple ambassadeur de la culture, pense que la culture, c'est ce qui est le plus fédérateur que ce soit à travers la musique, la peinture, le théâtre, le cinéma… Parfois on doit montrer des atrocités pour dire : " Plus jamais ça ! ". Certes quand on témoigne, on prend parfois des coups très durs mais justement, si on témoigne, c'est pour éviter qu'on ne refasse nos erreurs constamment. Témoigner ne veut pas dire qu'on prend parti pour quelqu'un. Mais qui dans un conflit, n'a pas fait quelque chose ? Qui n'a pas fait du tort et n'a pas raison en même temps ? Oui, je suis ambassadeur depuis avant les élections ivoiriennes mais pour l'instant je suis sans portefeuille. Alors je n'attends pas le portefeuille mais j'attends de continuer à faire mon travail tant à travers les oeuvres comme le film de Ayala que je souhaite réaliser, que collaborer avec deux réalisateurs sénégalais, ou Christian Lara qui a encore deux films à faire avec moi dont peut-être un James Bond à sa façon. Là, je suis dans ces projets de cinéma mais j'adore encore plus le théâtre parce que c'est direct. Sentir le public, sentir les parfums qui se dégagent de la salle, la chaleur même des silences… Cette communion directe avec le public n'a pas de prix pour moi. Le cinéma, c'est autre chose, ça va beaucoup plus loin. Mais le théâtre, j'aime beaucoup parce que c'est de là que je viens !
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
Paris, Africiné Magazine
pour Images Francophones
Image : Sidiki Bakaba, acteur et réalisateur ivoirien.
Crédit : Michel Amarger, Africiné Magazine
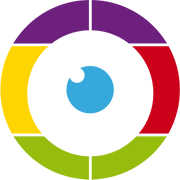 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images