Rencontre avec Rahmatou Keïta, autour de son film L'Alliance d'or (Zin'Naariyâ !)

Pour exalter les cultures sahéliennes
L'Alliance d'or (Zin'Naariyâ !), premier long-métrage de fiction de Rahmatou Keïta trouve une bonne audience dans les festivals africains tout en cherchant sa place sur les écrans du Nord où il sait dérouter et séduire. Rahmatou Keïta avait bénéficié du soutien du Fonds Image de la Francophonie (OIF) pour son documentaire Al'lèèssi… une actrice africaine, sorti en 2004.
Rahmatou Keïta revendique avec fierté ses origines sahéliennes. Née au Niger, originaire de familles peuhle, songhaïe, haoussa, elle grandit en savourant les récits de son père, élevé au Sultanat de Zinder. Elle cultive son apprentissage de la philosophie et la linguistique à Paris où elle s'installe pour entreprendre une carrière de journaliste. Devenue une des premières Africaines active sur les écrans français, elle récolte des récompenses avec l'équipe de " l'Assiette Anglaise " sur Antenne 2.
Le désir d'écriture la conduit à publier SDF, Sans Domicile Fixe, chez J-C. Lattès, en 1993, alors qu'elle se lance dans la réalisation de sujets pour la télévision, et de films indépendants qu'elle produit avec sa société, Sonrhay Empire Productions. Rahmatou Keïta est une femme de tête, et de coeur. Elle réhabilite l'image de la première comédienne du Niger, Zalika Souley, par un documentaire remarqué, Al'lèèssi… une actrice africaine, 2004. Présenté au Festival de Cannes, il reçoit le Sojourner Truth Award et conforte la cinéaste dans son désir de promouvoir le Sahel.
Elle entreprend un court-métrage de fiction, L'Alliance (Jin'naariyâ !), 2014, sélectionné au FESPACO, lauréat du Meilleur court-métrage en Tanzanie, retenu au Short Film Corner de Cannes. Ce film condense la thématique développée dans L'Alliance d'or (Zin'naariyâ ! | La baque de mariage), 2016, en montrant l'attente d'une femme qui se décide à accomplir un rituel pour que son amoureux revienne l'épouser.
Amplifié par le long-métrage, les couleurs du Sahel éclatent au Festival de Toronto où le film est dévoilé. Il reçoit le Prix de la Meilleure image au FESPACO 2017, consacrant l'apport du chef opérateur, Philippe Radoux-Bazzini, le Prix Spécial du jury au Festival international du film musulman de Kazan 2017. Vu dans quelques manifestations en Europe comme le Festival du Film d'Amiens, Ciné Regards Africains à Cachan, L'Alliance d'or impose le rythme des récits sahéliens, en valorisant l'aristocratie, les émotions féminines et la richesse du patrimoine.
Rahmatou Keïta marie les traditions de sa région avec la modernité de son approche singulière pour charmer sans concession. Elle évoque le sens de sa production, délibérément africaine.
Quel est le sujet développé par L'Alliance d'or (Zin'naariyâ !) ?
C'est une histoire d'amour peuhle parce que ma culture dominante, c'est la culture peuhle [ou foulani, ndlr]. Les Sahéliens sont des gens très introvertis, très pudiques et les Peuhls sont des " malades " de la pudeur, de l'introversion… Je voulais raconter cette histoire peuhle, du point de vue songhaï parce que j'ai aussi une culture songhaïe très grande. Parfois je suis Peuhle et je regarde les miens avec un regard songhaï, et parfois je regarde les Songhaïs avec un regard peuhl. Je voulais mélanger tout ça et mettre dans le film ces langues que je trouve très belles, très expressives avec un sens de la vie, de la recherche d'harmonie. Même dans les salutations, pour dire : " Bonne nuit ", on dit : " Que la nuit t'enveloppe de douceur ". C'est tellement doux, joli. C'est calme, c'est serein.
Pourquoi avoir situé l'attente amoureuse de l'héroïne, en hiver ?
Nous, on a un hiver, et les hivers sont très froids. Dans mon pays, on va jusqu'à -10°. On est dans l'hémisphère nord. J'ai voulu tourner en hiver parce que j‘aime ces lumières. Les journées sont ensoleillées et les lumières sont belles. Les nuits sont très froides… Tiyaa, l'héroîne, vient pour les vacances d'hiver et on attend que son prétendant vienne faire sa demande de mariage avec la dot qu'il doit apporter. Chez nous, c'est l‘homme qui apporte la dot. En général dans l‘aristocratie, cela correspond à son pesant d'or. Tiyaa est angoissée, elle l'attend d'abord parce qu'elle est amoureuse mais en plus elle a fait une bêtise que je ne dévoilerai pas. Donc il faut réparer très vite et ses copines vont l'aider en consultant un marabout.
On voit cette jeune femme qui a des souvenirs, des flashbacks de sa vie amoureuse en France. Pourquoi ce qu'elle fait n'est pas précisé ?
Au début, on ne sait pas. Elle est là, elle joue avec des enfants. C'est émouvant d'ailleurs puisqu'elle raconte comment le griot de son père lui a appris que le jeu des enfants qu'elle partage est une vraie école. Elle n'avait plus joué jusqu'à ce jour-là. Il y a aussi la belle guitare songhaïe de Johnny Ali Maïga qui est mort [le 08 juin 2015, ndlr] quelques jours après le tournage, malheureusement. J'avais envie de le faire connaître et le preneur de son français, Laurent Malan, avait enregistré des morceaux de lui. On a dit qu'on allait en faire un disque. Et puis il est parti. La vie est comme ça, on ne maitrise pas tout. Mais c'est déjà ça qu'il soit dans ce film, qu'il voyage partout. Donc j'aime les histoires où on prend le temps de vivre, et puis c'est romantique. C'est du romantisme. L'Alliance d'or, c'est une romance.
Quelle fonction ont les flashbacks tournés en France ?
J'avais envie de montrer les rappels. Par exemple, quand maladroitement, elle casse un verre au restaurant, parce qu'une des servantes avaient cassé un canari à la rencontre de son amoureux. C'est le signe pour une femme, de dire qu'elle aime un homme. Je le raconte dans Al'lèèssi… une actrice africaine aussi. C'est faire semblant de trébucher en revenant de la rivière et de casser sa jarre d'eau. Je voulais montrer ces signes. Comme on ne parle pas chez nous, comme on ne dit pas, on montre. Et puis il y a des cultures où on dit mille fois par jour : " Je t'aime " et c'est faux. Quant à l'homme qui convoite Tiyaa, mon père m'avait raconté une histoire d'amour où l'homme devait déposer son poignard ou son sabre, par terre pour dire qu'il est amoureux parce que quand on l'est, on est désarmé. Donc pour faire ce rappel, il fallait les montrer au restaurant où maladroitement, ou pas, elle casse un verre et où son fiancé se moque d'elle en disant : " J'ai compris ". Il fallait aussi les voir ensemble à l'université sinon comment raconter qu'elle est amoureuse. Il fallait donc montrer le garçon. En plus, j'ai trouvé un beau garçon de Guinée Bissau, un Sahélien parce que son père est Peuhl. Il s'appelle Theo Kleiner.
Mais était-ce nécessaire de montrer leur relation en France ? S'il n'y avait pas ces flashbacks, on restait dans l'atmosphère sahélienne, sans rupture d'image…
Dans les flashbacks, il fallait aussi raconter le moment où elle a transgressé les règles. Là-bas en France, on est seul donc il n'y a personne, pas de garde-fous. On peut expliquer ça par le flashback sinon raconté comme ça… Et puis la proximité des corps, je ne peux le raconter que si ça se trouve en Occident. Je ne peux pas si c'est chez nous, parce que c'est impossible. Dans notre culture, c'est impossible.
Tiyaa est quand même assez résistante à la rencontre avec le marabout pour effectuer les rites qui permettraient de dénouer la situation. Pourquoi est-elle si rétive ?
Oui, c'est aussi pour sortir de ce cliché car chez nous, ce n'est pas tout le monde qui croit aux médiums. D'ailleurs elle le dit à sa copine : " Je n'aime pas aller chez le marabout, je suis comme ma mère. " Et sa mère n'est pas allée faire l'université en France…
Est-ce possible de le faire attendre comme elle fait avant d'y aller ?
Mais elle ne veut pas y aller. C'est quand sa copine pique son orgueil en lui disant : " Cette mauvaise éducation, tu l'as prise en Europe. Là, il y a quelqu'un qui a l'âge de ton père ou de ton grand-père qui t'appelle et tu devrais venir. C'est le minimum de politesse et de respect. " C'est comme ça qu'elle y va, et elle n'y croit pas du tout. Mais ça l'intéresse. Quand sa copine lui dit ce qu'elle a fait par rapport aux directives du médium, elle répond : " Mais il ne fallait pas faire ça ! ". Et l'autre éclate de rire en lui disant : " Ça t'intéresse alors ! "
On peut ne pas croire en ces pratiques et que ça marche ?
Il y a quelque chose qui se fait. Mais l'interdit, c'est qu'il y a cette fameuse alliance d'or dont il ne fallait pas faire quelque chose et on croit que ça a été fait quand même. C'est comme dans les tragédies grecques, les choses se placent pour que le destin arrive, pour que la destinée soit accomplie. Après, est-ce que c'est l'oracle ou pas ? On ne sait pas. Je ne sais pas si ce qu'il a demandé de faire, toutes les pratiques pour que le mariage se fasse, si ça marche ou pas. En tous cas, il a vu que ce mariage devrait se faire. Mais on ne sait pas si c'est l'oracle qui agit.
Même vous, en écrivant le scénario, vous ne le savez pas ?
Moi, de toutes façons, j'ai un peu changé la fin parce que j'avais envie justement que ce soit dans le non-dit, que chacun tire sa conclusion. Après, j'ai eu envie de ces musiciens du Kanem donc de Maiduguri et de Diffa, avec leurs belles trompettes à la Dizzy Gillespie, ou c'est l'inverse, avec les joues qui gonflent, leurs costumes extraordinaires. Pour les mettre dans le film, il fallait que je traite le scénario autrement. D'ailleurs le court-métrage que j'ai réalisé avant, L'Alliance (Jin'naariyâ !), en 2014, est filmé avec la fin du premier scénario que j'avais écrit pour L'Alliance d'or. Les gens croient que le court était un teasing du long mais pas du tout, c'est une histoire en soi.
Une production résolument africaine
Qui avez-vous pu mobiliser pour engager des fonds sur le film ?
Le premier pays qui l'a retenu, c'est l'Algérie. Il y avait le PANAF en 2009, le Festival panafricain d'Alger. L'Algérie avait demandé des scénarios pour produire quatre courts-métrages et quatre documentaires de long-métrage. Moi, j'avais jeté mon scénario à la poubelle car j'avais postulé dans plusieurs pays européens et il était chaque fois rejeté. Je précise : dans plusieurs pays européens donc pas les mêmes cultures, pas les mêmes langues... À un moment, on peut avoir l'humilité de dire : "Tu aimes bien ton film mais ça ne marche pas." Quand j'ai eu l'information sur l'appel de l'Algérie, j'ai ressorti mon scénario de la corbeille, je l'ai envoyé. On a été invité pour parler des scénarios et à l'arrivée, le mien a été retenu à l'unanimité du jury. Je me suis dit alors : " Il y un problème. Entre zéro en Europe et 100% en Afrique, ça fait un grand écart. " J'ai réfléchi là-dessus et je me suis dit qu'il devait y avoir aussi une dimension culturelle. D'abord, c'est vrai que je ne suis pas dans le cliché. C'est comme dans Al'lèèssi… une actrice africaine, et j'ai beaucoup de mal à trouver des fonds pour faire des films. D'ailleurs, des producteurs me l'ont dit en France : " Si tu faisais l'excision, les femmes battues, ça irait. " Mais chez nous, on ne bat pas les femmes ! Même s'il paraît que ça commence… L'excision, les pays proches de chez moi ne la pratiquent pas ! C'est vrai qu'on le fait et qu'il faut le combattre mais j'ai envie de raconter autre chose. Donc je ne suis pas dans le cliché et je créé des histoires où peut-être les Africains se projettent, et pas les Européens. Être d'une famille aristocratique dans un beau palais, ça nous plaît, et pas aux Européens ! On a peut-être des huttes mais on a aussi des palais, des villes millénaires. C'est là que je me suis dit, si je raconte des histoires de chez nous, du point de vue de l'intérieur, du point de vue africain, alors c'est à l'Afrique de payer pour ses histoires. Sans culture, il n'y a pas de peuple. C'est comme ça que je me suis tournée vers l'Afrique. Fort de l'Algérie qui est très respectée sur le continent car ça a été le fer de lance de nos révolutions, je suis allé voir les quelques pays dont je suis persuadée qu'ils sont militants pour leur culture. Par exemple, le Congo Brazzaville. Il y a des quartiers entiers de résidences d'artistes à Poto-Poto où l'État prend en charge leur hébergement, leur travail, leur restauration. Il y a des maisons d'édition, ce grand centre des cultures Bantous. Il y a le Rwanda où depuis la guerre, il y a leurs langues qui reviennent, leurs cultures, leurs danses, leur littérature, leur cinéma. Le Zimbabwe aussi est militant. La dernière guerre d'indépendance, c'était avec Robert Mugabé. Il fait partie des héros de l'histoire malgré tout. Et puis le Niger, comme c'est mon pays, je suis arrivée quand même à le convaincre. Il y a encore le Royaume du Maroc et l'Ouganda aussi.
Les fonds récoltés dans ces pays ont-ils suffi à financer le film ?
Non bien sûr, ce n'était pas suffisant. Je n'ai eu que 20 à 30% du budget prévisionnel mais j'ai fait avec ce que j'avais.
En combien de semaines avez-vous pu tourner ?
Je voulais faire le film en 12 ou même 16 semaines pour être bien, montrer cette lenteur. J'ai tourné en seulement trois semaines. Ça m'a achevée… Pendant le temps du tournage, il fallait surveiller les virements bancaires, prendre soin de payer tout le monde à temps sinon les participants sont stressés, pas contents, et ça se ressent sur le film. Donc il fallait gérer tout ça avec la production.
Vous employez des techniciens européens et des acteurs qui viennent de France. Pourquoi n'avoir pas utilisé que des techniciens et une équipe qui soit nigérienne par exemple ?
Parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut en équipe technique de cinéma au Niger. Mais la plus grosse équipe est venue du Burkina Faso. Le producteur exécutif, Sékou Traoré, a emmené ses collaborateurs et je ne le remercierai jamais assez parce que sans eux on ne serait pas allés au bout. Ils étaient bien soudés avec moi. Il y avait aussi trois techniciens français. Les acteurs étaient français et nigériens, avec un Burkinabé. Tous étaient d'origine africaine. Les noms des personnages n'étaient ni chrétiens ni musulmans sauf un nom presque chrétien. Celui qu'on appelle le témoin est un Mossi dénommé Isidore. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup raconter les histoires que nous disaient les parents ou les grands-parents. J'écoutais tout le temps quand les gens venaient, ils se rencontraient pour négocier quelque chose, arranger un mariage… Mon père faisait toujours appeler un voisin qui était Mossi et il disait : " Allez le chercher, lui il est intègre. Et des générations, des années plus tard arrive au Burkina Faso, un monsieur nommé Thomas Sankara et qui appelle le pays, " le pays des hommes intègres "... C'est incroyable.
Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est inscrit dans le langage ?
Mon père disait que Bé signifie peuple en langue peuhle, et Burkina c'est songhaï. Isidore, c'est le deuxième prénom de Thomas Sankara. Voilà pourquoi j'ai mis Isidore. Je n'allais pas chercher Sankara pour l'afficher, je suis un peu plus fine que ça mais j'aurais peut-être dû mettre Thomas on aurait compris… Pourtant ça faisait trop chargé.
L'esprit de Sankara est donc dans le film…
Oui, quand j'ai présenté le film au FESPACO, en conférence de presse, j'ai demandé qui connait un héros qui s'appelle Isidore, et personne n'a trouvé sur le moment. Pourtant on écrit : Thomas Isidore Sankara. Mais son esprit est dans le film où il y a un Mossi très digne.
On remarque dans L'Alliance d'or, le soin apporté à la qualité de l'image, les costumes. Était-ce important de chercher à faire beau ?
Mais oui. J'ai d'abord voulu rendre la beauté qu'il y a chez nous. Et puis les costumes de plusieurs peuples disparaissent aussi. La lumière, l'image sont déjà dans mon court-métrage, L'Alliance, où c'est un peu les mêmes costumes, les mêmes lumières. C'est donc en hiver avec ses belles lumières que j'aime. L'après-midi surtout, elles sont très belles. Ça commence quand le soleil va partir par un jaune citron qui mûrit, qui passe à l'orange, puis couleur jus de cola, très sombre. Après ça passe dans les violets, les bleus. C'est une chose qui donne le tournis. Quand je raconte ça à mes copines d'enfance au Niger, elles me disent : " Mais où est-ce que tu vois du bleu et du violet ? " Mais voilà, c'est dans le film donc ces couleurs-là existent.
Privilégier l'émotion pour transmettre des rites
Comment avez-vous orchestré le mélange des langues avec les acteurs pour ce long-métrage ?
Souvent on arrive dans une conversation où chacun parle sa langue et on converse comme ça. Je voulais le montrer et j'avais peur d'être dépassée par ça, d'avoir à surveiller si chacun restait sur sa langue sans prendre sur celle de l'autre. Il n'y a que le Mossi que je ne comprenais pas et j'ai fait confiance au tournage. Quand ça a été traduit, c'était fidèle. L'actrice principale est ma fille [Magaajyia Silberfeld, ndlr] qui est étudiante et a appris le cinéma et le théâtre aux États-Unis. Elle m'a remplacée pour les répétitions et m'a appuyée dans les échanges avec les autres acteurs. Et puis il y a Mariam Kaba qui joue en mandingue mais je parle cette langue et je la comprends donc ça allait. Le problème de fond, c'est que je voulais des têtes d'affiche aussi et je n'ai pas pu les avoir. Mais j'ai pu travailler avec Mariam Kaba et puis j'ai dû réduire sa partie parce qu'on ne pouvait pas rester longtemps pour tourner.
Quel est son rôle dans l'histoire ?
Elle est la scarificatrice. N'oublions pas que Mariam Kaba a joué la femme de Lumumba dans le film de Raoul Peck. J'ai eu aussi une star du Nigéria qui est l'amoureux éconduit dans le film. C'est un grand acteur de Kano. Il est Haoussa. Quand on m'a dit Tiyaa tombe amoureuse d'un garçon d'un autre pays, j'ai sursauté parce que pour moi, il n'est pas d'un autre pays. Il est du pays haoussa. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un de Kano, de Maiduguri, venait d'un autre pays. Ce sont nos royaumes, nos empires. D'ailleurs dans le film, il parle la même langue, haoussa. Même si à Kano, ils sont un peu plus snobs… A Kano, c'est le même Haoussa que celui de Zinder, au Niger. Mais ils ont des emprunts anglais pour faire chic et ils se moquent de l'autre haoussa en disant que les gens sont trop dans la tradition. C'est comme pour la langue songhaïe, les gens de Gao sont très snobs parce que c'était la capitale de l'empire. Nous, on les regarde fascinés comme ça…
Avec toutes ces nuances, ne dirait-on pas que L'Alliance d'or peut être plus perceptible par un public au fait de la culture africaine ?
Je dirais que ces nuances sont perceptibles par un public au fait de la culture sahélienne. Les autres ne les verront pas. Le plus important, ce n'est pas le noyau du film où il y a beaucoup de choses qui échappent. C'est comme quand on traduit un livre de Sigmund Freud. Dans ses écrits, il rappelle toujours les termes allemands pour montrer comment il les traduit et pour dire que cette traduction, on la prend comme on veut mais ce n'est pas exactement ça. Il y a beaucoup de choses qui échappent quand on passe d'une langue à l'autre. Quand on passe d'un film à l'autre, il y a plein de codes différents. Si je parle de Stars Wars, la saga créée par Georges Lucas, ou des histoires de Michael Cimino, il y a plein de choses que les Américains comprennent et que nous ne comprenons pas. Ça n'empêche pas qu'on aime les films. C'est comme une belle chanson de Mickael Jackson quand on ne parle pas anglais. Elle émeut, on n'a pas tous les détails mais l'oeuvre est là et elle est belle. Je peux aussi parler de Miles Davis…
Ca ne vous dérange donc pas qu'on ne puisse comprendre certaines choses. S'agit-il de communiquer au-delà de la compréhension ?
Oui, ça ne me dérange pas. J'aurais bien voulu mais ce n'est pas possible, c'est pourquoi je parle de grandes œuvres comme Freud ou Nietzsche. Quand on le traduit en philosophie, on remet les termes dans la langue originale pour voir si on peut embrasser comme ça ce terme, ou si on a accès aux clés de cette langue originale. On doit le poser parce que ce terme est là et montrer qu'on l'a traduit comme on peut. Ça concerne la traduction mais au cinéma, ce sont des adaptations. Même ce qui est traduit dans mon film, ce que j'ai traduit moi-même, ce sont des adaptations. On essaie de montrer le plus près qu'on peut dans la culture qu'on veut transmettre, dans l'autre culture à laquelle on veut avoir accès, le plus près du symbole ou du terme.
Dans le contexte actuel de la diffusion du cinéma au Sahel et autour, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, n'est-il pas utopique de penser que le film va pouvoir être vu par beaucoup de spectateurs ?
Mais moi, j'espère qu'il va être vu par beaucoup de spectateurs !
Comment allez-vous le distribuer pour ça alors ?
Ah ça, ce n'est pas mon métier ! Mon métier, c'est de faire des films. D'ailleurs ce n'est pas un métier, c'est une passion. Si ce n'était pas une passion, on ne le ferait pas. C'est ce que je disais en parlant d'œuvre d'art. Il y a des gens qui ne parlent pas anglais et qui aiment Miles Davis. De toute façon, dans la transmission d'une œuvre, il y a des choses qui vont échapper. Même si ce n'est pas culturel, ça peut être personnel. Il n'y a pas longtemps, à Amsterdam, je regardais une toile de Pierre Paul Rubens. Il y avait des choses qu'on expliquait sur le tableau, des symboles, des éléments, qui rappelaient l'enfance de Rubens que quelqu'un qui regarde ne peut pas savoir. Ça n'empêche pas que le tableau est beau. Après, c'est à ceux qui vont étudier l'oeuvre, la décrypter, la disséquer, de la comprendre. Moi si je ne disais pas que Isidore, c'est Sankara, ça ne se saurait pas. C'est mon histoire à moi et à mon père. Mais quelqu'un qui va se spécialiser dans l'histoire du cinéma ou du Burkina, va être étonné à un moment qu'il y ait un Mossi qui s'appelle Isidore, et certainement il va faire le lien. Dans le film, il y a plein de choses comme ça, sur ma famille, sur les nomades, sur la petite fille dont le frère caresse les cheveux en lui disant : " Oh, les filles de la ville… ", qui m'appartiennent. Mon histoire a inspiré L'Alliance d'or.
par Michel AMARGER
Paris, Africiné Magazine
pour Images Francophones
Image : Rahmatou Keïta, réalisatrice, scénariste, actrice et productrice nigérienne, au Fespaco 2017, avec le trophée de la Meilleure image (pour Philippe Radoux-Bazzini)
Crédit : DR / ACP Films
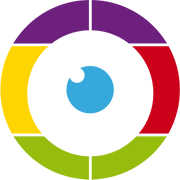 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images