Rencontre avec Ghassan Salhab, auteur de La Vallée. Le sillon fertile du cinéma libanais

La sortie en France du nouveau film de Ghassan Salhab, le 23 mars 2016, est l'occasion de renforcer la visibilité de la création libanaise.
Dans ce petit pays, cerné par les troubles, miné par les fractions, le cinéma d'auteur s'amplifie grâce à des artistes inspirés, à vif, exigeants. Ghassan Salhab est de ceux-là. Révélé par Beyrouth fantôme, 1998, il exporte les questions liées à l'identité libanaise et ses strates, dans des fictions amples, tendues, comme Terra incognita, 2002, Le dernier homme, 2006, ou des essais plus intimistes tels Narcisse perdu, 2004, (Posthume), 2007, souvent en regard avec l'Histoire.
En multipliant les axes, Ghassan Salhab atteste de la pluralité des champs investis par les cinéastes libanais indépendants. Dans La Vallée, 2014, il transporte le public au cœur des montagnes du Liban. Un homme qui a perdu la mémoire après un accident d'auto, est pris en charge par un groupe mystérieux. Affairés par la fabrication de produits chimiques dans une villa, ses membres se sentent menacés. La montagne résonne de frappes militaires, de heurts inquiétants, destructeurs.
Au-delà de son argument, La Vallée se fait l'écho des affrontements communautaires, de la circulation des armes, des informations relayées par la presse, jetant les hommes les uns contre les autres. En signant un film épidermique sur la désintégration, l'égarement, porté par des comédiens expressifs, Ghassan Salhab épouse le temps lourd de La Vallée et ses paysages lumineux, irrigués par la terre libanaise.
Le défi est alors de toucher des spectateurs attentifs que ce soit en Orient ou en Occident. Nous avons rencontré Ghassan Salhab pour évoquer la diffusion de La Vallée mais aussi la production internationale qu'il a réunie, entre aides européennes et fonds arabes, dépassant les questions de moyens qui freinent les auteurs. En revenant sur le sens de sa démarche, le réalisateur revendique ses influences africaines (*), son engagement désillusionné mais persévérant, sa pratique d'une poétique de l'image qui pousse la réflexion sur l'art du cinéma contemporain.
S'inspirer de la vibration d'un lieu
- Que nous racontez-vous dans La Vallée ?
Cette vallée, c'est la vallée de la Bekaa au Liban. Elle est entre deux chaînes de montagnes dont le Mont Liban, et représente 40% du pays en termes de territoire. Derrière une de ces chaînes de montagnes, il y a la Syrie et Israël, nos deux voisins. Donc c'est un film qui se passe là-bas mais ce n'est pas un film sur là-bas. Je ne traite pas un sujet, je tente de faire une plongée… Si je dis : " C'est un homme qui perd la mémoire suite à un accident et qui est recueilli par des gens qui s'avèrent être des contrebandiers de drogue, plutôt novices ", on est dans le récit au sens traditionnel du terme. Ce n'est pas vraiment ce que je cherche puisque j'ai planté ça dans la vallée de la Bekaa. Pour moi la puissance du cinéma, ce sont les lieux, pas le décor, et ce que ça transpire, ce qui en est imprégné. Le Liban lui même est imprégné, il ne quitte jamais l'actualité depuis des décennies donc j'en tiens compte sans jamais en parler directement. Ça fait partie de ce que j'appelle " la mémoire collective ".
- Pourquoi mettez-vous en scène, justement, un homme qui perd sa mémoire ?
Parce que du coup, il devient une page blanche. Mais on n'est jamais une page blanche… Quant aux autres, ils sont là mais on n'en sait pas plus sur eux. On n'en sait pas plus sur ceux qui ont leur mémoire, leur tête, que celui qui ne l'a plus. Mon personnage est joué par un acteur avec qui j'ai déjà travaillé, Carlos Chahine. Il a un corps particulier sur lequel on peut inscrire quelque chose. Ce qu'il y a avec lui, c'est qu'il est autant menaçant que menacé… C'est "l'autre" dont on ne sait absolument rien qui m'intéresse, pas la mémoire avec le Liban qui veut faire une sorte d'amnésie. Donc avec la mémoire qui n'est plus là, brusquement, il n'y a plus que perception, plus que l'immédiateté, l'instant.
- Du coup, ce personnage semble un peu dérangeant au milieu du groupe qui le recueille. Il cristallise la position des autres notamment dans cette scène de repas, presque au centre du récit, où cette question des communautés différentes surgit. Pourquoi la souligner avec force dans la mise en scène ?
On est au Liban ! Le pays est largement et profondément encombré par cette question communautaire, d'identité. C'est la question de l'identification, de l'estampille. Là pour moi, c'est une moquerie. Cet homme qui est une page blanche, l'un de ceux qui l'entourent pense que d'abord, il faut lui donner un nom. Donc arrive forcément la question de savoir si c'est un nom avec une consonance comme ceci ou comme cela… C'est un peu une farce de ma part, et même de leur part à eux. Le Liban est un peu une caricature de lui-même. Actuellement il y a une absence de président, les Chrétiens pensent communautairement, comme les Sunnites, les Chiites... Evidemment ça bouge. Parfois c'est une affaire de Musulmans et Chrétiens, parfois c'est une affaire entre Chrétiens, parfois entre Musulmans, parfois ce sont des alliances incongrues. Au-delà de ça, c'est un plateau permanent et pour moi, ça m'intéressait qu'un homme qui est une page blanche, l'une des premières choses à laquelle pense l'un des personnages principaux du film, c'est de lui donner une identité… Ça m'intéressait, à un moment donné, de quitter l'abstraction même si les radios rappellent les conflits, la question des réfugiés, et d'aborder ce côté terriblement lourdingue que nous avons, nous les Libanais.
- Ce groupe de personnages a l'air de vouloir fabriquer une substance qui pourrait servir à accoutumer des soldats, des gens qui sont en guerre. Dans quel camp ça les situerait ça, un camp anti gouvernemental ?
Non pas particulièrement. Actuellement, il y a une rumeur qui dit que beaucoup de combattants, en Syrie en tous cas, comme il y en a eu pendant les guerres libanaises, prennent des substances pour pouvoir tenir le coup, aller dans des situations abracadabrantes. Il ne faut pas oublier que quand j'ai écrit ce film, nous étions très loin de l'horreur absolue qu'est en train de vivre la Syrie, l'Irak. Je ne suis pas un prophète mais quand on vit dans la région où le pire est toujours à venir… Donc celui qui fait de la drogue qui fait de l'argent, fait de l'argent. Il se contrefiche de savoir qui va lui payer. Le capital est comme l'argent, il n'a pas de couleur, ni d'odeur. Les gens que je montre veulent faire de l'argent mais ils ne sont pas comme des mafieux traditionnels. Au Liban, circulent beaucoup de produits dont ceux utilisés par les combattants de Daesh. Le Liban fabrique tout ça, précisément dans la plaine de la Bekaa. J'ai puisé dans une réalité mais pas pour raconter cette réalité.
Diffuser pour établir un échange actif
- Comment espérez-vous qu'un public libanais reçoive votre désir de non raconter ?
Raconter ou pas n'est pas la question. Nous savons qu'il y a une démultiplication identitaire dans ce pays où chacun veut à tout prix s'inscrire ou ne pas s'inscrire. Les Libanais savent bien qu'il y a une fabrication autant de cocaïne que d'héroïne ou d'autres produits. Je n'invente rien, je puise et je le raconte différemment. Je m'appuie sur un récit pour aller au dedans du récit. Ce film s'inscrit au Liban et je tiens compte des choses que je n'ai pas besoin de raconter, qui sont là. Quand la guerre advient à la fin du film, certains veulent la voir comme apocalyptique. Moi, je tiens à rappeler que l'apocalypse est une supposée délivrance selon les textes. Je la vois comme une répétition sans fin, une sorte de catastrophe permanente. Le cinéma n'est pas juste là pour raconter une histoire, à mon humble avis.
- Mais comment le public libanais peut-il prendre ces images que vous lui proposez ?
La Vallée a été distribué au Liban. Moi, je ne fais pas des films qui vont rencontrer de très larges publics. Ce n'est pas parce que je ne le veux pas, c'est une réalité concrète du " marché " qui me donne très peu de place. Le film est sorti dans une salle, au Metropolis, la seule salle indépendante à Beyrouth, et peut être dans le Proche-Orient. Que pensez-vous que le spectateur perçoive du réel, de la réalité ? Celle qu'on lui colle au front. Elle n'est pas uniforme, pas objective. Cette perception, ce n'est pas à l'art de la donner comme une information précisément. Je ne suis pas un informateur, le cinéma n'est pas du journalisme. J'essaie, à partir de ce que je sens et sais de là où je vis, de construire quelque chose qui traduise le désastre, cette espèce de menace permanente de la désintégration dans laquelle nous sommes. Je cherche à toucher une sorte d'état des choses, d'état d'être. Pour moi, le Liban n'est pas un décor dans lequel j'installe un récit. Le Liban est un corps constituant qui forcement affecte mon récit, lui-même tiré du Liban. Je pense que ce corps est profondément malade mais en même temps quand on connaît le Liban, on voit que c'est un malade qui bouge beaucoup de la queue, comme on pourrait le dire à propos d'un chien…
Quand un pays est dans une crise, les gens ont plus envie de recevoir un film qui soulage, distrait… Je ne suis pas dans ce courant là. Je ne fais pas mes films contre ce courant, je suis dans une démarche de cinéma marginal. Je l'assume et n'ai aucun problème avec ça.
- Qu'attendez-vous de la sortie du film en France ?
On sort en France mais pas comme Star Wars avec ses mille salles ! J'ai un rapport intime à la France. J'ai vécu des années entre Paris et Beyrouth. Même si ça a beaucoup bougé depuis le temps, Paris reste une ville où le rapport au cinéma est encore là. Quand on va voir un film qui vient du Liban, d'Argentine… ce n'est pas pour en savoir plus sur le Liban, l'Argentine mais c'est pour voir un film qui se passe là-bas. Il y a encore cette curiosité. On peut parler d'art cinématographique. Paris reste l'une des seules villes au monde où l'on peut voir un film qui vient d'ailleurs et où on a un rapport cinématographique avec lui. C'est rare. Même chez nous, les gens ont un regard exotique ne serait-ce que sur un film syrien, égyptien…
Donc j'espère un regard car ça me manque, puisque depuis mes deux premiers longs-métrages, je n'ai pas eu de sortie de salles en France. Mes films circulent beaucoup plus par le biais des festivals. Mais pour un cinéaste, il y a une grande envie de sortir en salles même si le film risque d'avoir une vie très courte. Evidemment j'espère qu'il reste plus longtemps, que le marché ne l'envoie pas paître au plus vite dès qu'arrive quelque chose de plus gros. Mais je ne suis pas naïf pour croire que l'art est dessus de tout. On lui donne une place ou bien on ne lui en donne pas.
Produire en fonction de ses moyens
- Pourquoi avoir choisi une production, et même une coproduction, plus étoffée qu'à votre ordinaire, pour aborder La Vallée ?
Quand on voit le générique, il y a une longue liste de noms mais ils ne portent que sur des petits chiffres. Le plus conséquent, c'est l'Aide aux cinémas du monde. Donc le soutien du CNC français reste fondamental. Il y a aussi le Fonds Francophone de Production Audiovisuelle du Sud [OIF, Paris, ndlr]. Je n'ai pas eu Arte. Terra Incognita que j'ai fait en 2002, a eu un budget plus important que La Vallée. Là, on arrive à un montant de 600 000 euros au grand maximum.
J'ai la chance d'avoir au Liban, des gens qui aiment travailler avec moi donc ils ont baissé considérablement leurs prix. J'ai ce "capital humain", comme je dis. Mais ce film ne pouvait pas se faire avec des sommes modiques. Il y a cet espace ample de la Bekaa dont je voulais rendre compte. On a tourné chronologiquement et j'ai eu la chance, pratiquement, que le climat suive l'évolution du film. Il était important que cette espèce de menace, d'état de chose qui va peut-être advenir ou peut être n'adviendra jamais, soit rendu. Je pense que le pire qu'on puisse avoir comme désastre, c'est que rien n'advienne mais que la menace soit permanente. Il était important que ça se passe avec une lumière quasi éclatante. La Bekaa est très vaste, il y a un ciel immense, la lumière est éclatante. Dans la tête des gens, le désastre c'est les ténèbres, le contraste, le clair obscur. En fait ici, il n'y a pas de clair-obscur sinon en nous, mais pas hors de nous. Tourner ça avec très peu de gens est un peu compliqué, cela dit. Pourtant je ne tourne plus du tout avec de grosses équipes puisque je filme en numérique pour des raisons économiques. Mais je n'ai rien contre et je ne le fais pas par dépit… Il faut additionner les petites sommes pour arriver à un budget. Et même si on additionne, on n'arrive pas au budget parce que après il y a les bonnes volontés qui font que le film se fait.
- Il était important pour vous d'aller chercher aussi des fonds arabes ?
Oui. Les fonds arabes existent et moi, en tant qu'Arabe, je vais évidement taper à leurs portes. Même si les gens du Golfe et leurs politiques me tapent sérieusement sur le système... Il y a Doha Film Institute au Qatar, et Sanad the Post Production Fund of the Abu Dhabi Film Festival aux Emirats Arabes Unis. Heureusement, ce sont des fonds qui fonctionnent de façon autonome puisqu'ils n'ont pas affaire avec les politiques. Il y a un fonds arabe aussi qui est le seul fonds indépendant qui s'appelle AFAC, Arab Fund for Art and Culture. C'est un fonds dont l'existence nous apaise un peu parce qu'il est vraiment indépendant dans le sens où il n'a affaire avec aucun État. J'ai eu ces trois fonds arabes ; mais si on les additionne, au total, ils ne font même pas 120 ou 130 000 dollars. C'est une bonne somme mais ceux qui font des longs-métrages savent que ce n'est pas suffisant. J'ai un producteur libanais qui est le producteur le plus important, en termes de chiffre et de présence, qui a mis aussi de sa poche. Évidemment je n'ai pas été payé… Tout ça pour dire qu'on fait des films en rabotant ici et là, dans le Tiers monde. Et ceux qui sont dans des pays encore pires que les nôtres économiquement, comme en Afrique noire, le font infiniment plus que nous… Donc je conçois et je construis mes films en fonction.
- Ainsi vos revenus ne dépendent pas uniquement du cinéma. C'est pour ça que vous enseignez, que vous faites autre chose à côté ?
Oui, je ne gagne absolument pas ma vie à partir de mes films. J'enseigne au Liban, je donne beaucoup de workshops, d'ateliers de formation, que ce soit ici ou dans d'autres pays du monde arabe, ou même en France. En même temps, ça me plait beaucoup parce que c'est une sorte de pont qu'on construit, non seulement générationnel mais avec les différents pays de la région. C'est ça qui me fait vivre.
- Ça vous paraît important justement de transmettre et de le faire dans des espaces culturels différents ?
Transmettre, c'est des deux cotés. Actuellement, avec tout ce qui se passe dans notre monde arabe, je dirais même c'est fondamental. Les ponts sont extrêmement rares et même quand ils sont là, ils sont souvent dynamités. Alors même si ce ne sont que des passerelles, peut-être que c'est mieux parce qu'on les remarque moins. Dans les rapports que j'établis dans les divers ateliers, je ne cherche pas du tout à construire des futurs cinéastes de la marge. Je l'assume pour moi mais elle ne se communique pas. On la porte en soi ou pas. C'est une forme de résistance que je me propose, et je ne suis pas le seul dans le monde du cinéma, dans le monde de l'art…
- Vous revendiquez une sorte de résistance mais on voit souvent que vous fédérez vos moyens avec d'autres cinéastes. On vous voit participer aux films de Lamia Joreige comme Et la vie est facile, 2015, appuyer un tournage et même jouer dans Revolution Zendj, 2013, de Tariq Teguia quand il vient travailler dans la région. Ces alliances régénèrent-elles votre cinéma ?
Plein de choses régénèrent mon cinéma… Tariq Teguia est un ami et ce n'est pas parce qu'il est passé ici que je l'ai aidé. On s'est connus avant, on est très proches. Ce sont des dialogues comme ça qui sont fondamentaux… Personne ne crée seul dans son coin. J'en ai avec des amis en Tunisie aussi et ailleurs que dans le monde arabe, bien entendu. Même si quand on construit un film, on est toujours dans une sorte d'isolement, le dialogue est fondamental. J'ai beaucoup parlé à Tariq Teguia de mon film précédent, celui-ci pas tant que ça puisqu'il était en train de faire le sien. Il m'a beaucoup parlé de Révolution Zendj et bien entendu, je lui apporté tout ce que je pouvais sur le terrain. Ce tissu de solidarité est fondamental. Je l'assume et je le revendique. Je suis très heureux d'ailleurs, de voir qu'actuellement au Liban, il y a plusieurs personnes qui construisent leur film comme ça. Je suis heureux qu'ils y arrivent aussi. La solidarité n'est quand même pas une mentalité très locale… Mais c'est fondamental surtout pour nous qui essayons de créer des choses sur place. Donc il se trouve que j'aime énormément le travail de Tariq Teguia, il s'avère que Lamia Joreige est une copine depuis longtemps. Il ne s'agit pas de créer un mouvement, il s'agit d'être présent, d'exister.
Prendre le temps d'accorder son tempo
- Réaliser La Vallée vous permet-il d'affiner votre style d'auteur ?
C'est difficile d'en parler. Je pense que c'est même dangereux pour un "artiste". J'aime beaucoup cette phrase de Samuel Becket : " Le fond est la forme, la forme est le fond ". C'est indissociable. Ainsi on m'a demandé lors d'une projection débat à Beyrouth, pourquoi mes films sont lents. J'ai répondu en interrogeant la personne pour savoir si elle avait un problème avec la lenteur. Moi, je ne pense que pas que mes films soient lents. Peut-être parce que je suis Africain, je prends mon temps…
Je suis né à Dakar et je revendique ça en moi aussi. La Vallée se passe dans la Bekaa, le tempo est très différent de Beyrouth. Doit on imposer son rythme à ce lieu ou bien ce lieu nous dit-il quelque chose du rythme, du rapport au temps, à l'espace ? C'est la moindre des choses que cette question que doit se poser un cinéaste. C'est sûr qu'avec ce film, je voulais tenir compte de l'ampleur de l'espace. Il n'était pas question quand on est à l'intérieur que l'extérieur soit isolé. Dans la cuisine, il y a de grandes fenêtres et c'était important pour moi que cette " frontière " soit ainsi. Mais quand je construis cela, je ne pense pas à mon style. Si on met mes films côte à côte, je crois qu'on va voir que je n'ai pas forcement toujours le " même style " mais c'est sûr que j'ai des récurrences et des obsessions dans la manière de faire. Je voudrais bien faire plaisir aux copains qui me demandent quand je vais faire une comédie, par exemple. Mais on ne fait pas une comédie pour en faire une, on la fait parce qu'on la porte en soi. Je pense qu'on porte en soi des obsessions, on les affine sans s'en rendre compte. Comme disait très bien Picasso : " L'art ce n'est pas une évolution, ça monte, ça descend ". C'est comme le genre humain qui est loin d'être en évolution !
- Vous sentiez-vous particulièrement inspiré par La Vallée ?
Enormément. Il me fallait aller vers ce lieu car je n'habite pas là, je vis à Beyrouth. Quand j'écris un film, je vais énormément dans les lieux. La haute montagne qu'on voit au début du film donne sur la Bekaa. C'est un des plus hauts points du Liban. J'y suis allé très souvent parce que j'aime bien m'imprégner. Je le fais beaucoup dés que le scénario est écrit. Je me suis imbibé un peu comme une éponge… Je pense avoir été très inspiré pour ce film y compris au montage qui est quand même un lieu fondamental.
- Pourquoi avoir livré un film si long dans sa durée ? Pour échapper au formatage ?
Non, il y a plein de films actuellement qui font plus de deux heures. Mais dans un film où ça court partout, c'est autre chose… Je ne suis pas le premier auteur à faire ça : Jacques Rivette a réalisé un film qui durait plusieurs heures (Out One : Noli me tangere, 1971), Béla Tarr en a fait un de plus de sept heures (Le Tango de Satan, 1994), le Chinois Wang Bing a atteint neuf heures (A l'ouest des rails, 2003)… Le mot qui me paraît important, c'est le souffle. A un moment donné le film vous impose un souffle. On se doute bien qu'avec un producteur, on entend toujours dire que c'est trop long… Mais ce sont les bonnes vieilles batailles du cinéma… Moi je suis en appel, en demande et en espoir d'un spectateur qui a envie de s'abandonner. Je ne dis pas qu'en une heure ça n'aurait pas pu le faire mais c'est le souffle que j'ai trouvé.
- Comment ont été conçues les parties musicales : avant le montage ou après ?
Il y a deux partitions musicales qui ont été composées pour le film. Il y a celle de Cynthia Zaven, une amie arménienne du Liban, merveilleuse musicienne. C'est la musique qui revient le plus souvent, où il y a de l'orgue. Je lui avais dit : " Dans ce lieu, j'entends de l'orgue ". Elle m'a proposé des choses avant même que je tourne mais il n'y avait rien encore de précis. Au montage, elle m'a proposé d'autres choses mais elle n'a pas écrit sur les images. Je ne pratique pas ça. Et puis il y a la guitare de Sharif Sehnaoui à la fin, qui paraît un peu "crade" comme on dit. Il avait composé une mélodie que j'ai entendue, j'ai fermé les yeux en me disant que je l'accueillerai bien dans mon film. On en a reparlé, il m'a proposé autre chose. Sinon j'ai pris des musiques existantes : Exercise One de Joy Divison en rock alternatif, Lament de Gina Kancheli et Ana Dellali de Cheb Ahmad Zergui. On les a payées en négociant à fond pour avoir les prix les moins chers. J'adore travailler avec les musiciens. Ils apportent un vrai plus parce que pour moi, la musique n'est pas là pour illustrer. C'est comme tout le travail sonore que j'apporte dans un film.
Effets spéciaux et animaux signifiants
- Pourquoi avoir choisi d'employer des effets spéciaux pour rendre compte des violences à la fin du film ?
Je n'allais quand même pas demander à je ne sais quelle puissance de venir taper sur le Liban… D'ailleurs maintenant, il y a un tas d'avions qui nous survolent. Je ne suis pas prophète, seulement qui vit dans la région peut voir venir le pire… Pour le film, j'ai employé des effets spéciaux et ça a été très long, très difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. On les a faits au Liban, même si ailleurs ça aurait été mieux. Mais je n'en suis pas mécontent et en même temps, je vis avec les moyens que j'ai. Ce qui était très important, c'est que mes personnages ne soient pas atteints. Ils sont affectés forcement mais pas atteints physiquement. Je ne voulais aucun cadavre. On en a pléthore au quotidien, dans les fichues news et je trouve ça un peu obscène. Par contre, ça terrasse, alors ils sont un peu comme dans l'œil du cyclone. Un jour, j'ai vraiment été dans un œil de cyclone. C'est très étrange, on est oppressé parce qu'on est dans l'impuissance la plus totale. Et c'est peut être ça le cœur de mes films : l'impuissance.
- Les bêtes ne sont pas épargnées non plus. Avez-vous coupé un serpent en deux, torturé les animaux qui apparaissent dans le film ?
Non je ne fais pas ça. J'aime énormément les autres espèces que cette fichue espèce humaine, les autres races aussi. L'image du serpent coupé, c'est un effet spécial. Ca a pris beaucoup de mois pour arriver à le faire. Pour l'oiseau, on a eu un spécialiste. On lui a fait une petite piqure pour l'étourdir, après on lui a fait pas mal de câlins et il est reparti. Quand on voit un oiseau mort, c'est un oiseau empaillé. Ces présences animales sont importantes malgré que le Liban soit un petit pays où il y en a peu. Il y a aussi l'âne qui est une sorte de salut à Robert Bresson dans Au hasard Balthazar (1966). Pour moi, l'âne est une sorte de témoin muet de nous autres. Tous ces animaux sont importants mais je ne vais pas préciser au générique qu'on n'a pas fait mal aux bêtes. Ce serait hypocrite. Le cinéma, c'est fondamental, je suis prêt à y mettre mon âme mais pas l‘âme de quelqu'un d'autre.
- Est-ce à dire que vous investissez ces animaux d'une présence et d'une sorte de spiritualité humaine dans le cours du récit ?
Oui, j'ai vécu et constaté les pressentiments qu'ils ont d'une catastrophe, un tremblement de terre, un orage terrible qui arrive… D'ailleurs je pense que les catastrophes humaines font partie des catastrophes naturelles. On en a beaucoup, pratiquement au quotidien donc je suis sûr que les bêtes les pressentent. Evidemment, je les investis de quelque chose, mais ils le sont déjà. Je ne suis pas un mystique dans le sens d'une religion précise, mais le monde pour moi, n'est pas juste un fait, il est plus que ça. Peut être que les bêtes, précisément parce qu'elles ne sont pas dans une planification, un raisonnement, sont dans du ressenti, dans la perception. Peut-être qu'elles peuvent mieux sentir le monde. Elles portent en elles quelque chose que beaucoup d'entre nous, les humains, ont perdu.
- Vous parlez de perte et le personnage principal a perdu sa mémoire. Fallait-il qu'il en retrouve des bribes vers la fin ?
Je me suis posé cette question de nombreuses fois. Ce n'était pas dans le scénario. Mais c'était important qu'à la fin, il ne soit pas un mystère, que ce ne soit qu'un être humain. Ce qui m'intéressait, c'était de dire : "Tu es venu ? Et alors ? " Ce " et alors " m'a décidé à lui faire dire ce peu de choses qu'il dit à la fin… Et alors ? Ca lui sert à quoi maintenant cette mémoire ? On a un peu deviné qu'elle lui était revenu quand on le " torturait ", quand on l'a attaché parce qu'il cherchait à fuir. Ça revient à l'impuissance dont je parlais tout à l'heure. Il était important pour moi de ne pas le jeter dans le paysage comme une errance. Certes, il en est une, mais comme tout le monde en fait, pas spécialement parce qu'il n'a plus sa mémoire. C'est un choix que j'ai fait mais qui m'a torturé longtemps, à l'écriture, à la préparation. C'est vraiment au tournage que j'ai décidé ça. La grande richesse du cinéma, c'est qu'on peut trouver des choses intéressantes durant le tournage… J'aimais beaucoup qu'il parle à cette jeune femme. C'est quasiment la fin donc : et alors, et après ?
- Serait-ce une manière de dédramatiser tout ce qui a pu être la fiction, le fantasme du film peut être ? Banaliser, rendre à sa juste question ?
Peut-être. Ce qui me passionne avec le cinéma, c'est tout ce qu'il peut ouvrir comme champ. Donc je laisse l'interprétation, moi même je ne suis pas trop sûr de savoir pourquoi je l'ai fait. Il était clair que le dernier plan du film serait celui que j'ai tourné. Je voulais vraiment cet homme dans ce paysage. J'ai choisi Carlos Chahine qui est un acteur qu'on n'a pas vraiment envie de prendre dans ses bras, en le réconfortant. C'est un grand bonhomme. Même quand il est une victime, il n'est pas une victime dans le sens de l'image qu'on donne à ça. Il était important pour moi de ne pas le jeter dans un état où il serait perdu à vie. C'est vrai que je construis mes films énormément mais il y a infiniment plus de choses qui m'échappent que des choses que je saisis. Ce qui m'échappe me guide. Il faut bien faire confiance à ce qui nous porte aussi, de temps en temps. En art en tous cas, ça me paraît fondamental.
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
(Africiné / Paris)
pour Images Francophones
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(*) Ghassan Salhab est né à Dakar, au Sénégal, en 1958, de parents libanais. Il s'établit au Liban avec sa famille, en 1970. Il étudie à Paris, en France, à partir de 1975, sans s'éloigner du Liban. Puis il se fixe à Beyrouth pour développer son œuvre tout en enseignant le cinéma.
Crédit Image : DR
En multipliant les axes, Ghassan Salhab atteste de la pluralité des champs investis par les cinéastes libanais indépendants. Dans La Vallée, 2014, il transporte le public au cœur des montagnes du Liban. Un homme qui a perdu la mémoire après un accident d'auto, est pris en charge par un groupe mystérieux. Affairés par la fabrication de produits chimiques dans une villa, ses membres se sentent menacés. La montagne résonne de frappes militaires, de heurts inquiétants, destructeurs.
Au-delà de son argument, La Vallée se fait l'écho des affrontements communautaires, de la circulation des armes, des informations relayées par la presse, jetant les hommes les uns contre les autres. En signant un film épidermique sur la désintégration, l'égarement, porté par des comédiens expressifs, Ghassan Salhab épouse le temps lourd de La Vallée et ses paysages lumineux, irrigués par la terre libanaise.
Le défi est alors de toucher des spectateurs attentifs que ce soit en Orient ou en Occident. Nous avons rencontré Ghassan Salhab pour évoquer la diffusion de La Vallée mais aussi la production internationale qu'il a réunie, entre aides européennes et fonds arabes, dépassant les questions de moyens qui freinent les auteurs. En revenant sur le sens de sa démarche, le réalisateur revendique ses influences africaines (*), son engagement désillusionné mais persévérant, sa pratique d'une poétique de l'image qui pousse la réflexion sur l'art du cinéma contemporain.
S'inspirer de la vibration d'un lieu
- Que nous racontez-vous dans La Vallée ?
Cette vallée, c'est la vallée de la Bekaa au Liban. Elle est entre deux chaînes de montagnes dont le Mont Liban, et représente 40% du pays en termes de territoire. Derrière une de ces chaînes de montagnes, il y a la Syrie et Israël, nos deux voisins. Donc c'est un film qui se passe là-bas mais ce n'est pas un film sur là-bas. Je ne traite pas un sujet, je tente de faire une plongée… Si je dis : " C'est un homme qui perd la mémoire suite à un accident et qui est recueilli par des gens qui s'avèrent être des contrebandiers de drogue, plutôt novices ", on est dans le récit au sens traditionnel du terme. Ce n'est pas vraiment ce que je cherche puisque j'ai planté ça dans la vallée de la Bekaa. Pour moi la puissance du cinéma, ce sont les lieux, pas le décor, et ce que ça transpire, ce qui en est imprégné. Le Liban lui même est imprégné, il ne quitte jamais l'actualité depuis des décennies donc j'en tiens compte sans jamais en parler directement. Ça fait partie de ce que j'appelle " la mémoire collective ".
- Pourquoi mettez-vous en scène, justement, un homme qui perd sa mémoire ?
Parce que du coup, il devient une page blanche. Mais on n'est jamais une page blanche… Quant aux autres, ils sont là mais on n'en sait pas plus sur eux. On n'en sait pas plus sur ceux qui ont leur mémoire, leur tête, que celui qui ne l'a plus. Mon personnage est joué par un acteur avec qui j'ai déjà travaillé, Carlos Chahine. Il a un corps particulier sur lequel on peut inscrire quelque chose. Ce qu'il y a avec lui, c'est qu'il est autant menaçant que menacé… C'est "l'autre" dont on ne sait absolument rien qui m'intéresse, pas la mémoire avec le Liban qui veut faire une sorte d'amnésie. Donc avec la mémoire qui n'est plus là, brusquement, il n'y a plus que perception, plus que l'immédiateté, l'instant.
- Du coup, ce personnage semble un peu dérangeant au milieu du groupe qui le recueille. Il cristallise la position des autres notamment dans cette scène de repas, presque au centre du récit, où cette question des communautés différentes surgit. Pourquoi la souligner avec force dans la mise en scène ?
On est au Liban ! Le pays est largement et profondément encombré par cette question communautaire, d'identité. C'est la question de l'identification, de l'estampille. Là pour moi, c'est une moquerie. Cet homme qui est une page blanche, l'un de ceux qui l'entourent pense que d'abord, il faut lui donner un nom. Donc arrive forcément la question de savoir si c'est un nom avec une consonance comme ceci ou comme cela… C'est un peu une farce de ma part, et même de leur part à eux. Le Liban est un peu une caricature de lui-même. Actuellement il y a une absence de président, les Chrétiens pensent communautairement, comme les Sunnites, les Chiites... Evidemment ça bouge. Parfois c'est une affaire de Musulmans et Chrétiens, parfois c'est une affaire entre Chrétiens, parfois entre Musulmans, parfois ce sont des alliances incongrues. Au-delà de ça, c'est un plateau permanent et pour moi, ça m'intéressait qu'un homme qui est une page blanche, l'une des premières choses à laquelle pense l'un des personnages principaux du film, c'est de lui donner une identité… Ça m'intéressait, à un moment donné, de quitter l'abstraction même si les radios rappellent les conflits, la question des réfugiés, et d'aborder ce côté terriblement lourdingue que nous avons, nous les Libanais.
- Ce groupe de personnages a l'air de vouloir fabriquer une substance qui pourrait servir à accoutumer des soldats, des gens qui sont en guerre. Dans quel camp ça les situerait ça, un camp anti gouvernemental ?
Non pas particulièrement. Actuellement, il y a une rumeur qui dit que beaucoup de combattants, en Syrie en tous cas, comme il y en a eu pendant les guerres libanaises, prennent des substances pour pouvoir tenir le coup, aller dans des situations abracadabrantes. Il ne faut pas oublier que quand j'ai écrit ce film, nous étions très loin de l'horreur absolue qu'est en train de vivre la Syrie, l'Irak. Je ne suis pas un prophète mais quand on vit dans la région où le pire est toujours à venir… Donc celui qui fait de la drogue qui fait de l'argent, fait de l'argent. Il se contrefiche de savoir qui va lui payer. Le capital est comme l'argent, il n'a pas de couleur, ni d'odeur. Les gens que je montre veulent faire de l'argent mais ils ne sont pas comme des mafieux traditionnels. Au Liban, circulent beaucoup de produits dont ceux utilisés par les combattants de Daesh. Le Liban fabrique tout ça, précisément dans la plaine de la Bekaa. J'ai puisé dans une réalité mais pas pour raconter cette réalité.
Diffuser pour établir un échange actif
- Comment espérez-vous qu'un public libanais reçoive votre désir de non raconter ?
Raconter ou pas n'est pas la question. Nous savons qu'il y a une démultiplication identitaire dans ce pays où chacun veut à tout prix s'inscrire ou ne pas s'inscrire. Les Libanais savent bien qu'il y a une fabrication autant de cocaïne que d'héroïne ou d'autres produits. Je n'invente rien, je puise et je le raconte différemment. Je m'appuie sur un récit pour aller au dedans du récit. Ce film s'inscrit au Liban et je tiens compte des choses que je n'ai pas besoin de raconter, qui sont là. Quand la guerre advient à la fin du film, certains veulent la voir comme apocalyptique. Moi, je tiens à rappeler que l'apocalypse est une supposée délivrance selon les textes. Je la vois comme une répétition sans fin, une sorte de catastrophe permanente. Le cinéma n'est pas juste là pour raconter une histoire, à mon humble avis.
- Mais comment le public libanais peut-il prendre ces images que vous lui proposez ?
La Vallée a été distribué au Liban. Moi, je ne fais pas des films qui vont rencontrer de très larges publics. Ce n'est pas parce que je ne le veux pas, c'est une réalité concrète du " marché " qui me donne très peu de place. Le film est sorti dans une salle, au Metropolis, la seule salle indépendante à Beyrouth, et peut être dans le Proche-Orient. Que pensez-vous que le spectateur perçoive du réel, de la réalité ? Celle qu'on lui colle au front. Elle n'est pas uniforme, pas objective. Cette perception, ce n'est pas à l'art de la donner comme une information précisément. Je ne suis pas un informateur, le cinéma n'est pas du journalisme. J'essaie, à partir de ce que je sens et sais de là où je vis, de construire quelque chose qui traduise le désastre, cette espèce de menace permanente de la désintégration dans laquelle nous sommes. Je cherche à toucher une sorte d'état des choses, d'état d'être. Pour moi, le Liban n'est pas un décor dans lequel j'installe un récit. Le Liban est un corps constituant qui forcement affecte mon récit, lui-même tiré du Liban. Je pense que ce corps est profondément malade mais en même temps quand on connaît le Liban, on voit que c'est un malade qui bouge beaucoup de la queue, comme on pourrait le dire à propos d'un chien…
Quand un pays est dans une crise, les gens ont plus envie de recevoir un film qui soulage, distrait… Je ne suis pas dans ce courant là. Je ne fais pas mes films contre ce courant, je suis dans une démarche de cinéma marginal. Je l'assume et n'ai aucun problème avec ça.
- Qu'attendez-vous de la sortie du film en France ?
On sort en France mais pas comme Star Wars avec ses mille salles ! J'ai un rapport intime à la France. J'ai vécu des années entre Paris et Beyrouth. Même si ça a beaucoup bougé depuis le temps, Paris reste une ville où le rapport au cinéma est encore là. Quand on va voir un film qui vient du Liban, d'Argentine… ce n'est pas pour en savoir plus sur le Liban, l'Argentine mais c'est pour voir un film qui se passe là-bas. Il y a encore cette curiosité. On peut parler d'art cinématographique. Paris reste l'une des seules villes au monde où l'on peut voir un film qui vient d'ailleurs et où on a un rapport cinématographique avec lui. C'est rare. Même chez nous, les gens ont un regard exotique ne serait-ce que sur un film syrien, égyptien…
Donc j'espère un regard car ça me manque, puisque depuis mes deux premiers longs-métrages, je n'ai pas eu de sortie de salles en France. Mes films circulent beaucoup plus par le biais des festivals. Mais pour un cinéaste, il y a une grande envie de sortir en salles même si le film risque d'avoir une vie très courte. Evidemment j'espère qu'il reste plus longtemps, que le marché ne l'envoie pas paître au plus vite dès qu'arrive quelque chose de plus gros. Mais je ne suis pas naïf pour croire que l'art est dessus de tout. On lui donne une place ou bien on ne lui en donne pas.
Produire en fonction de ses moyens
- Pourquoi avoir choisi une production, et même une coproduction, plus étoffée qu'à votre ordinaire, pour aborder La Vallée ?
Quand on voit le générique, il y a une longue liste de noms mais ils ne portent que sur des petits chiffres. Le plus conséquent, c'est l'Aide aux cinémas du monde. Donc le soutien du CNC français reste fondamental. Il y a aussi le Fonds Francophone de Production Audiovisuelle du Sud [OIF, Paris, ndlr]. Je n'ai pas eu Arte. Terra Incognita que j'ai fait en 2002, a eu un budget plus important que La Vallée. Là, on arrive à un montant de 600 000 euros au grand maximum.
J'ai la chance d'avoir au Liban, des gens qui aiment travailler avec moi donc ils ont baissé considérablement leurs prix. J'ai ce "capital humain", comme je dis. Mais ce film ne pouvait pas se faire avec des sommes modiques. Il y a cet espace ample de la Bekaa dont je voulais rendre compte. On a tourné chronologiquement et j'ai eu la chance, pratiquement, que le climat suive l'évolution du film. Il était important que cette espèce de menace, d'état de chose qui va peut-être advenir ou peut être n'adviendra jamais, soit rendu. Je pense que le pire qu'on puisse avoir comme désastre, c'est que rien n'advienne mais que la menace soit permanente. Il était important que ça se passe avec une lumière quasi éclatante. La Bekaa est très vaste, il y a un ciel immense, la lumière est éclatante. Dans la tête des gens, le désastre c'est les ténèbres, le contraste, le clair obscur. En fait ici, il n'y a pas de clair-obscur sinon en nous, mais pas hors de nous. Tourner ça avec très peu de gens est un peu compliqué, cela dit. Pourtant je ne tourne plus du tout avec de grosses équipes puisque je filme en numérique pour des raisons économiques. Mais je n'ai rien contre et je ne le fais pas par dépit… Il faut additionner les petites sommes pour arriver à un budget. Et même si on additionne, on n'arrive pas au budget parce que après il y a les bonnes volontés qui font que le film se fait.
- Il était important pour vous d'aller chercher aussi des fonds arabes ?
Oui. Les fonds arabes existent et moi, en tant qu'Arabe, je vais évidement taper à leurs portes. Même si les gens du Golfe et leurs politiques me tapent sérieusement sur le système... Il y a Doha Film Institute au Qatar, et Sanad the Post Production Fund of the Abu Dhabi Film Festival aux Emirats Arabes Unis. Heureusement, ce sont des fonds qui fonctionnent de façon autonome puisqu'ils n'ont pas affaire avec les politiques. Il y a un fonds arabe aussi qui est le seul fonds indépendant qui s'appelle AFAC, Arab Fund for Art and Culture. C'est un fonds dont l'existence nous apaise un peu parce qu'il est vraiment indépendant dans le sens où il n'a affaire avec aucun État. J'ai eu ces trois fonds arabes ; mais si on les additionne, au total, ils ne font même pas 120 ou 130 000 dollars. C'est une bonne somme mais ceux qui font des longs-métrages savent que ce n'est pas suffisant. J'ai un producteur libanais qui est le producteur le plus important, en termes de chiffre et de présence, qui a mis aussi de sa poche. Évidemment je n'ai pas été payé… Tout ça pour dire qu'on fait des films en rabotant ici et là, dans le Tiers monde. Et ceux qui sont dans des pays encore pires que les nôtres économiquement, comme en Afrique noire, le font infiniment plus que nous… Donc je conçois et je construis mes films en fonction.
- Ainsi vos revenus ne dépendent pas uniquement du cinéma. C'est pour ça que vous enseignez, que vous faites autre chose à côté ?
Oui, je ne gagne absolument pas ma vie à partir de mes films. J'enseigne au Liban, je donne beaucoup de workshops, d'ateliers de formation, que ce soit ici ou dans d'autres pays du monde arabe, ou même en France. En même temps, ça me plait beaucoup parce que c'est une sorte de pont qu'on construit, non seulement générationnel mais avec les différents pays de la région. C'est ça qui me fait vivre.
- Ça vous paraît important justement de transmettre et de le faire dans des espaces culturels différents ?
Transmettre, c'est des deux cotés. Actuellement, avec tout ce qui se passe dans notre monde arabe, je dirais même c'est fondamental. Les ponts sont extrêmement rares et même quand ils sont là, ils sont souvent dynamités. Alors même si ce ne sont que des passerelles, peut-être que c'est mieux parce qu'on les remarque moins. Dans les rapports que j'établis dans les divers ateliers, je ne cherche pas du tout à construire des futurs cinéastes de la marge. Je l'assume pour moi mais elle ne se communique pas. On la porte en soi ou pas. C'est une forme de résistance que je me propose, et je ne suis pas le seul dans le monde du cinéma, dans le monde de l'art…
- Vous revendiquez une sorte de résistance mais on voit souvent que vous fédérez vos moyens avec d'autres cinéastes. On vous voit participer aux films de Lamia Joreige comme Et la vie est facile, 2015, appuyer un tournage et même jouer dans Revolution Zendj, 2013, de Tariq Teguia quand il vient travailler dans la région. Ces alliances régénèrent-elles votre cinéma ?
Plein de choses régénèrent mon cinéma… Tariq Teguia est un ami et ce n'est pas parce qu'il est passé ici que je l'ai aidé. On s'est connus avant, on est très proches. Ce sont des dialogues comme ça qui sont fondamentaux… Personne ne crée seul dans son coin. J'en ai avec des amis en Tunisie aussi et ailleurs que dans le monde arabe, bien entendu. Même si quand on construit un film, on est toujours dans une sorte d'isolement, le dialogue est fondamental. J'ai beaucoup parlé à Tariq Teguia de mon film précédent, celui-ci pas tant que ça puisqu'il était en train de faire le sien. Il m'a beaucoup parlé de Révolution Zendj et bien entendu, je lui apporté tout ce que je pouvais sur le terrain. Ce tissu de solidarité est fondamental. Je l'assume et je le revendique. Je suis très heureux d'ailleurs, de voir qu'actuellement au Liban, il y a plusieurs personnes qui construisent leur film comme ça. Je suis heureux qu'ils y arrivent aussi. La solidarité n'est quand même pas une mentalité très locale… Mais c'est fondamental surtout pour nous qui essayons de créer des choses sur place. Donc il se trouve que j'aime énormément le travail de Tariq Teguia, il s'avère que Lamia Joreige est une copine depuis longtemps. Il ne s'agit pas de créer un mouvement, il s'agit d'être présent, d'exister.
Prendre le temps d'accorder son tempo
- Réaliser La Vallée vous permet-il d'affiner votre style d'auteur ?
C'est difficile d'en parler. Je pense que c'est même dangereux pour un "artiste". J'aime beaucoup cette phrase de Samuel Becket : " Le fond est la forme, la forme est le fond ". C'est indissociable. Ainsi on m'a demandé lors d'une projection débat à Beyrouth, pourquoi mes films sont lents. J'ai répondu en interrogeant la personne pour savoir si elle avait un problème avec la lenteur. Moi, je ne pense que pas que mes films soient lents. Peut-être parce que je suis Africain, je prends mon temps…
Je suis né à Dakar et je revendique ça en moi aussi. La Vallée se passe dans la Bekaa, le tempo est très différent de Beyrouth. Doit on imposer son rythme à ce lieu ou bien ce lieu nous dit-il quelque chose du rythme, du rapport au temps, à l'espace ? C'est la moindre des choses que cette question que doit se poser un cinéaste. C'est sûr qu'avec ce film, je voulais tenir compte de l'ampleur de l'espace. Il n'était pas question quand on est à l'intérieur que l'extérieur soit isolé. Dans la cuisine, il y a de grandes fenêtres et c'était important pour moi que cette " frontière " soit ainsi. Mais quand je construis cela, je ne pense pas à mon style. Si on met mes films côte à côte, je crois qu'on va voir que je n'ai pas forcement toujours le " même style " mais c'est sûr que j'ai des récurrences et des obsessions dans la manière de faire. Je voudrais bien faire plaisir aux copains qui me demandent quand je vais faire une comédie, par exemple. Mais on ne fait pas une comédie pour en faire une, on la fait parce qu'on la porte en soi. Je pense qu'on porte en soi des obsessions, on les affine sans s'en rendre compte. Comme disait très bien Picasso : " L'art ce n'est pas une évolution, ça monte, ça descend ". C'est comme le genre humain qui est loin d'être en évolution !
- Vous sentiez-vous particulièrement inspiré par La Vallée ?
Enormément. Il me fallait aller vers ce lieu car je n'habite pas là, je vis à Beyrouth. Quand j'écris un film, je vais énormément dans les lieux. La haute montagne qu'on voit au début du film donne sur la Bekaa. C'est un des plus hauts points du Liban. J'y suis allé très souvent parce que j'aime bien m'imprégner. Je le fais beaucoup dés que le scénario est écrit. Je me suis imbibé un peu comme une éponge… Je pense avoir été très inspiré pour ce film y compris au montage qui est quand même un lieu fondamental.
- Pourquoi avoir livré un film si long dans sa durée ? Pour échapper au formatage ?
Non, il y a plein de films actuellement qui font plus de deux heures. Mais dans un film où ça court partout, c'est autre chose… Je ne suis pas le premier auteur à faire ça : Jacques Rivette a réalisé un film qui durait plusieurs heures (Out One : Noli me tangere, 1971), Béla Tarr en a fait un de plus de sept heures (Le Tango de Satan, 1994), le Chinois Wang Bing a atteint neuf heures (A l'ouest des rails, 2003)… Le mot qui me paraît important, c'est le souffle. A un moment donné le film vous impose un souffle. On se doute bien qu'avec un producteur, on entend toujours dire que c'est trop long… Mais ce sont les bonnes vieilles batailles du cinéma… Moi je suis en appel, en demande et en espoir d'un spectateur qui a envie de s'abandonner. Je ne dis pas qu'en une heure ça n'aurait pas pu le faire mais c'est le souffle que j'ai trouvé.
- Comment ont été conçues les parties musicales : avant le montage ou après ?
Il y a deux partitions musicales qui ont été composées pour le film. Il y a celle de Cynthia Zaven, une amie arménienne du Liban, merveilleuse musicienne. C'est la musique qui revient le plus souvent, où il y a de l'orgue. Je lui avais dit : " Dans ce lieu, j'entends de l'orgue ". Elle m'a proposé des choses avant même que je tourne mais il n'y avait rien encore de précis. Au montage, elle m'a proposé d'autres choses mais elle n'a pas écrit sur les images. Je ne pratique pas ça. Et puis il y a la guitare de Sharif Sehnaoui à la fin, qui paraît un peu "crade" comme on dit. Il avait composé une mélodie que j'ai entendue, j'ai fermé les yeux en me disant que je l'accueillerai bien dans mon film. On en a reparlé, il m'a proposé autre chose. Sinon j'ai pris des musiques existantes : Exercise One de Joy Divison en rock alternatif, Lament de Gina Kancheli et Ana Dellali de Cheb Ahmad Zergui. On les a payées en négociant à fond pour avoir les prix les moins chers. J'adore travailler avec les musiciens. Ils apportent un vrai plus parce que pour moi, la musique n'est pas là pour illustrer. C'est comme tout le travail sonore que j'apporte dans un film.
Effets spéciaux et animaux signifiants
- Pourquoi avoir choisi d'employer des effets spéciaux pour rendre compte des violences à la fin du film ?
Je n'allais quand même pas demander à je ne sais quelle puissance de venir taper sur le Liban… D'ailleurs maintenant, il y a un tas d'avions qui nous survolent. Je ne suis pas prophète, seulement qui vit dans la région peut voir venir le pire… Pour le film, j'ai employé des effets spéciaux et ça a été très long, très difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. On les a faits au Liban, même si ailleurs ça aurait été mieux. Mais je n'en suis pas mécontent et en même temps, je vis avec les moyens que j'ai. Ce qui était très important, c'est que mes personnages ne soient pas atteints. Ils sont affectés forcement mais pas atteints physiquement. Je ne voulais aucun cadavre. On en a pléthore au quotidien, dans les fichues news et je trouve ça un peu obscène. Par contre, ça terrasse, alors ils sont un peu comme dans l'œil du cyclone. Un jour, j'ai vraiment été dans un œil de cyclone. C'est très étrange, on est oppressé parce qu'on est dans l'impuissance la plus totale. Et c'est peut être ça le cœur de mes films : l'impuissance.
- Les bêtes ne sont pas épargnées non plus. Avez-vous coupé un serpent en deux, torturé les animaux qui apparaissent dans le film ?
Non je ne fais pas ça. J'aime énormément les autres espèces que cette fichue espèce humaine, les autres races aussi. L'image du serpent coupé, c'est un effet spécial. Ca a pris beaucoup de mois pour arriver à le faire. Pour l'oiseau, on a eu un spécialiste. On lui a fait une petite piqure pour l'étourdir, après on lui a fait pas mal de câlins et il est reparti. Quand on voit un oiseau mort, c'est un oiseau empaillé. Ces présences animales sont importantes malgré que le Liban soit un petit pays où il y en a peu. Il y a aussi l'âne qui est une sorte de salut à Robert Bresson dans Au hasard Balthazar (1966). Pour moi, l'âne est une sorte de témoin muet de nous autres. Tous ces animaux sont importants mais je ne vais pas préciser au générique qu'on n'a pas fait mal aux bêtes. Ce serait hypocrite. Le cinéma, c'est fondamental, je suis prêt à y mettre mon âme mais pas l‘âme de quelqu'un d'autre.
- Est-ce à dire que vous investissez ces animaux d'une présence et d'une sorte de spiritualité humaine dans le cours du récit ?
Oui, j'ai vécu et constaté les pressentiments qu'ils ont d'une catastrophe, un tremblement de terre, un orage terrible qui arrive… D'ailleurs je pense que les catastrophes humaines font partie des catastrophes naturelles. On en a beaucoup, pratiquement au quotidien donc je suis sûr que les bêtes les pressentent. Evidemment, je les investis de quelque chose, mais ils le sont déjà. Je ne suis pas un mystique dans le sens d'une religion précise, mais le monde pour moi, n'est pas juste un fait, il est plus que ça. Peut être que les bêtes, précisément parce qu'elles ne sont pas dans une planification, un raisonnement, sont dans du ressenti, dans la perception. Peut-être qu'elles peuvent mieux sentir le monde. Elles portent en elles quelque chose que beaucoup d'entre nous, les humains, ont perdu.
- Vous parlez de perte et le personnage principal a perdu sa mémoire. Fallait-il qu'il en retrouve des bribes vers la fin ?
Je me suis posé cette question de nombreuses fois. Ce n'était pas dans le scénario. Mais c'était important qu'à la fin, il ne soit pas un mystère, que ce ne soit qu'un être humain. Ce qui m'intéressait, c'était de dire : "Tu es venu ? Et alors ? " Ce " et alors " m'a décidé à lui faire dire ce peu de choses qu'il dit à la fin… Et alors ? Ca lui sert à quoi maintenant cette mémoire ? On a un peu deviné qu'elle lui était revenu quand on le " torturait ", quand on l'a attaché parce qu'il cherchait à fuir. Ça revient à l'impuissance dont je parlais tout à l'heure. Il était important pour moi de ne pas le jeter dans le paysage comme une errance. Certes, il en est une, mais comme tout le monde en fait, pas spécialement parce qu'il n'a plus sa mémoire. C'est un choix que j'ai fait mais qui m'a torturé longtemps, à l'écriture, à la préparation. C'est vraiment au tournage que j'ai décidé ça. La grande richesse du cinéma, c'est qu'on peut trouver des choses intéressantes durant le tournage… J'aimais beaucoup qu'il parle à cette jeune femme. C'est quasiment la fin donc : et alors, et après ?
- Serait-ce une manière de dédramatiser tout ce qui a pu être la fiction, le fantasme du film peut être ? Banaliser, rendre à sa juste question ?
Peut-être. Ce qui me passionne avec le cinéma, c'est tout ce qu'il peut ouvrir comme champ. Donc je laisse l'interprétation, moi même je ne suis pas trop sûr de savoir pourquoi je l'ai fait. Il était clair que le dernier plan du film serait celui que j'ai tourné. Je voulais vraiment cet homme dans ce paysage. J'ai choisi Carlos Chahine qui est un acteur qu'on n'a pas vraiment envie de prendre dans ses bras, en le réconfortant. C'est un grand bonhomme. Même quand il est une victime, il n'est pas une victime dans le sens de l'image qu'on donne à ça. Il était important pour moi de ne pas le jeter dans un état où il serait perdu à vie. C'est vrai que je construis mes films énormément mais il y a infiniment plus de choses qui m'échappent que des choses que je saisis. Ce qui m'échappe me guide. Il faut bien faire confiance à ce qui nous porte aussi, de temps en temps. En art en tous cas, ça me paraît fondamental.
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
(Africiné / Paris)
pour Images Francophones
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(*) Ghassan Salhab est né à Dakar, au Sénégal, en 1958, de parents libanais. Il s'établit au Liban avec sa famille, en 1970. Il étudie à Paris, en France, à partir de 1975, sans s'éloigner du Liban. Puis il se fixe à Beyrouth pour développer son œuvre tout en enseignant le cinéma.
Crédit Image : DR
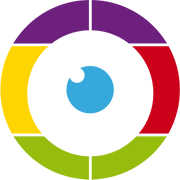 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images