Raoul Peck : cinéaste du politique, cinéaste d’une politique

Le festival d’Amiens 2012 a rendu un vibrant hommage au réalisateur haïtien (président de la FEMIS, Paris), avec une rétrospective intégrale de son œuvre.
Caroline Pochon : Votre œuvre est présentée, cette année au festival d’Amiens, qui a choisi de vous rendre hommage durant toute la semaine, du 16 au 24 novembre. Cette œuvre nous emmène de Haïti (L’homme sur les quais, Moloch tropical) à l’ENA en France (L’école du pouvoir), jusqu’à l’Afrique, (Lumumba, Quelques jours en avril). La notion de francophonie est-elle au cœur de cette œuvre ?
Raoul Peck : La francophonie, le fait que l’on parle de francophonie, correspond pour moi à une période ambiguë, vers la fin des années quatre-vingt. Cela correspondait à un moment de fragilité de la langue française, de l’impact de la culture française sur le reste du monde. Cela correspond historiquement aussi à la période de la bataille de l’exception culturelle française.
Je pense que pour certains pays du tiers-monde et le mien, Haïti, en particulier, cela a été perçu comme une défense de la langue française et de la France. Le message a été parfois ambigu, car il y a tout de même eu une grande offensive politique autour de cela. Je pense que la francophonie a un peu souffert de cela, même si aujourd’hui, les choses ont évolué. Ce n’est pas pour rien que l’on a quelqu’un comme Abdou Diouf, l’ancien président du Sénégal, à la tête de la francophonie. Mais ce rééquilibrage politique et culturel a pris du temps.
Il est vrai que, par rapport à mon travail, je me sens plus à l’aise aujourd’hui que peut-être, à l’époque. Ma vision a toujours été générale et d’ailleurs, pas forcément francophone. Elle a été de m’engager là où je vivais. Je ne travaille pas par rapport à une référence géographique, culturelle ou de langage. Cette liberté, je ne l’ai même pas choisie car j’ai eu la chance d’être dans ce cadre. J’ai voyagé très tôt, mes parents ont quitté Haïti pour travailler au Congo, puis je suis allé étudier en France, aux Etats-Unis, puis en Allemagne. Tout cela fait partie pour moi d’une existence normale. Je n’ai pas eu à me forcer.
Qu’est-ce qui fait, au cours d’une œuvre qui progresse, que vous allez choisir de filmer plutôt en Haïti, après au Rwanda, en France, et aujourd’hui en Allemagne, pour le projet que vous présentez dans le cadre de ce festival, un portrait de la jeunesse de Karl Marx. Pouvez-vous expliquer ce cheminement ouvert ?
Cette œuvre, comme vous dîtes, n’est pas préméditée. C’est un regard que l’on peut porter après sur tout ce qui s’est passé, les films faits. À la racine de tout cela, c’est le choix que j’ai toujours fait de m’engager, me battre ou être sensible à ce que je vivais.
Le film sur le Rwanda m’a été proposé. A partir du moment où cela peut se faire selon des critères qui me sont chers, j’accepte. Entre ce film sur le génocide et le film que j’ai tourné sur l’ENA, il y a en commun des visions de vie, d’engagement. Quand le hasard faisait que naissait un projet, il fallait que j’intègre ce projet à une ligne centrale que j’ai et que j’essaie de garder, tout au long de mon travail de cinéaste.
Nous allons assister au Fespaco, dans quelques mois. On y parle de cinéma africain. Est-ce un vocable qui fait sens ? Est-ce qu’il faut se définir en tant que cinéaste africain, en tant que cinéaste noir, en tant que cinéaste tout court ? Votre parcours montre qu’il faut franchir ces frontières. Que peut-on dire sur ce point aujourd’hui ?
Vous savez, les étiquettes, en général, sont données par les autres. Les thèmes que vous abordez en tant que cinéastes peuvent être africains, français, américains ou haïtiens. Ce sont pour moi des hasards de vie, des choix de vivre dans un pays ou dans un continent. Ce n’est pas contradictoire avec la multiplicité des choses que vous pouvez faire.
Dans mon cas, essayer de préserver une mémoire haïtienne n’est pas contradictoire avec le fait de se confronter avec une réalité de la société française. Dans cet éventail, il y a une critique de la société, de la justice. Un thème que l’on retrouve dans tous mes films est le regard sur le pouvoir et ses dérives. Je parle aussi du rôle que joue l’économie capitaliste dans nos vies, que l’on soit Français ou Haïtien. Voilà le lien entre les différentes choses que j’ai faites. Les thèmes, les histoires, les personnages changent.
Le cinéma africain donne une identité et en même temps n'enferme-t-il pas les cinéastes ?
Le cinéma africain, c’est une longue discussion en soi. Un film mauritanien sera différent d’un film sénégalais. Quand on parle de cinéma africain, on parle de la production provenant des États africains francophones qui ont été largement aidés, encouragés, promus par ce que j’appellerais la coopération culturelle française. Cette mouvance a donné un cinéma. Aujourd’hui, ce cinéma a-t-il pu durer ? J’en doute.
Les grands cinéastes africains qui ont été primés à Cannes ne sont plus aujourd’hui dans la capacité de faire des films similaires à ceux qu’ils ont pu faire il y a encore dix ans. Sur ce plan, nous assistons à la mort d’un certain cinéma africain. Est-ce qu’on a fait un travail suffisamment efficace pour qu’il y ait une transition vers des plus jeunes cinéastes ? J’en doute. Le chemin va être compliqué et dur pour la jeune génération de cinéastes provenant des pays d’Afrique.
On a tort de croire que l’accès facile à des moyens techniques, à des capacités de tournage va générer un nouveau cinéma. L’enjeu n’est pas seulement de faire du cinéma pour assouvir une ambition personnelle, c’est aussi de faire du cinéma « au centre », que les choses bougent au centre. Cela passe par les télévisions, en France et aux Etats-Unis, cela passe par les plus grands festivals dans le monde où l’on peut montrer que l’on a nos histoires, nos acteurs, nos techniciens. C’est là la bataille qu’il faut mener.
La bataille n’est pas de survivre en fabriquant des œuvres qui n’arriveront jamais à entrer dans le circuit professionnel. Certes, on peut faire un film, mais très peu arriveront à un contexte international, et c’est cela qui compte. On se retrouve aujourd’hui avec une cinématographie en danger.
À ce propos, vous êtes président de la FEMIS, l’école nationale de cinéma française, que pouvez-vous dire sur la question de la transmission ?
La transmission française est assurée ! Nous avons aussi des étudiants étrangers à la FEMIS. Il existe aussi quelques écoles, comme celle de Gaston Kaboré au Burkina Faso. En Afrique de l’Est, il existe aussi des écoles. Mais une génération de cinéastes, cela prend des années, ce n’est pas quelque chose qui peut surgir d’un coup. Il y a des dérives liées à la télévision, des formes plus faciles, qui n’éduquent pas du tout le public.
En France, il y a des cinéclubs, une éducation. Un cinéma, cela ne surgit pas comme cela de rien. C’est un ensemble de mesures, d’infrastructures à créer, de législation à mettre en place. Dans nombreux pays d’Afrique, à Haïti, il n’y a même plus de salles de cinéma. C’est la réalité à laquelle on est confrontés. Je ne crois pas à la naissance de cinémas forts « sans qu’on s’y mette ».
Le documentaire est-il une alternative ?
C’est même un pilier du cinéma. C’est à regretter que la cinématographie africaine n’ait pas produit beaucoup de documentaristes, à part Samba Félix Ndiaye, au Sénégal, qui est décédé aujourd’hui [des suites d'un neuro-paludisme foudroyant le vendredi 6 novembre 2009 à Dakar, NDLR], ou Jean-Marie Teno. Je pense que des documentaires pourraient aussi aller à Cannes, aussi bien que les fictions. Mais on est encore loin de la masse qu’il faudrait pour faire basculer les choses.
Propos recueillis par
Caroline Pochon / Clap Noir
Crédit photo : Grégoire Meersman
À lire
- Comment raconter des histoires qui fonctionnent à un public qui est formaté ? // www.clapnoir.org/spip.php?article577
- Le Chacha des indépendances // www.clapnoir.org/spip.php?article893
Palmarès Amiens 2012
Grand Prix du long métrage (Licorne d'Or) : OFFLINE de Peter Monsaert (Belgique, 2012)
Prix spécial du jury pour le long métrage : CONG BINH, LA LONGUE NUIT INDOCHINOISE de Lam Lê (France, 2012)
Prix de la Ville d’Amiens : YEMA de Djamila Sahraoui (Algérie/France, 2012)
Prix d'interprétation féminine (Ex-aequo) : ANEMONE VALCKE pour son rôle dans Offline de Peter Monsaert (Belgique, 2012) Ex-aequo
Prix d'interprétation féminine (Ex-aequo) : NERMINA LUKAC pour son rôle dans Eat Sleep Die de Gabriela Pichler (Suède, 2011)
Prix d'interprétation masculine : WIM WILLAERT pour son rôle dans Offline de Peter Monsaert (Belgique, 2012)
Mention spéciale du jury : EAT SLEEP DIE de Gabriela Pichler (Suède, 2011)
Prix du public long métrage : A VIRGEM MARGARIDA de Licinio Azevedo (Mozambique/France/Portugal, 2012)
Prix du public court métrage d’animation : HOW TO RAISE THE MOON de Anja Struck (Allemagne/Danemark, 2011)
Grand Prix du court métrage d’animation : OH WILLY de Emma de Swaef et Marc Roels (Belgique/France/Pays-Bas, 2011)
Prix spéciaux
Prix Fémis, décerné par des élèves actuels et anciens de La fémis (section Jeunes auteurs en Europe en compétition) : PROTESTATION VI de Rolando Colla (Suisse, 2012)
Prix SIGNIS (Association catholique mondiale pour la communication) : OFFLINE de Peter Monsaert (Belgique, 2012)
Mention spéciale au film : A VIRGEM MARGARIDA de Licinio Azevedo (Mozambique/France/Portugal, 2012)
Prix des Enfants de la Licorne (section Jeunes auteurs en Europe) : PROTESTATION VI de Rolando Colla (Suisse, 2012)
Prix du Moyen métrage : LA PART CELESTE de Thibaut Gobry (France, 2012)
Prix de la Maison d'arrêt d'Amiens
Prix du public : FAIS CROQUER de Yassine Qnia (France, 2011)
Prix du Canal 10 : PROTESTATION VI de Rolando Colla (Suisse, 2012)
Résultats du 17e Fonds d’aide au développement du scénario
4 bourses de 10 000 € chacune ont été accordées aux réalisateurs des projets suivants :
- VIOLENCE de Jorge Forero (Colombie)
- HAÏTI GROUND ZERO de Michelange Quay (Haïti)
- EVITA de Pablo Aguëro (Argentine/France)
- LAMB de Yared Zeleke (Éthiopie)
Et une bourse de 7 600 € au projet français FRANKAOUIS de Nadia El Fani (France)
Site officiel : www.filmfestamiens.org
Raoul Peck : La francophonie, le fait que l’on parle de francophonie, correspond pour moi à une période ambiguë, vers la fin des années quatre-vingt. Cela correspondait à un moment de fragilité de la langue française, de l’impact de la culture française sur le reste du monde. Cela correspond historiquement aussi à la période de la bataille de l’exception culturelle française.
Je pense que pour certains pays du tiers-monde et le mien, Haïti, en particulier, cela a été perçu comme une défense de la langue française et de la France. Le message a été parfois ambigu, car il y a tout de même eu une grande offensive politique autour de cela. Je pense que la francophonie a un peu souffert de cela, même si aujourd’hui, les choses ont évolué. Ce n’est pas pour rien que l’on a quelqu’un comme Abdou Diouf, l’ancien président du Sénégal, à la tête de la francophonie. Mais ce rééquilibrage politique et culturel a pris du temps.
Il est vrai que, par rapport à mon travail, je me sens plus à l’aise aujourd’hui que peut-être, à l’époque. Ma vision a toujours été générale et d’ailleurs, pas forcément francophone. Elle a été de m’engager là où je vivais. Je ne travaille pas par rapport à une référence géographique, culturelle ou de langage. Cette liberté, je ne l’ai même pas choisie car j’ai eu la chance d’être dans ce cadre. J’ai voyagé très tôt, mes parents ont quitté Haïti pour travailler au Congo, puis je suis allé étudier en France, aux Etats-Unis, puis en Allemagne. Tout cela fait partie pour moi d’une existence normale. Je n’ai pas eu à me forcer.
Qu’est-ce qui fait, au cours d’une œuvre qui progresse, que vous allez choisir de filmer plutôt en Haïti, après au Rwanda, en France, et aujourd’hui en Allemagne, pour le projet que vous présentez dans le cadre de ce festival, un portrait de la jeunesse de Karl Marx. Pouvez-vous expliquer ce cheminement ouvert ?
Cette œuvre, comme vous dîtes, n’est pas préméditée. C’est un regard que l’on peut porter après sur tout ce qui s’est passé, les films faits. À la racine de tout cela, c’est le choix que j’ai toujours fait de m’engager, me battre ou être sensible à ce que je vivais.
Le film sur le Rwanda m’a été proposé. A partir du moment où cela peut se faire selon des critères qui me sont chers, j’accepte. Entre ce film sur le génocide et le film que j’ai tourné sur l’ENA, il y a en commun des visions de vie, d’engagement. Quand le hasard faisait que naissait un projet, il fallait que j’intègre ce projet à une ligne centrale que j’ai et que j’essaie de garder, tout au long de mon travail de cinéaste.
Nous allons assister au Fespaco, dans quelques mois. On y parle de cinéma africain. Est-ce un vocable qui fait sens ? Est-ce qu’il faut se définir en tant que cinéaste africain, en tant que cinéaste noir, en tant que cinéaste tout court ? Votre parcours montre qu’il faut franchir ces frontières. Que peut-on dire sur ce point aujourd’hui ?
Vous savez, les étiquettes, en général, sont données par les autres. Les thèmes que vous abordez en tant que cinéastes peuvent être africains, français, américains ou haïtiens. Ce sont pour moi des hasards de vie, des choix de vivre dans un pays ou dans un continent. Ce n’est pas contradictoire avec la multiplicité des choses que vous pouvez faire.
Dans mon cas, essayer de préserver une mémoire haïtienne n’est pas contradictoire avec le fait de se confronter avec une réalité de la société française. Dans cet éventail, il y a une critique de la société, de la justice. Un thème que l’on retrouve dans tous mes films est le regard sur le pouvoir et ses dérives. Je parle aussi du rôle que joue l’économie capitaliste dans nos vies, que l’on soit Français ou Haïtien. Voilà le lien entre les différentes choses que j’ai faites. Les thèmes, les histoires, les personnages changent.
Le cinéma africain donne une identité et en même temps n'enferme-t-il pas les cinéastes ?
Le cinéma africain, c’est une longue discussion en soi. Un film mauritanien sera différent d’un film sénégalais. Quand on parle de cinéma africain, on parle de la production provenant des États africains francophones qui ont été largement aidés, encouragés, promus par ce que j’appellerais la coopération culturelle française. Cette mouvance a donné un cinéma. Aujourd’hui, ce cinéma a-t-il pu durer ? J’en doute.
Les grands cinéastes africains qui ont été primés à Cannes ne sont plus aujourd’hui dans la capacité de faire des films similaires à ceux qu’ils ont pu faire il y a encore dix ans. Sur ce plan, nous assistons à la mort d’un certain cinéma africain. Est-ce qu’on a fait un travail suffisamment efficace pour qu’il y ait une transition vers des plus jeunes cinéastes ? J’en doute. Le chemin va être compliqué et dur pour la jeune génération de cinéastes provenant des pays d’Afrique.
On a tort de croire que l’accès facile à des moyens techniques, à des capacités de tournage va générer un nouveau cinéma. L’enjeu n’est pas seulement de faire du cinéma pour assouvir une ambition personnelle, c’est aussi de faire du cinéma « au centre », que les choses bougent au centre. Cela passe par les télévisions, en France et aux Etats-Unis, cela passe par les plus grands festivals dans le monde où l’on peut montrer que l’on a nos histoires, nos acteurs, nos techniciens. C’est là la bataille qu’il faut mener.
La bataille n’est pas de survivre en fabriquant des œuvres qui n’arriveront jamais à entrer dans le circuit professionnel. Certes, on peut faire un film, mais très peu arriveront à un contexte international, et c’est cela qui compte. On se retrouve aujourd’hui avec une cinématographie en danger.
À ce propos, vous êtes président de la FEMIS, l’école nationale de cinéma française, que pouvez-vous dire sur la question de la transmission ?
La transmission française est assurée ! Nous avons aussi des étudiants étrangers à la FEMIS. Il existe aussi quelques écoles, comme celle de Gaston Kaboré au Burkina Faso. En Afrique de l’Est, il existe aussi des écoles. Mais une génération de cinéastes, cela prend des années, ce n’est pas quelque chose qui peut surgir d’un coup. Il y a des dérives liées à la télévision, des formes plus faciles, qui n’éduquent pas du tout le public.
En France, il y a des cinéclubs, une éducation. Un cinéma, cela ne surgit pas comme cela de rien. C’est un ensemble de mesures, d’infrastructures à créer, de législation à mettre en place. Dans nombreux pays d’Afrique, à Haïti, il n’y a même plus de salles de cinéma. C’est la réalité à laquelle on est confrontés. Je ne crois pas à la naissance de cinémas forts « sans qu’on s’y mette ».
Le documentaire est-il une alternative ?
C’est même un pilier du cinéma. C’est à regretter que la cinématographie africaine n’ait pas produit beaucoup de documentaristes, à part Samba Félix Ndiaye, au Sénégal, qui est décédé aujourd’hui [des suites d'un neuro-paludisme foudroyant le vendredi 6 novembre 2009 à Dakar, NDLR], ou Jean-Marie Teno. Je pense que des documentaires pourraient aussi aller à Cannes, aussi bien que les fictions. Mais on est encore loin de la masse qu’il faudrait pour faire basculer les choses.
Propos recueillis par
Caroline Pochon / Clap Noir
Crédit photo : Grégoire Meersman
À lire
- Comment raconter des histoires qui fonctionnent à un public qui est formaté ? // www.clapnoir.org/spip.php?article577
- Le Chacha des indépendances // www.clapnoir.org/spip.php?article893
Palmarès Amiens 2012
Grand Prix du long métrage (Licorne d'Or) : OFFLINE de Peter Monsaert (Belgique, 2012)
Prix spécial du jury pour le long métrage : CONG BINH, LA LONGUE NUIT INDOCHINOISE de Lam Lê (France, 2012)
Prix de la Ville d’Amiens : YEMA de Djamila Sahraoui (Algérie/France, 2012)
Prix d'interprétation féminine (Ex-aequo) : ANEMONE VALCKE pour son rôle dans Offline de Peter Monsaert (Belgique, 2012) Ex-aequo
Prix d'interprétation féminine (Ex-aequo) : NERMINA LUKAC pour son rôle dans Eat Sleep Die de Gabriela Pichler (Suède, 2011)
Prix d'interprétation masculine : WIM WILLAERT pour son rôle dans Offline de Peter Monsaert (Belgique, 2012)
Mention spéciale du jury : EAT SLEEP DIE de Gabriela Pichler (Suède, 2011)
Prix du public long métrage : A VIRGEM MARGARIDA de Licinio Azevedo (Mozambique/France/Portugal, 2012)
Prix du public court métrage d’animation : HOW TO RAISE THE MOON de Anja Struck (Allemagne/Danemark, 2011)
Grand Prix du court métrage d’animation : OH WILLY de Emma de Swaef et Marc Roels (Belgique/France/Pays-Bas, 2011)
Prix spéciaux
Prix Fémis, décerné par des élèves actuels et anciens de La fémis (section Jeunes auteurs en Europe en compétition) : PROTESTATION VI de Rolando Colla (Suisse, 2012)
Prix SIGNIS (Association catholique mondiale pour la communication) : OFFLINE de Peter Monsaert (Belgique, 2012)
Mention spéciale au film : A VIRGEM MARGARIDA de Licinio Azevedo (Mozambique/France/Portugal, 2012)
Prix des Enfants de la Licorne (section Jeunes auteurs en Europe) : PROTESTATION VI de Rolando Colla (Suisse, 2012)
Prix du Moyen métrage : LA PART CELESTE de Thibaut Gobry (France, 2012)
Prix de la Maison d'arrêt d'Amiens
Prix du public : FAIS CROQUER de Yassine Qnia (France, 2011)
Prix du Canal 10 : PROTESTATION VI de Rolando Colla (Suisse, 2012)
Résultats du 17e Fonds d’aide au développement du scénario
4 bourses de 10 000 € chacune ont été accordées aux réalisateurs des projets suivants :
- VIOLENCE de Jorge Forero (Colombie)
- HAÏTI GROUND ZERO de Michelange Quay (Haïti)
- EVITA de Pablo Aguëro (Argentine/France)
- LAMB de Yared Zeleke (Éthiopie)
Et une bourse de 7 600 € au projet français FRANKAOUIS de Nadia El Fani (France)
Site officiel : www.filmfestamiens.org
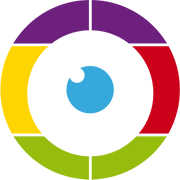 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images