Nouveauté africaine au Cinéma du Réel

Rencontre avec Dieudo Hamadi, en compétition pour Examen d'État, film soutenu par le Fonds Francophone (OIF / CIRTEF).
Le Festival Cinéma du Réel - du 20 au 30 mars 2014 - confronte les regards du monde dans une sélection exigeante de documentaires. Le Congolais Dieudo Hamadi y dévoile Examen d'État, en compétition internationale [voir les dates de projection, à la fin de l'article, ndlr]. C'est l'occasion de rencontrer son auteur pour aborder les questions de production, de sujets qui se posent aujourd'hui en Afrique francophone.
Le Festival international de films documentaires qui se tient au Centre Pompidou, à Paris, et ses salles partenaires, est un rendez-vous attendu pour mesurer l'évolution des cinéastes du genre. Le festival n'oublie pas ses racines en proposant d'évoquer l'œuvre de Jean Rouch, disparu il y a 10 ans, celle de Raymonde Carasco, tout en célébrant le 40ème anniversaire de la Révolution des Oeillets au Portugal, où les documentaires ont fleuri comme l'espoir. La production russe actuelle, le rapport de la nuit au " réalisme ", font découvrir dans les sections thématiques des films rares, discutés lors des débats explorant la diversité des écritures documentaires. Cinéma du Réel attire un public croissant et des professionnels motivés pour développer la production.
La sélection officielle, centrée sur 40 films dont 11 en compétition internationale, 10 en compétition française, 9 premiers films, se veut la vitrine des tendances actuelles. " Il s'agit de concevoir le festival comme un observatoire des documentaires du monde et un laboratoire pour le cinéma à venir ", déclarait Maria Bonsanti, en 2013, en devenant directrice du Cinéma du Réel. La sélection des films d'Afrique francophone reste rare même si on a pu remarquer des auteurs lorsqu'ils ont su s'affranchir des difficultés locales tel Samba Félix Ndiaye (1945-2009), devenu un habitué du festival, en défendant les valeurs du Sénégal.
La 36ème édition distingue le Congolais Dieudo Hamadi, révélé par Atalaku, Prix Joris Ivens du Meilleur premier film en 2013. Il accède à la compétition internationale avec Examen d'État, une réflexion incisive sur le système éducatif et ses alternatives au Congo, servie par un regard de proximité sur la jeunesse active. En venant à Paris accompagner les premières projections du film, Dieudo Hamadi évoque le sens de sa présence au Cinéma du Réel, en précisant la manière dont il a pu développer sa pratique du documentaire.
- Que représente pour vous, le fait d'être sélectionné au Cinéma du Réel ?
Pour le film, c'est un bon démarrage. L'an dernier, j'ai été dans ce festival avec mon premier long métrage Atalaku qui était dans la compétition des premiers films. Cette année, avec Examen d'État, je suis en compétition internationale. Pour moi, c'est assez gratifiant. C'est un niveau supérieur de reconnaissance.
- Reconnaissez-vous dans les autres films qui sont présentés autour de vous, au Cinéma du Réel, votre vision du documentaire ?
C'est enrichissant de participer à ce genre de festival. On se nourrit des regards des autres, de leur manière de traiter des sujets que l'on connaît ou qu'on a déjà traités avec un autre regard. C'est aussi un moyen pour moi de découvrir d'autres films, pas seulement ceux que je pourrais faire ou de la manière dont je pourrais les faire. Un festival comme le Cinéma du Réel m'offre cela aussi.
- Le fait que Atalaku ait été présenté l'an dernier au Cinéma du Réel, vous a t'il ouvert des portes, au delà du Prix du Meilleur premier film que vous y avez reçu ?
Oui, énormément. Cela m'a permis d'aller dans de nombreux festivals. Atalaku a été programmé au Festival des nouveaux cinémas documentaires à Paris, aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal, à Ânûû-rû âboro, Festival International du Cinéma des peuples en Nouvelle Calédonie, au Busan international Film Festival en Corée du Sud, au 8e Festival cinémas d'Afrique 2013 - Lausanne - Suisse, au Festival Vues d'Afrique : les Journées du cinéma africain et créole de Montréal 2013. Il a reçu le prix du jury au FIDADOC 2013 - Festival International du Documentaire à Agadir [Maroc, Ndlr]. Aujourd'hui, ces mêmes festivals sont impatients de découvrir Examen d'État.
- Quels sont les moyens que vous avez trouvés en cours de route, entre la présentation de Atalaku au Cinéma du Réel et celle de Examen d'État cette année ?
Ce qui nous manquait, ce n'était pas grand-chose. Vous savez, les documentaires aujourd'hui, c'est assez léger. Nous avions déjà reçu le soutien de l'OIF et de la commission sélective du COSIP au CNC suite à l'intérêt d'un diffuseur régional Vosges télévision. Mais ce peu nous manquait.
- Quelles sont les aides qui vous ont permis de boucler le budget ?
Une aide de l'Ambassade de France à Kinshasa est venue s'ajouter à la subvention octroyée par l'OIF. Cela m'a permis de rester plus longtemps à Kisangani et d'aller au bout de mon projet de filmer l'examen jusqu'aux résultats. Puis, le montage une fois terminé, le studio de postproduction Vidéo de Poche à Paris, est entré en coproduction pour nous permettre de mener à bien les finitions " image " d'un 90 minutes.
- Vous aviez besoin d'un gros budget pour Examen d'État ?
Non. Le cinéma que je fais n'a pas nécessairement besoin d'un gros budget. Mais même un petit budget, il faut le trouver.
Atalaku (extrait) par Telerama_Doc
- Vous parlez beaucoup d'aides européennes mais pas beaucoup d'aides qui viendraient de l'Afrique pour soutenir votre travail…
Malheureusement, la réalité aujourd'hui, en Afrique ou au Congo, ne me permet pas de parler d'aides venant de là. Le gouvernement congolais, par exemple, a d'autres priorités. La culture, il y a tout un ministère pour la gérer mais en fait il n'y a pas beaucoup de moyens. Et le cinéma n'est pas encore reconnu tout à fait comme une branche de la culture. Quand on veut faire un film, ce n'est pas à ces portes là qu'on va toquer forcément. En même temps, on reconnaît qu'il y a énormément de problèmes en République Démocratique du Congo, et on comprend que les priorités soient ailleurs. On aimerait être soutenus, qu'il y ait certaines aides venant de l'Afrique mais il n'y en a pas pour l'instant.
- Avez-vous soumis ou montré le projet de Examen d'État au Congo ?
Il faut qu'il y ait des interlocuteurs pour ça. On ne montre pas un projet à n'importe qui. En fait, il n'y a pas d'interlocuteurs culturels, il n'y a pas de guichets pour financer un film ou un projet de film. Il n'y a même pas de chaîne qui achète des films. Quand j'ai conçu Examen d'État ou mes autres films, j'ai su où aller toquer. Ça ne m'est jamais arrivé d'aller pousser les portes du gouvernement ou des institutions parce que l'aide n'existe pas tout simplement.
- Et dans d'autres pays autour du Congo, vous auriez pu trouver des appuis ?
À ma connaissance, non. Je sais qu'il y a un fonds d'aide au cinéma, récemment voté par le gouvernement sénégalais. Mais ce sont encore des choses encore assez floues pour moi. Pour l'instant, je sais que quand j'ai un producteur qui est intéressé par mon projet, il est possible de trouver des fonds destinés à l'Afrique, mais ils viennent d'Europe. C'est plus souple pour l'instant et ça me permet d'avancer, car je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour amorcer un projet. Peut être que plus tard, les aides locales au niveau de mon pays, vont suivre. Mais pour l'instant, ça n'existe pas alors je ne me pose pas la question.
- Comment est né le projet de Examen d'État ?
L'idée du film est arrivée en me baladant dans la rue, à Kinshasa. Dans mon quartier, il y avait une école et je voyais à la porte d'entrée des élèves qu'on empêchait d'entrer parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et l'idée du film m'est venue. À l'époque, je m'apprêtais à venir en France pour suivre une formation accélérée à la Femis, et j'avais juste décidé de la coucher sur papier pour ne pas l'oublier. Puisque c'était une formation sur le cinéma, on s'intéressait aux gens qui avaient des projets ou des débuts de projets. C'est comme ça que je l'ai fait lire à un de mes professeurs qui m'a mis en contact avec son amie productrice, Marie Balducchi. Et c'est parti comme ça… Quand je veux faire un film, c'est plus une idée qui vient en premier, ensuite ça dépend jusqu'où cela me touche, jusqu'où je suis prêt à le porter. Souvent ça se trouve être des projets qui me sont personnels, auxquels je suis sensible. Ensuite je décide d'écrire ; mais ça vient plus tard et c'est plus un travail vis-à-vis du producteur. On trouve que le projet est intéressant mais on demande de le mettre sur papier, et à ce moment là, je me mets à écrire. L'écriture est plus une contrainte pour moi parce que tout de suite, je sais ce que je veux faire.
- Quand vous voyez des enfants qui ne peuvent pas rentrer à l'école, dans votre rue, c'est une image. Quelle est l'idée qui vous motive à en faire un film ?
Par rapport à ce genre d'image, chaque jour on pourrait faire un film au Congo. Parce qu'il y a toujours des situations et des scènes qui peuvent faire des sujets. Je vais plus loin parce que le documentaire ne m'empêche pas d'être ambitieux, de vouloir faire des films viables cinématographiquement. Je combine un sujet qui me touche, un sujet social, avec cette rigueur ou cette envie d'en faire un film de cinéma. Après, on se pose la question de savoir comment le faire, comment le rendre universel pour que ce soit un film qui parle à beaucoup de gens, comment le porter artistiquement. Ça réduit un peu le champ des sujets.
- Qu'abordez-vous dans Examen d'État ?
Je montre des jeunes de ma ville, Kisangani, qui vont passer l'équivalent du Bac en France. Le Bac au Congo, s'appelle Examen d'État. La situation qui m'a semblé assez touchante, c'est que ces étudiants pendant toute l'année ou presque, n'avaient pas de professeurs. Les rares professeurs qui venaient pour enseigner s'assuraient qu'ils avaient payé ce qu'on appelle des primes pour l'enseignement, et comme ce sont des jeunes qui n'ont pas de parents riches, qui vivent au jour le jour, ils se faisaient tout le temps renvoyer, au fil de l'année scolaire. Comme ils sont en terminale, ils doivent passer l'Examen d'État. Ils n'envisagent pas d'échouer bien évidemment, alors ils s'organisent. Le film raconte comment ils s'organisent en dehors de l'école pour passer l'examen. Ils n'ont pas le soutien de leurs parents qui n'ont pas assez de moyens pour les aider à l'école. Ils n'ont pas le soutien de leurs enseignants parce que eux aussi, ils ont besoin de survivre et donc ils sont très durs avec eux. Du coup, ils décident par eux-mêmes de passer le Bac, avec leurs moyens.
- Vous les avez accompagnés pendant cette préparation ?
J'ai été avec eux pendant quatre mois. D'abord j'ai voulu rendre compte de ce qui se passait à l'école, mieux expliquer pourquoi ils vont la quitter pour aller se débrouiller ailleurs, ensuite je les ai suivis pendant la période de préparation où ils essaient de trouver des solutions afin de passer l'examen. Puis j'ai attendu que les résultats soient tombés pour voir si cela a fonctionné ou pas.
- Vous avez filmé et fait le son tout seul comme pour Atalaku ?
Oui, mais comme cette fois, j'avais un producteur, il était possible de trouver au moins des assistants. Il y avait même une boite de production sur place, Studios Kabako, qui m'a accompagné dans ce sens. C'était beaucoup moins rude que sur Atalaku où j'étais quasiment seul.
- Vous avez consulté les étudiants pour qu'ils acceptent que vous soyez là avec des assistants ?
Les assistants ne sont pas tout le temps avec moi. Quand j'en ai besoin, ils sont là. Mais la plupart du temps, je suis seul parce que je filme une réalité assez dure comme on peut le découvrir dans le film, et c'est beaucoup plus facile de le faire en étant seul. Je les filme de l'intérieur et j'ai voulu garder cette intimité. Quand j'avais besoin de filmer des scènes pareilles, je n'avais pas besoin d'assistants.
- Vous aviez fait des repérages précis ?
Le projet a pris trois ans et j'ai été à deux reprises à Kisangani pour préparer. Chaque fois qu'il fallait revenir pour tourner, on n'avait pas d'argent, et du coup on attendait. Ensuite quand il y avait un peu d'argent, on se disait qu'il fallait faire encore du repérage, je partais et il n'y avait pas d'argent. Voilà la situation, j'ai même perdu les premiers personnages que j'avais choisi d'accompagner. Après, ils ont réussi et ce n'était plus possible de faire le film avec eux. Cette fois, on a décidé de prendre plus de temps de tournage. Je suis resté quatre mois. C'était suffisant pour que j'ai le temps de trouver des personnages qui m'intéressent et que j'ai le temps de les suivre.
- Quand vous dites que la réalité est dure, qu'entendez-vous par là ?
Tout est dur finalement. Je ne parle pas particulièrement du cinéma ou du cas du Congo. Porter un projet ne se fait pas en claquant les doigts. On a besoin de moyens, il faut démarcher et ça prend du temps. Il faut gérer cela. Quand on vit dans une ville comme Kinshasa où le cinéma est quasi inexistant en ce moment, on ne peut pas en vivre. Quand vous choisissez de vivre de ça, c'est une contrainte supplémentaire et ça rend quand même les choses assez dures. En même temps, n'ayant pas suffisamment de moyens, vous êtes obligé de porter seul, la plupart du temps, tout le projet. Même sur le plan physique, c'est dur, c'est très éprouvant. Une création est un processus assez intense et éprouvant. C'est dans ce sens là que je parle. Au bout d'un moment, ça épuise.
- Les étudiants que vous suivez, vous soutiennent-ils quand vous vous sentez fatigué, que vous avez des doutes sur ce que vous faites ?
Ils ne savent pas ce que je fais. Le deal qu'on a fait, c'est que je leur ai proposé de les suivre pendant la préparation de l'Examen d'État. Ça se limite là. Les problèmes d'angoisse, de doutes, ils ne sont même pas au courant. Ils n'ont pas l'idée du film. C'est moi qui construis et qui sais où je veux aller, eux non. Tout ce que je leur demande, et ils y tiennent, c'est qu'ils puissent vivre devant ma caméra, faire ce qu'ils font d'habitude comme si je n'étais pas là. Ils comprendraient mal qu'ils puissent passer pour mes assistants à un moment, ou même pour des acteurs. Pour eux, c'est clair : on vous autorise à nous filmer pendant notre préparation. Moi, je dois gérer tout le reste, seul.
- Ce qui vous intéresse alors, c'est de regarder cette autogestion et cette prise en main de leur éducation par eux mêmes ?
Ce que j'essaie de montrer dans Examen d'État, c'est d'abord qu'on reconnaisse aux Congolais ce qu'on appelle la débrouille. Avec tout ce que nous avons subi, tous les drames qui se sont déroulé dans ce pays, il y a toujours des Congolais qui continuent à lutter, à se battre, à avancer… Cette énergie congolaise est particulière. Je voulais interroger ce sens de la débrouille, savoir ce qu'on peut construire avec une énergie pareille. Qu'est ce qu'on peut construire avec l'énergie du désespoir ? Ces jeunes dans le film, on voit très bien qu'ils ne lâchent pas. Ils ne s'avouent même pas vaincus. Ils n'ont pas d'école, qui est supposé être l'endroit où on apprend, ils n'ont même plus le droit d'étudier. Ils ne disent pas pour autant : " On arrête avec l'école et on va faire autre chose ". Non, ils trouvent même un moyen pour étudier sans école. À la fin, on découvre que certains sont quand même arrivés à leur but… Il y a toujours cette légendaire énergie congolaise, cette envie de lutter, cette force de se tenir debout face à l'adversité, face aux problèmes. Au bout du compte, on est en droit de se demander où tout ça va nous mener. C'est ce que j'ai voulu interroger à travers ce film. Oui, on est des gens résistants, on essaie de tenir, on vit au jour le jour mais est ce qu'on peut construire un pays comme ça, avec cette énergie du désespoir ? C'est la question de cet Examen d'État.
- Donc avec cette énergie, si l'institution n'est pas là, on arrive quand même à s‘éduquer…
On arrive à obtenir son diplôme d'état… Sauf qu'il s'agit de la jeunesse. Contrairement à Atalaku où c'était des jeunes délinquants, là ce sont des jeunes qui sont censés être instruits, les futurs cadres du pays, ceux qui sont censé prendre la relève. Je montre avec désarroi l'étendu du dégât pour l'avenir proche ou lointain. Si un système important comme celui de l'éducation est pris aussi à la légère, ça me pose des questions sur l'avenir de ce pays. Là, il s'agit des enfants éduqués, ça veut dire l'espoir du Congo. Avoir des diplômés sans formation, ça m'effraie et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce film.
- Croyez vous que les Congolais soient prêts à partager cet effroi qui est le vôtre, quand vous regardez le système de l'éducation ?
Au Congo même, les gens se posent cette question. En tous cas, j'espère que le film va servir à le montrer, d'une certaine manière. Ce qu'il y a de bien avec le cinéma, c'est qu'il amplifie certaines choses et ça donne un cadre pour discuter. On sait qu'il y a des problèmes au niveau du système éducatif au Congo, on sait qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Moi, j'offre juste à voir ces problèmes, de l'intérieur ou de manière assez particulière. Je ne doute pas un seul instant qu'en voyant ce film, les Congolais vont se rendre compte. Je ne suis pas sûr qu'ils vont découvrir des choses mais en tous cas, j'espère que ça va donner lieu à des débats. C'est important qu'on discute sur ce qu'on veut faire de l'avenir de ce pays, de la jeunesse de ce pays. C'est le but pour moi.
- Ce serait donc la caractéristique du documentaire pour vous : exposer des situations, exposer des problèmes que les gens qui les vivent ne voient pas assez ?
Pas forcément, ça dépend du projet. Pour ce projet là, peut être. Le documentaire pour moi, c'est un art, c'est du cinéma. Je veux faire du documentaire comme un moyen de m'exprimer et tout dépend de ce que je vais traiter. Souvent ça se trouve être des sujets qui me touchent, qui me mobilisent. Ça reste un genre assez accessible pour moi et c'est pour ça que je le fais. Avec une équipe réduite au maximum, c'est à dire moi-même, je peux arriver à faire quelque chose. C'est pour ça que je m'épanouis dedans. Ce n'est pas forcément pour essayer de dire des choses ou révéler des choses cachées. Ça peut servir à ça aussi, mais pour moi, ça reste jusqu'à présent, juste un moyen de communiquer, un moyen de partager un point de vue avec d'autres personnes.
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
(Africiné / Paris)
Les dates, heures et lieu de projection :
* Mercredi 26 Mars 10H30 CWB
* Vendredi 28 Mars 21H00 Cinéma 1
* Samedi 29 Mars 15H30 Cinéma 2
www.cinemadureel.org/fr/programme/competition-internationale/examen-detat
Contact producteur/distributeur : julie@agatfilms.com
Plus d'infos : urlz.fr/il7
Le Festival international de films documentaires qui se tient au Centre Pompidou, à Paris, et ses salles partenaires, est un rendez-vous attendu pour mesurer l'évolution des cinéastes du genre. Le festival n'oublie pas ses racines en proposant d'évoquer l'œuvre de Jean Rouch, disparu il y a 10 ans, celle de Raymonde Carasco, tout en célébrant le 40ème anniversaire de la Révolution des Oeillets au Portugal, où les documentaires ont fleuri comme l'espoir. La production russe actuelle, le rapport de la nuit au " réalisme ", font découvrir dans les sections thématiques des films rares, discutés lors des débats explorant la diversité des écritures documentaires. Cinéma du Réel attire un public croissant et des professionnels motivés pour développer la production.
La sélection officielle, centrée sur 40 films dont 11 en compétition internationale, 10 en compétition française, 9 premiers films, se veut la vitrine des tendances actuelles. " Il s'agit de concevoir le festival comme un observatoire des documentaires du monde et un laboratoire pour le cinéma à venir ", déclarait Maria Bonsanti, en 2013, en devenant directrice du Cinéma du Réel. La sélection des films d'Afrique francophone reste rare même si on a pu remarquer des auteurs lorsqu'ils ont su s'affranchir des difficultés locales tel Samba Félix Ndiaye (1945-2009), devenu un habitué du festival, en défendant les valeurs du Sénégal.
La 36ème édition distingue le Congolais Dieudo Hamadi, révélé par Atalaku, Prix Joris Ivens du Meilleur premier film en 2013. Il accède à la compétition internationale avec Examen d'État, une réflexion incisive sur le système éducatif et ses alternatives au Congo, servie par un regard de proximité sur la jeunesse active. En venant à Paris accompagner les premières projections du film, Dieudo Hamadi évoque le sens de sa présence au Cinéma du Réel, en précisant la manière dont il a pu développer sa pratique du documentaire.
EXAMEN D'ÉTAT, de Dieudo Hamadi, 2014 / Congo, France - Cinéma du Réel from Africiné www.africine.org on Vimeo.
Atouts et effets du Cinéma du Réel
- Que représente pour vous, le fait d'être sélectionné au Cinéma du Réel ?
Pour le film, c'est un bon démarrage. L'an dernier, j'ai été dans ce festival avec mon premier long métrage Atalaku qui était dans la compétition des premiers films. Cette année, avec Examen d'État, je suis en compétition internationale. Pour moi, c'est assez gratifiant. C'est un niveau supérieur de reconnaissance.
- Reconnaissez-vous dans les autres films qui sont présentés autour de vous, au Cinéma du Réel, votre vision du documentaire ?
C'est enrichissant de participer à ce genre de festival. On se nourrit des regards des autres, de leur manière de traiter des sujets que l'on connaît ou qu'on a déjà traités avec un autre regard. C'est aussi un moyen pour moi de découvrir d'autres films, pas seulement ceux que je pourrais faire ou de la manière dont je pourrais les faire. Un festival comme le Cinéma du Réel m'offre cela aussi.
- Le fait que Atalaku ait été présenté l'an dernier au Cinéma du Réel, vous a t'il ouvert des portes, au delà du Prix du Meilleur premier film que vous y avez reçu ?
Oui, énormément. Cela m'a permis d'aller dans de nombreux festivals. Atalaku a été programmé au Festival des nouveaux cinémas documentaires à Paris, aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal, à Ânûû-rû âboro, Festival International du Cinéma des peuples en Nouvelle Calédonie, au Busan international Film Festival en Corée du Sud, au 8e Festival cinémas d'Afrique 2013 - Lausanne - Suisse, au Festival Vues d'Afrique : les Journées du cinéma africain et créole de Montréal 2013. Il a reçu le prix du jury au FIDADOC 2013 - Festival International du Documentaire à Agadir [Maroc, Ndlr]. Aujourd'hui, ces mêmes festivals sont impatients de découvrir Examen d'État.
- Quels sont les moyens que vous avez trouvés en cours de route, entre la présentation de Atalaku au Cinéma du Réel et celle de Examen d'État cette année ?
Ce qui nous manquait, ce n'était pas grand-chose. Vous savez, les documentaires aujourd'hui, c'est assez léger. Nous avions déjà reçu le soutien de l'OIF et de la commission sélective du COSIP au CNC suite à l'intérêt d'un diffuseur régional Vosges télévision. Mais ce peu nous manquait.
- Quelles sont les aides qui vous ont permis de boucler le budget ?
Une aide de l'Ambassade de France à Kinshasa est venue s'ajouter à la subvention octroyée par l'OIF. Cela m'a permis de rester plus longtemps à Kisangani et d'aller au bout de mon projet de filmer l'examen jusqu'aux résultats. Puis, le montage une fois terminé, le studio de postproduction Vidéo de Poche à Paris, est entré en coproduction pour nous permettre de mener à bien les finitions " image " d'un 90 minutes.
- Vous aviez besoin d'un gros budget pour Examen d'État ?
Non. Le cinéma que je fais n'a pas nécessairement besoin d'un gros budget. Mais même un petit budget, il faut le trouver.
Atalaku (extrait) par Telerama_Doc
Echapper aux problèmes du Congo
- Vous parlez beaucoup d'aides européennes mais pas beaucoup d'aides qui viendraient de l'Afrique pour soutenir votre travail…
Malheureusement, la réalité aujourd'hui, en Afrique ou au Congo, ne me permet pas de parler d'aides venant de là. Le gouvernement congolais, par exemple, a d'autres priorités. La culture, il y a tout un ministère pour la gérer mais en fait il n'y a pas beaucoup de moyens. Et le cinéma n'est pas encore reconnu tout à fait comme une branche de la culture. Quand on veut faire un film, ce n'est pas à ces portes là qu'on va toquer forcément. En même temps, on reconnaît qu'il y a énormément de problèmes en République Démocratique du Congo, et on comprend que les priorités soient ailleurs. On aimerait être soutenus, qu'il y ait certaines aides venant de l'Afrique mais il n'y en a pas pour l'instant.
- Avez-vous soumis ou montré le projet de Examen d'État au Congo ?
Il faut qu'il y ait des interlocuteurs pour ça. On ne montre pas un projet à n'importe qui. En fait, il n'y a pas d'interlocuteurs culturels, il n'y a pas de guichets pour financer un film ou un projet de film. Il n'y a même pas de chaîne qui achète des films. Quand j'ai conçu Examen d'État ou mes autres films, j'ai su où aller toquer. Ça ne m'est jamais arrivé d'aller pousser les portes du gouvernement ou des institutions parce que l'aide n'existe pas tout simplement.
- Et dans d'autres pays autour du Congo, vous auriez pu trouver des appuis ?
À ma connaissance, non. Je sais qu'il y a un fonds d'aide au cinéma, récemment voté par le gouvernement sénégalais. Mais ce sont encore des choses encore assez floues pour moi. Pour l'instant, je sais que quand j'ai un producteur qui est intéressé par mon projet, il est possible de trouver des fonds destinés à l'Afrique, mais ils viennent d'Europe. C'est plus souple pour l'instant et ça me permet d'avancer, car je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour amorcer un projet. Peut être que plus tard, les aides locales au niveau de mon pays, vont suivre. Mais pour l'instant, ça n'existe pas alors je ne me pose pas la question.
Trouver des alliés pour développer une idée
- Comment est né le projet de Examen d'État ?
L'idée du film est arrivée en me baladant dans la rue, à Kinshasa. Dans mon quartier, il y avait une école et je voyais à la porte d'entrée des élèves qu'on empêchait d'entrer parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et l'idée du film m'est venue. À l'époque, je m'apprêtais à venir en France pour suivre une formation accélérée à la Femis, et j'avais juste décidé de la coucher sur papier pour ne pas l'oublier. Puisque c'était une formation sur le cinéma, on s'intéressait aux gens qui avaient des projets ou des débuts de projets. C'est comme ça que je l'ai fait lire à un de mes professeurs qui m'a mis en contact avec son amie productrice, Marie Balducchi. Et c'est parti comme ça… Quand je veux faire un film, c'est plus une idée qui vient en premier, ensuite ça dépend jusqu'où cela me touche, jusqu'où je suis prêt à le porter. Souvent ça se trouve être des projets qui me sont personnels, auxquels je suis sensible. Ensuite je décide d'écrire ; mais ça vient plus tard et c'est plus un travail vis-à-vis du producteur. On trouve que le projet est intéressant mais on demande de le mettre sur papier, et à ce moment là, je me mets à écrire. L'écriture est plus une contrainte pour moi parce que tout de suite, je sais ce que je veux faire.
- Quand vous voyez des enfants qui ne peuvent pas rentrer à l'école, dans votre rue, c'est une image. Quelle est l'idée qui vous motive à en faire un film ?
Par rapport à ce genre d'image, chaque jour on pourrait faire un film au Congo. Parce qu'il y a toujours des situations et des scènes qui peuvent faire des sujets. Je vais plus loin parce que le documentaire ne m'empêche pas d'être ambitieux, de vouloir faire des films viables cinématographiquement. Je combine un sujet qui me touche, un sujet social, avec cette rigueur ou cette envie d'en faire un film de cinéma. Après, on se pose la question de savoir comment le faire, comment le rendre universel pour que ce soit un film qui parle à beaucoup de gens, comment le porter artistiquement. Ça réduit un peu le champ des sujets.
Questionner l'éducation au Congo
- Qu'abordez-vous dans Examen d'État ?
Je montre des jeunes de ma ville, Kisangani, qui vont passer l'équivalent du Bac en France. Le Bac au Congo, s'appelle Examen d'État. La situation qui m'a semblé assez touchante, c'est que ces étudiants pendant toute l'année ou presque, n'avaient pas de professeurs. Les rares professeurs qui venaient pour enseigner s'assuraient qu'ils avaient payé ce qu'on appelle des primes pour l'enseignement, et comme ce sont des jeunes qui n'ont pas de parents riches, qui vivent au jour le jour, ils se faisaient tout le temps renvoyer, au fil de l'année scolaire. Comme ils sont en terminale, ils doivent passer l'Examen d'État. Ils n'envisagent pas d'échouer bien évidemment, alors ils s'organisent. Le film raconte comment ils s'organisent en dehors de l'école pour passer l'examen. Ils n'ont pas le soutien de leurs parents qui n'ont pas assez de moyens pour les aider à l'école. Ils n'ont pas le soutien de leurs enseignants parce que eux aussi, ils ont besoin de survivre et donc ils sont très durs avec eux. Du coup, ils décident par eux-mêmes de passer le Bac, avec leurs moyens.
- Vous les avez accompagnés pendant cette préparation ?
J'ai été avec eux pendant quatre mois. D'abord j'ai voulu rendre compte de ce qui se passait à l'école, mieux expliquer pourquoi ils vont la quitter pour aller se débrouiller ailleurs, ensuite je les ai suivis pendant la période de préparation où ils essaient de trouver des solutions afin de passer l'examen. Puis j'ai attendu que les résultats soient tombés pour voir si cela a fonctionné ou pas.
- Vous avez filmé et fait le son tout seul comme pour Atalaku ?
Oui, mais comme cette fois, j'avais un producteur, il était possible de trouver au moins des assistants. Il y avait même une boite de production sur place, Studios Kabako, qui m'a accompagné dans ce sens. C'était beaucoup moins rude que sur Atalaku où j'étais quasiment seul.
- Vous avez consulté les étudiants pour qu'ils acceptent que vous soyez là avec des assistants ?
Les assistants ne sont pas tout le temps avec moi. Quand j'en ai besoin, ils sont là. Mais la plupart du temps, je suis seul parce que je filme une réalité assez dure comme on peut le découvrir dans le film, et c'est beaucoup plus facile de le faire en étant seul. Je les filme de l'intérieur et j'ai voulu garder cette intimité. Quand j'avais besoin de filmer des scènes pareilles, je n'avais pas besoin d'assistants.
- Vous aviez fait des repérages précis ?
Le projet a pris trois ans et j'ai été à deux reprises à Kisangani pour préparer. Chaque fois qu'il fallait revenir pour tourner, on n'avait pas d'argent, et du coup on attendait. Ensuite quand il y avait un peu d'argent, on se disait qu'il fallait faire encore du repérage, je partais et il n'y avait pas d'argent. Voilà la situation, j'ai même perdu les premiers personnages que j'avais choisi d'accompagner. Après, ils ont réussi et ce n'était plus possible de faire le film avec eux. Cette fois, on a décidé de prendre plus de temps de tournage. Je suis resté quatre mois. C'était suffisant pour que j'ai le temps de trouver des personnages qui m'intéressent et que j'ai le temps de les suivre.
Valoriser l'énergie créative congolaise
- Quand vous dites que la réalité est dure, qu'entendez-vous par là ?
Tout est dur finalement. Je ne parle pas particulièrement du cinéma ou du cas du Congo. Porter un projet ne se fait pas en claquant les doigts. On a besoin de moyens, il faut démarcher et ça prend du temps. Il faut gérer cela. Quand on vit dans une ville comme Kinshasa où le cinéma est quasi inexistant en ce moment, on ne peut pas en vivre. Quand vous choisissez de vivre de ça, c'est une contrainte supplémentaire et ça rend quand même les choses assez dures. En même temps, n'ayant pas suffisamment de moyens, vous êtes obligé de porter seul, la plupart du temps, tout le projet. Même sur le plan physique, c'est dur, c'est très éprouvant. Une création est un processus assez intense et éprouvant. C'est dans ce sens là que je parle. Au bout d'un moment, ça épuise.
- Les étudiants que vous suivez, vous soutiennent-ils quand vous vous sentez fatigué, que vous avez des doutes sur ce que vous faites ?
Ils ne savent pas ce que je fais. Le deal qu'on a fait, c'est que je leur ai proposé de les suivre pendant la préparation de l'Examen d'État. Ça se limite là. Les problèmes d'angoisse, de doutes, ils ne sont même pas au courant. Ils n'ont pas l'idée du film. C'est moi qui construis et qui sais où je veux aller, eux non. Tout ce que je leur demande, et ils y tiennent, c'est qu'ils puissent vivre devant ma caméra, faire ce qu'ils font d'habitude comme si je n'étais pas là. Ils comprendraient mal qu'ils puissent passer pour mes assistants à un moment, ou même pour des acteurs. Pour eux, c'est clair : on vous autorise à nous filmer pendant notre préparation. Moi, je dois gérer tout le reste, seul.
- Ce qui vous intéresse alors, c'est de regarder cette autogestion et cette prise en main de leur éducation par eux mêmes ?
Ce que j'essaie de montrer dans Examen d'État, c'est d'abord qu'on reconnaisse aux Congolais ce qu'on appelle la débrouille. Avec tout ce que nous avons subi, tous les drames qui se sont déroulé dans ce pays, il y a toujours des Congolais qui continuent à lutter, à se battre, à avancer… Cette énergie congolaise est particulière. Je voulais interroger ce sens de la débrouille, savoir ce qu'on peut construire avec une énergie pareille. Qu'est ce qu'on peut construire avec l'énergie du désespoir ? Ces jeunes dans le film, on voit très bien qu'ils ne lâchent pas. Ils ne s'avouent même pas vaincus. Ils n'ont pas d'école, qui est supposé être l'endroit où on apprend, ils n'ont même plus le droit d'étudier. Ils ne disent pas pour autant : " On arrête avec l'école et on va faire autre chose ". Non, ils trouvent même un moyen pour étudier sans école. À la fin, on découvre que certains sont quand même arrivés à leur but… Il y a toujours cette légendaire énergie congolaise, cette envie de lutter, cette force de se tenir debout face à l'adversité, face aux problèmes. Au bout du compte, on est en droit de se demander où tout ça va nous mener. C'est ce que j'ai voulu interroger à travers ce film. Oui, on est des gens résistants, on essaie de tenir, on vit au jour le jour mais est ce qu'on peut construire un pays comme ça, avec cette énergie du désespoir ? C'est la question de cet Examen d'État.
- Donc avec cette énergie, si l'institution n'est pas là, on arrive quand même à s‘éduquer…
On arrive à obtenir son diplôme d'état… Sauf qu'il s'agit de la jeunesse. Contrairement à Atalaku où c'était des jeunes délinquants, là ce sont des jeunes qui sont censés être instruits, les futurs cadres du pays, ceux qui sont censé prendre la relève. Je montre avec désarroi l'étendu du dégât pour l'avenir proche ou lointain. Si un système important comme celui de l'éducation est pris aussi à la légère, ça me pose des questions sur l'avenir de ce pays. Là, il s'agit des enfants éduqués, ça veut dire l'espoir du Congo. Avoir des diplômés sans formation, ça m'effraie et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce film.
Partager ses vues par le cinéma
- Croyez vous que les Congolais soient prêts à partager cet effroi qui est le vôtre, quand vous regardez le système de l'éducation ?
Au Congo même, les gens se posent cette question. En tous cas, j'espère que le film va servir à le montrer, d'une certaine manière. Ce qu'il y a de bien avec le cinéma, c'est qu'il amplifie certaines choses et ça donne un cadre pour discuter. On sait qu'il y a des problèmes au niveau du système éducatif au Congo, on sait qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Moi, j'offre juste à voir ces problèmes, de l'intérieur ou de manière assez particulière. Je ne doute pas un seul instant qu'en voyant ce film, les Congolais vont se rendre compte. Je ne suis pas sûr qu'ils vont découvrir des choses mais en tous cas, j'espère que ça va donner lieu à des débats. C'est important qu'on discute sur ce qu'on veut faire de l'avenir de ce pays, de la jeunesse de ce pays. C'est le but pour moi.
- Ce serait donc la caractéristique du documentaire pour vous : exposer des situations, exposer des problèmes que les gens qui les vivent ne voient pas assez ?
Pas forcément, ça dépend du projet. Pour ce projet là, peut être. Le documentaire pour moi, c'est un art, c'est du cinéma. Je veux faire du documentaire comme un moyen de m'exprimer et tout dépend de ce que je vais traiter. Souvent ça se trouve être des sujets qui me touchent, qui me mobilisent. Ça reste un genre assez accessible pour moi et c'est pour ça que je le fais. Avec une équipe réduite au maximum, c'est à dire moi-même, je peux arriver à faire quelque chose. C'est pour ça que je m'épanouis dedans. Ce n'est pas forcément pour essayer de dire des choses ou révéler des choses cachées. Ça peut servir à ça aussi, mais pour moi, ça reste jusqu'à présent, juste un moyen de communiquer, un moyen de partager un point de vue avec d'autres personnes.
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
(Africiné / Paris)
Les dates, heures et lieu de projection :
* Mercredi 26 Mars 10H30 CWB
* Vendredi 28 Mars 21H00 Cinéma 1
* Samedi 29 Mars 15H30 Cinéma 2
www.cinemadureel.org/fr/programme/competition-internationale/examen-detat
Contact producteur/distributeur : julie@agatfilms.com
Plus d'infos : urlz.fr/il7
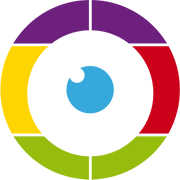 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images