La course de Run dans les salles de cinéma
08/01/2015
Rencontre avec Philippe Lacôte, réalisateur et scénariste de Run (Côte d’Ivoire / France)
La sortie simultanée du premier long-métrage de fiction de Philippe Lacôte, en Côte d’Ivoire et en France, semble vouloir prendre de vitesse l’époque qui fige les images africaines dans les circuits de distribution.
Depuis sa présentation à la section Un Certain Regard, au Festival de Cannes 2014, le film paraît avoir eu du mal à s’imposer sur un marché restreint pour les coproductions d’Afrique. Pourtant l’auteur de Run est aussi un combatif professionnel de la production. Il est financé avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d’Ivoire, la contribution de l’Union européenne et le concours du Groupe des Etats ACP, avec le soutien du Fonds Francophone de Production Audiovisuelle du Sud (OIF / CIRTEF).
Run tente de concilier le rythme du thriller remuant avec les mises en scènes plus contemplatives et symboliques, des évolutions de la Côte d’Ivoire dans les années 2000. Il s’attache à la course éperdue d’un homme qui abat le premier ministre et s’enfuit, en se rappelant trois étapes de son passé. Il esquive ses responsabilités d’apprenti faiseur de pluie, en quittant son village. Il se désolidarise brutalement de la mangeuse de foire qui l’a engagé et aidé, pour se retrouver chez les Jeunes Patriotes dont il se démarque encore. Cette trajectoire éclatée et tragique plonge ses racines dans les tumultes autour de « l’Ivoirité » qui ont clivé la Côte d’Ivoire.
Formé au pays, Philippe Lacôte a gagné la France pour développer une Maîtrise de Linguistique à Bordeaux. Il devient reporter à Radio FMR, enregistre des sujets dont la Chute du Mur de Berlin. Et il s’oriente vers le cinéma en réalisant des courts-métrages comme Somnambule, 1996, Le Passeur, 2004, et Affaire Libinski avec Delphine Jaquet, 2001. Il s’implique dans le documentaire avec Cairo Hours, 2003, suivant de jeunes écrivains égyptiens, puis revient au pays avec un sujet intime, fruit de cinq ans d’observation, Chroniques de guerre en Côte d'Ivoire, 2008, et To Repel Ghosts, 2013, sur le séjour ivoirien du peintre Jean-Michel Basquiat, qui précède Run.
Avec sa double nationalité, franco-ivoirienne, Philippe Lacôte est producteur au sein de Banshee Films à Paris, actif dans Wassakara Productions à Abidjan. Il soutient des documentaires dont Boul Fallé de Rama Thiaw, du Sénégal, 2008, Koukan Kourcia – Le Cri de la tourterelle de Sani Elhadj Magori, du Niger, 2010, la fiction ivoirienne Le djassa a pris feu de Lonesome Solo, 2012, où il rencontre l’acteur principal de Run. Aborder la distribution du film, l’état des productions africaines, le choc des images, est une manière de fixer ce qui fait courir Philippe Lacôte.
Distribuer Run en coup double
- Pourquoi avoir choisi de coupler la sortie de Run en France et en Côte d’Ivoire ?
En fait, on est sortis un peu plus tôt que prévu, en France, pour des problèmes de place, de disponibilité dans les salles. La date en Côte d’Ivoire n’était pas loin, à deux jours près. On s’est dit que ça pouvait créer un événement, symbolique aussi, vu que le film a été fabriqué par deux structures, dans les deux pays : tournage en Côte d’Ivoire, post production en France. Moi même, je me situe aussi entre les deux pays. C’était aussi une manière de relancer le cinéma en Côte d’Ivoire, de créer une sorte d‘événement.
- Comment Run a été distribué en Côte d’Ivoire ?
Il n’y a pas réellement d’industrie du cinéma en Côte d’Ivoire. Donc, il a été distribué par notre structure de production qui s’est affiliée à une agence de communication, et avec l’ONAC-CI qui est l’Office National du Cinéma de Côte d’Ivoire.
- Dans quelles salles avez-vous pu le montrer ?
Il y a deux salles en Côte d’Ivoire, à Abidjan. Il a été montré dans les deux. En mars, l’Institut français ouvre avec une projection en DCP. Le film sera à nouveau montré et restera encore une semaine. On est en train d’organiser une tournée dans le pays avec des projections itinérantes. On s’adapte au contexte local.
- Vous accompagnez les projections itinérantes ?
Je vais en accompagner une partie, avec l’acteur Abdoul Karim Konaté, parce qu’elles sont faites en partenariat avec la Commission Réconciliation. L’idée c’est qu’il y ait des débats. J’ai été très sensible lors de la sortie à Abidjan, aux questions que ça suscite sur le travail de mémoire, de reconstruction d’un pays.
- On peut imaginer que vous avez vécu la sortie en France, qui a été modeste, de manière différente ?
La sortie en France a été différente mais je m’y attendais. J’ai pas mal travaillé en tant qu’assistant de production, avec ATRIA où j’ai même côtoyé Abderrahamane Sissako, et je pense qu’en France on n’est pas prêts à ce que deux films africains, ou dits africains, sortent en même temps. C’est trop. On a besoin d’un regard par an, d’un roi du cinéma africain. Ça a été Souleymane Cissé, après Idrissa Ouédraogo. Ça change chaque fois et c’est une vision un peu binaire.
Moi, je trouve cette sortie, qui suit celle de Timbuktu de Abderahamane Sissako, très positive parce que les films sont différents. C’est mon premier film, alors que Sissako en est à son cinquième. Quand il a sorti La Vie sur terre, en 2000, il n’y avait pas beaucoup de spectateurs. Donc c’est quelque chose qui se fabrique, se travaille. J’espère que la visibilité au Festival de Cannes, cette sortie en salles, cet écho aussi sur le continent africain, tout cela va faire que pour le prochain film, il y aura plus de spectateurs.
- Vous parlez de la visibilité à Cannes, que vous a-t-elle apporté ?
Le fait que le film a été repris dans beaucoup de festivals, à Toronto, Los Angeles… Elle a permis à beaucoup de gens de le voir, de faire beaucoup d’interviews. La Côte d’Ivoire a pu ainsi se repositionner sur le cinéma africain ou international. Ça a permis qu’on connaisse mon nom tout simplement. Je travaillais avant mais cette visibilité fait que, tout d’un coup, on se dit qu’il y a un réalisateur qui rentre dans l’arène, si j’ose dire, et qu’on va voir ce qu’il va faire après.
- Vous n’auriez pas pu profiter de cet effet de Cannes pour distribuer le film plus tôt, en France ?
Ce sont des problèmes de stratégie. On avait prévu de sortir le film en novembre. Je ne sais pas si c’était une meilleure date. Je pense que les distributeurs ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour trouver l’espace. Ce qui m’a manqué le plus, c’est la ligne sur laquelle on devait aller chercher les spectateurs. Aussi bien pour la structure de production Banshee Films en France, que pour moi en tant que réalisateur, c’est le premier film qui sort et c’est une expérience. On va en tirer des leçons, on va avancer. Je sais que c’est un film qui sera vu, au final, mais je ne sais pas si c’est un film uniquement de salles. C’est un film de festivals, pour quelques salles avec des avant-premières et le réalisateur présent. Pour ce genre de films qui sont dans une écriture assez particulière, s’ils ne sont pas suivis par les médias qui déclenchent les cinéphiles, c’est difficile.
- Quelle image donnez vous à Run pour que les gens aillent le voir ?
Justement, l’image a été un peu difficile à trouver. Finalement je pense qu’il n’y en a pas vraiment parce que c’est un film qui trimbale avec lui beaucoup de choses, qui va puiser dans le réel, dans l’histoire politique. Pour moi, c’est une tentative de cinéma. À Cannes, des journalistes ont dit : « Run, c’est un jeune Africain qui s’invente sur l’écran ». Je crois que c’est ça, et il y a une écriture de cinéma qui est proposée. Bien sûr, elle n’est pas parfaite. C’est une écriture faite de heurts, de chocs, de cassures, qui mélange des genres. Elle est hyper narrative comme ça. C’est ça que j’ai envie de défendre.
Produire Run comme un film d’auteur
- Le projet est il né au départ, avec l’envie de mélanger les écritures ?
Le projet a toujours été comme ça. Mes autres films aussi. Dans mon documentaire, Chroniques de guerre en Côte d’Ivoire, il y a déjà trois parties. Dans mes fictions, ce sont des choses qu’on retrouve aussi, avec des personnages qui courent, qui inventent leur présent. L’enjeu a été de traduire cette histoire en scénario, susceptible d’aller convaincre Arte, l’Avance sur recettes. C’était comme ça, et ça n’a pas été inventé au montage.
- Comment avez vous convaincu les financiers qui vous ont aidé ?
Il y avait des réticences. C’est normal, c’est un premier film. On trouvait qu’il y avait trop de flashbacks, que le récit pouvait partir dans tous les sens. A partir du moment où le présent du film fait 20 minutes et le passé 1h20, il faut qu’on aborde ça autrement. On n’est plus dans la notion de flashbacks mais dans une succession de temps, présent, ancien, futur. Il y a des prémonitions aussi. C’est comme ça qu’on l’a expliqué. Et le fait que ça puisse partir dans tous les sens, c’est mon écriture. Je travaille avec ce que je suis, un raconteur d’histoires. J’aime le cinéma, je vais puiser dans des histoires des autres, dans des genres différents. Comme le fait Sergio Leone par exemple.
- Comment avez vous pu monter concrètement, la production ?
On l’a monté entre la Côte d’Ivoire et la France : Wassakara Productions avec Ernest Konan, le producteur ivoirien, et Claire Gadéa, la productrice française sur Banshee Films même si je suis impliqué. Au départ, on est allé chercher de l’argent vers le Sud et en même temps, dans le système français. A un moment, une chaîne, Arte, nous a suivis, et sur l’Afrique, Canal Afrique. Après comme partenaire important, il y a la Francophonie (l’OIF), qui nous a suivis sur le Sud et l’UE-ACP, le Groupe des Etats ACP, puis sur le Nord, l’Avance sur recettes. Voilà comment on a monté le projet, avec un Prix du scénario à Jérusalem qui est entré en production.
- Cela fait un gros budget ?
Non. C’est 1,5 million d’euros. C’est un gros budget pour la Côte d’Ivoire parce qu’il n’y a pas beaucoup de films qui se font aujourd’hui et peu de réalisateurs arrivent à ramener ces sommes là. C’est un petit budget pour la France. Je dirai que ça m’a permis de travailler correctement. Pour la prochaine fois, je ne recherche pas plus. Je cherche à rendre ce budget plus efficace, à connaître bien cette taille. Je la trouve juste pour moi, et je vais retravailler dans un dispositif proche.
- Avez-vous la même implication dans les deux structures de production, en Côte d’Ivoire et en France ?
En Côte d’Ivoire, je suis impliqué parce qu’il n’y a pas de structure. On est un collectif avec les acteurs du film, le producteur. Le collectif a tout mis en place. En France, c’est Claire Gadéa qui a produit le film. On a aussi travaillé avec Isabelle Fauvel qui s’est occupée du développent. Je suis impliqué parce que je pense que c’est bien, quand l’économique est au service de l’artistique pour des films comme ça. Ils ne font pas des millions de recettes. L’objectif c’est d’arriver à un objet qu’on défend. Par exemple, il y a des effets spéciaux dans le film et on a eu l’aide des nouvelles technologies CNC. Pour moi, ils étaient très importants. Donc on mène des discussions à cheval entre l’artistique et l’économique.
Run pour réveiller le cinéma en Côte d’Ivoire
- Pourquoi avant Run, avez-vous produit les films des autres ?
J’ai un parcours de réalisateur et de producteur. J’ai commencé à faire mes courts-métrages en 1993, en France. Ils étaient en noir et blanc, très expressionnistes, en 35mm. Après il fallait bien survivre et je n’avais pas envie d’être assistant réalisateur. Je suis allé travailler en tant qu’assistant producteur. Là j’ai côtoyé des producteurs comme Jacques Bidou, j’ai travaillé avec Andrée Daventure dans le cinéma africain, et avec d’autres producteurs. J’ai côtoyé Humbert Balsan même si je n’ai pas travaillé avec lui. La production m’a toujours intéressé. C’est pour ça qu’avec Claire Gadéa, on a fabriqué un tandem pour Banshee Films. Je me considère plus comme un producteur artistique. Sur les projets que je produits, mon action, c’est plus l’accompagnement en écriture, repérer les réalisateurs.
- Les réalisateurs de documentaires africains que vous avez produits ne viennent pas de la Côte d’Ivoire, pourquoi ?
Ça a été plus facile de les produire sur la structure ivoirienne, Wassakara Productions. C’est vrai que Run est le premier long-métrage de la structure française, Banshee Films, avec un budget plus important. Le djassa a pris feu, tourné à Abidjan, l’a été avec 10 000 euros. C’était une fiction très Nouvelle Vague, filmée en 11 jours. Boul Fallé de Rama Thiaw, tourné au Sénégal, un film sur la lutte, n’a pas couté un énorme budget. Aujourd’hui, c’est peut-être plus facile de déclencher des choses dans l’urgence, plus nécessaires, du côté du Sud. La Côte d’Ivoire est vraiment le terrain où j’ai envie de raconter mes prochaines histoires et continuer à produire des jeunes documentaristes.
- Vous y trouvez la situation favorable pour des projets de cinéma ?
Il y a maintenant une Commission. Il y avait la décision de l’ancien président Laurent Gbagbo de créer une Commission de cinéma. Elle a été mise en place par le nouveau pouvoir. Elle fonctionne. Run a été le premier film à en bénéficier, grâce à une avance sur recettes de 150 000 euros. Deux réalisateurs ivoiriens, Jacques Trabi et Owell Brown, ont aussi bénéficié de cette aide. On n’a jamais eu une configuration aussi précise. Il y a déjà eu de l’argent mais jamais une Commission.
Pour 2015, le montant du fond a été doublé parce qu’il y a eu des résultats. C’est une bonne chose. Après, il y a encore des choses sur lesquelles il faut progresser. La Côte d’Ivoire reste un pays fragile. Personne ne peut dire où on va. Un pays, ça se construit. Si on veut faire des films, si on veut que la Côte d’Ivoire revienne à un niveau de cinématographie qu’elle avait, il faut y aller. Il y a des jeunes qui ont des projets de documentaires, de courts-métrages. Il s’agit avec le peu d’expérience en plus qu’on a, de les accompagner, de partager ça.
- Les spectateurs sont-ils prêts à venir, ou à revenir, dans les salles en Côte d’Ivoire ?
Les Ivoiriens sont très intéressés par le cinéma, ou alors ils sont très nostalgiques des années 80 où il y avait 50 salles de cinéma. C’est à partir du coup d’Etat de 1999, par le Général Robert Guéï, que les salles ont été vidées, complètement désertées. Au Nigéria, ça a été pareil. On voit que la raison sécuritaire est très forte. Les Ivoiriens sont de grands amateurs de cinéma. Quand on tourne dans la rue, ils viennent nous voir, nous féliciter. Mais c’est une pratique qui a disparu. Pour un film comme Run, on réussit à mobiliser les gens en salles, mais pas sur du long terme. Il faut recréer des événements à chaque fois. C’est pour ça qu’en mars 2015, on va recréer un événement avec le cinquantenaire du cinéma et l’ouverture de l’Institut français. C’est progressif.
Run pour télescoper les sensations
- Les spectateurs ivoiriens vous ont suivi comme vous le pensiez ?
Je pensais qu’ils allaient être intéressés par le film et ça a été le cas. Il y a eu beaucoup de questions autour du travail de mémoire, de reconstruction. J’ai été surpris sur certains points comme par exemple, la nudité. Dans le film, il y a une scène où l’acteur principal est nu, ça a choqué. Et puis il y a le coté politique. Quand je montre les Jeunes Patriotes, même ceux qui ne sont pas politiquement impliqués, se demandaient pourquoi on parlait de ça, pourquoi on allait aussi loin dans le sujet. Il y avait une sorte de silence dans la salle, comme si personne ne voulait être associé à ça. Ça a réveillé des questions sur la mémoire. Maintenant le film va tourner dans différentes villes, je vais l’accompagner, on va voir les réactions. Mais les Ivoiriens sont fiers de l’aspect technique du film, la lumière, la caméra. C’est dans ce sens qu’il faut qu’on aille.
- La narration que vous avez voulue éclatée, ne déconcerte pas les gens ?
Non. J’avais peur de ça parce que c’est une narration qui est peut-être celle de cinéphiles ou de gens qui jouent avec le langage cinématographique. Là ça n’a pas choqué parce que, en même temps, c’est assez narratif. Il y a toujours un fil, la voix off qui amène. Cette narration déconstruite, je dirais que c’est plus en France qu’elle choque. Aujourd’hui, être linéaire au cinéma, c’est une position idéologique. Ça veut dire qu’on croit à une chronologie, à une avancée du temps. Ça veut dire qu’on pense que demain sera meilleur qu’aujourd’hui, et qu’on tire des leçons des choses. C’est complètement faux, ce n’est pas ma perception ni du temps, ni des formes, ni ma pensée philosophique.
- Ça veut dire que vous vous mettez en rupture par rapport à l’esprit occidental, plus cartésien, qui a une vision progressiste de la société ?
Tout à fait. Je me place avec des personnages, et mon objectif est toujours de raconter ce qu’il y a dans leur tête. Je me place avec eux dans des situations de chaos, de présent très fort, qui vont créer des ruptures chez les personnages. Ils sont toujours dans un grand questionnement identitaire et se demandent si ce qu’ils ont fait hier, avant-hier, était bien… Ça construit complètement leur présent, ça le contamine, ça le dynamise. Donc ils sont dans des allers-retours. Un personnage comme Run dit : « Voici ce que j’ai fait ». Ça représente 20% du film et il est en train de dire : « Mais pourquoi je n’ai pas fait ça, pourquoi je n’ai pas fait cela… » Pour moi, ce temps là est beaucoup plus juste sur la nature humaine, les expériences qu’on tire. Les flashbacks ne sont pas formels. Tout être humain qui marche dans la rue, fait des flashbacks dans sa tête. C’est une dynamique de pensée. Cette superposition de temps m’intéresse. C’est ma culture, toutes mes cultures en tous cas. Et c’est en même temps, ce temps de cinéma, ce temps réel, ce temps mystique. Dans ces trois temps, aujourd’hui en Côte d’Ivoire, la frontière entre le visible et l’invisible, entre le monde onirique et le monde réel est très mince. Dans le film, j’ai joué avec tous ces éléments. On peut parler des Jeunes Patriotes, on peut filmer caméra à l’épaule dans les rues de Yopougon, et le jeune Run qui est là, peut y être parce que, un jour, à dix ans, sur une colline, son maître lui a fait une prédiction. Tout ça, c’est l’Afrique aujourd’hui. En tous cas, c’est la Côte d’Ivoire. La part de mystique est très importante dans la politique. Le conflit qu’on a vécu est très réel. Tous ces matériaux très cinématographiques m’accompagnent depuis un moment. J’ai envie de continuer avec ça, de les préciser. C’est une vision.
- Pourquoi cette vision finit au moment où le film commence ?
Parce que j’aime bien travailler sur les boucles. L’idéal pour moi, serait que le film passe sans s’arrêter… Ce qui était important, ce n’était pas le geste de Run, dire : « Je tire, j’ai tué le premier ministre », c’était à partir de ce geste, de reconstruire tout le parcours de ce jeune homme, et l’histoire de la Côte d’Ivoire. J’avais envie de cet impact pour qu’on s’intéresse à ce jeune, qu’il traverse toute son histoire et qu’on le retrouve au même endroit comme si nous, on avait évolué avec lui. J’aime bien quand les personnages s’inventent sur l’écran avec nous. La plupart de mes personnages n’ont pas de nom. Ils se font baptiser sur l’écran. J’aime quand les personnages se fabriquent à l’instant présent et que le spectateur participe à ça. J’avais envie qu’on retrouve Run dans cette cathédrale, dans la même séquence que la première, là où il a tiré. Mais là, Run n’est plus un jeune homme qu’on ne connaît pas, transformé en fou qui tire. Run est un jeune homme dont on a suivi l’enfance, l’adolescence, les relations avec le premier ministre sur qui il va tirer, dont on a suivi tous les tremblements, et donc on le revoit autrement.
- Ça voudrait dire aussi que l’histoire est cyclique ?
L’histoire de la Côte d’Ivoire a quelque chose à voir avec un cercle, un cycle. Mon propos était de poser la question aux Ivoiriens, de savoir comment on avait basculé dans la violence. Est-ce que cette violence n’était pas là avant ? N’était-elle pas inscrite dans les années Houphouët-Boigny quand on disait que tout allait bien ? Nous, on était enfants mais on savait bien que tout n’allait pas bien puisque nos parents étaient en prison. Donc la violence était déjà là et elle a pris d’autres formes. Si l’on veut penser les choses pour le futur en Côte d’Ivoire, il faut questionner toutes les violences successives qu’il y a eu. L’idée n’est pas d’accuser un camp ou l’autre, ce n’est pas mon rôle en tous cas. L’histoire de ce film, c’est l’histoire d’un jeune homme qui refuse la violence, qui va fuir sa vie pour ça, et qui, à la fin, va commettre cet acte de violence… En terme d’écriture, on part de quelque chose de très classique, de très harmonieux avec des travellings, avec de la nature, des montagnes, et on arrive, en passant par le personnage de Gladys la mangeuse, à quelque chose de très déstructuré avec une caméra à l’épaule. Je voulais aussi à travers la forme, dire cette histoire de la Côte d’Ivoire.
Run pour dépasser les genres
- Vous allez poursuivre ce souci de la forme dans un prochain projet ?
Oui, je travaille sur un nouveau projet qui va être encore fait de flashbacks, et va se tourner en Côte d’Ivoire. A la prison d’Abidjan, il y a une pratique qui fait que les prisonniers choisissent l’un d’entre eux et l’appellent Roman. Ça désigne celui qui est chargé toutes les nuits, de raconter une histoire aux autres, jusqu’au matin. Je vais raconter l’histoire de cet homme, quelqu’un qui n’a toujours pas de nom. Il va raconter des histoires avec des flashbacks, dont le récit d’un naufrage, qui est une histoire de Edgar Allan Poe.
- Allez-vous monter la production de la même manière que pour Run ?
On espère le faire parce que ça a bien fonctionné, avec un partenaire ivoirien qui est celui qui gère le terrain, des appels vers des fonds du Sud, et avec une structure de France, Banshee Films, qui va rechercher une chaîne, l’Avance sur recettes. C’est un projet qui est ouvert et va peut-être faire rentrer un partenaire plus costaud, plus expérimenté. Pour l’instant, je suis en écriture et les ingrédients sont les même, avec de la magie, de l’onirisme encore mais tout ça tiré dans du réel. Ca sera aussi un portrait de l’après guerre en Côte d’Ivoire. Il y aura des personnages fracassés, à qui il manque des choses, qui ont perdu des gens, et qui sont là en train d’essayer de s’associer pour se ressouder.
- Vous avez besoin de concevoir les choses seul ou en collectif ?
Je travaille avec des collaborateurs qui sont là depuis longtemps, un mixeur comme Emmanuel Croset que je connais depuis 15 ans, Delphine Jaquet, ma collaboratrice artistique, Claire Gadéa qui a produit mes courts-métrages. Dans mon prochain film, il y aura les acteurs que vous avez vus dans Run : Isaach de Bankolé, Abdoul Karim Konaté. Après, j’ai ma vision des choses que je n’explique pas forcément. Dans le domaine artistique, je ne crois pas à un compromis de tout le monde. Il y a des choses que je défends et je vais chercher les arguments. Par exemple, l’Avance sur recettes, on ne l’a pas eu du premier coup. Je comprends que cet univers ne passe pas toujours. Donc on va chercher les arguments, on essaie de convaincre. Si vous lisez un écrivain comme Gabriel Garcia Marquez, vous voyez qu’on n’a rien inventé, c’est juste une sensibilité.
- Pourquoi faites vous référence à un écrivain plutôt qu’à un cinéaste ?
Parce que ce réalisme magique, comme on l’appelle, c’est une culture. Je fais référence à deux personnes qui ne sont pas cinéastes. D’abord il y a Gabriel Garcia Marquez pour le picaresque, pour le fantastique. Ca peut se côtoyer pour dire des choses, en tous cas dans certaines cultures. Et je fais appel à John Coltrane pour le rythme, le souffle. Quand je regarde ce que j’ai fait, si je ne suis pas bien callé dans le siège au début, si je ne rentre pas bien dedans, même moi, je rate le film. Donc c’est un souffle, c’est un beat avec des breaks, des ruptures, des sons qui sont au même niveau que les dialogues, des choses relais, des tentatives dans d’autres genres, des allers-retours. C’est quelque chose que je vais chercher chez quelqu’un comme John Coltrane qui travaillait aussi ces formes cycliques.
- Vous êtes satisfait du résultat final ?
J’ai coupé quatre minutes après Cannes, parce qu’on avait fini le film juste trois jours avant. Aujourd’hui, sur la forme, je suis satisfait à 95%. C’est ce que je voulais faire. En fait, j’aime bien circuler dans le cinéma et je ne crois pas à la synthèse. Je ne crois pas au réalisateur qui pense tout chez lui, qui sort et met la ligne pure sur l’écran. Moi je mets ce qui me traverse et ce qui bouillonne. Je le mets comme ça parce que je pense que l’échange avec le spectateur, c’est un échange au présent. C’est un échange dans la complexité, pas dans la synthèse. Si je veux qu’on débatte, et si j’ai déjà tout synthétisé, on ne va pas débattre. Ma matière peut paraître brouillonne, impulsive, mais c’est un respect pour le spectateur.
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
(Africiné / Paris)
pour Images Francophones
Suivre l'actualité du film
www.facebook.com/events/898231236861931
À lire
* Run, Course à la liberté en Côte d’Ivoire, par Michel Aamrger (Africiné)
* "J'aime quand le merveilleux vient éclairer le réel", entretien d'Olivier Barlet avec Philippe Lacôte et Isaac de Bankolé à propos de Run (Africultures)
* Run, de Philippe Lacôte, de Hassouna Mansouri (Africiné), lors de la présentation à Cannes.
Photo : Scène du film Run de Philippe Lacôte
Crédit : Banshee Films / Wassakara Productions / Diam Production
Depuis sa présentation à la section Un Certain Regard, au Festival de Cannes 2014, le film paraît avoir eu du mal à s’imposer sur un marché restreint pour les coproductions d’Afrique. Pourtant l’auteur de Run est aussi un combatif professionnel de la production. Il est financé avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d’Ivoire, la contribution de l’Union européenne et le concours du Groupe des Etats ACP, avec le soutien du Fonds Francophone de Production Audiovisuelle du Sud (OIF / CIRTEF).
Run tente de concilier le rythme du thriller remuant avec les mises en scènes plus contemplatives et symboliques, des évolutions de la Côte d’Ivoire dans les années 2000. Il s’attache à la course éperdue d’un homme qui abat le premier ministre et s’enfuit, en se rappelant trois étapes de son passé. Il esquive ses responsabilités d’apprenti faiseur de pluie, en quittant son village. Il se désolidarise brutalement de la mangeuse de foire qui l’a engagé et aidé, pour se retrouver chez les Jeunes Patriotes dont il se démarque encore. Cette trajectoire éclatée et tragique plonge ses racines dans les tumultes autour de « l’Ivoirité » qui ont clivé la Côte d’Ivoire.
Formé au pays, Philippe Lacôte a gagné la France pour développer une Maîtrise de Linguistique à Bordeaux. Il devient reporter à Radio FMR, enregistre des sujets dont la Chute du Mur de Berlin. Et il s’oriente vers le cinéma en réalisant des courts-métrages comme Somnambule, 1996, Le Passeur, 2004, et Affaire Libinski avec Delphine Jaquet, 2001. Il s’implique dans le documentaire avec Cairo Hours, 2003, suivant de jeunes écrivains égyptiens, puis revient au pays avec un sujet intime, fruit de cinq ans d’observation, Chroniques de guerre en Côte d'Ivoire, 2008, et To Repel Ghosts, 2013, sur le séjour ivoirien du peintre Jean-Michel Basquiat, qui précède Run.
Avec sa double nationalité, franco-ivoirienne, Philippe Lacôte est producteur au sein de Banshee Films à Paris, actif dans Wassakara Productions à Abidjan. Il soutient des documentaires dont Boul Fallé de Rama Thiaw, du Sénégal, 2008, Koukan Kourcia – Le Cri de la tourterelle de Sani Elhadj Magori, du Niger, 2010, la fiction ivoirienne Le djassa a pris feu de Lonesome Solo, 2012, où il rencontre l’acteur principal de Run. Aborder la distribution du film, l’état des productions africaines, le choc des images, est une manière de fixer ce qui fait courir Philippe Lacôte.
Distribuer Run en coup double
- Pourquoi avoir choisi de coupler la sortie de Run en France et en Côte d’Ivoire ?
En fait, on est sortis un peu plus tôt que prévu, en France, pour des problèmes de place, de disponibilité dans les salles. La date en Côte d’Ivoire n’était pas loin, à deux jours près. On s’est dit que ça pouvait créer un événement, symbolique aussi, vu que le film a été fabriqué par deux structures, dans les deux pays : tournage en Côte d’Ivoire, post production en France. Moi même, je me situe aussi entre les deux pays. C’était aussi une manière de relancer le cinéma en Côte d’Ivoire, de créer une sorte d‘événement.
- Comment Run a été distribué en Côte d’Ivoire ?
Il n’y a pas réellement d’industrie du cinéma en Côte d’Ivoire. Donc, il a été distribué par notre structure de production qui s’est affiliée à une agence de communication, et avec l’ONAC-CI qui est l’Office National du Cinéma de Côte d’Ivoire.
- Dans quelles salles avez-vous pu le montrer ?
Il y a deux salles en Côte d’Ivoire, à Abidjan. Il a été montré dans les deux. En mars, l’Institut français ouvre avec une projection en DCP. Le film sera à nouveau montré et restera encore une semaine. On est en train d’organiser une tournée dans le pays avec des projections itinérantes. On s’adapte au contexte local.
- Vous accompagnez les projections itinérantes ?
Je vais en accompagner une partie, avec l’acteur Abdoul Karim Konaté, parce qu’elles sont faites en partenariat avec la Commission Réconciliation. L’idée c’est qu’il y ait des débats. J’ai été très sensible lors de la sortie à Abidjan, aux questions que ça suscite sur le travail de mémoire, de reconstruction d’un pays.
- On peut imaginer que vous avez vécu la sortie en France, qui a été modeste, de manière différente ?
La sortie en France a été différente mais je m’y attendais. J’ai pas mal travaillé en tant qu’assistant de production, avec ATRIA où j’ai même côtoyé Abderrahamane Sissako, et je pense qu’en France on n’est pas prêts à ce que deux films africains, ou dits africains, sortent en même temps. C’est trop. On a besoin d’un regard par an, d’un roi du cinéma africain. Ça a été Souleymane Cissé, après Idrissa Ouédraogo. Ça change chaque fois et c’est une vision un peu binaire.
Moi, je trouve cette sortie, qui suit celle de Timbuktu de Abderahamane Sissako, très positive parce que les films sont différents. C’est mon premier film, alors que Sissako en est à son cinquième. Quand il a sorti La Vie sur terre, en 2000, il n’y avait pas beaucoup de spectateurs. Donc c’est quelque chose qui se fabrique, se travaille. J’espère que la visibilité au Festival de Cannes, cette sortie en salles, cet écho aussi sur le continent africain, tout cela va faire que pour le prochain film, il y aura plus de spectateurs.
- Vous parlez de la visibilité à Cannes, que vous a-t-elle apporté ?
Le fait que le film a été repris dans beaucoup de festivals, à Toronto, Los Angeles… Elle a permis à beaucoup de gens de le voir, de faire beaucoup d’interviews. La Côte d’Ivoire a pu ainsi se repositionner sur le cinéma africain ou international. Ça a permis qu’on connaisse mon nom tout simplement. Je travaillais avant mais cette visibilité fait que, tout d’un coup, on se dit qu’il y a un réalisateur qui rentre dans l’arène, si j’ose dire, et qu’on va voir ce qu’il va faire après.
- Vous n’auriez pas pu profiter de cet effet de Cannes pour distribuer le film plus tôt, en France ?
Ce sont des problèmes de stratégie. On avait prévu de sortir le film en novembre. Je ne sais pas si c’était une meilleure date. Je pense que les distributeurs ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour trouver l’espace. Ce qui m’a manqué le plus, c’est la ligne sur laquelle on devait aller chercher les spectateurs. Aussi bien pour la structure de production Banshee Films en France, que pour moi en tant que réalisateur, c’est le premier film qui sort et c’est une expérience. On va en tirer des leçons, on va avancer. Je sais que c’est un film qui sera vu, au final, mais je ne sais pas si c’est un film uniquement de salles. C’est un film de festivals, pour quelques salles avec des avant-premières et le réalisateur présent. Pour ce genre de films qui sont dans une écriture assez particulière, s’ils ne sont pas suivis par les médias qui déclenchent les cinéphiles, c’est difficile.
- Quelle image donnez vous à Run pour que les gens aillent le voir ?
Justement, l’image a été un peu difficile à trouver. Finalement je pense qu’il n’y en a pas vraiment parce que c’est un film qui trimbale avec lui beaucoup de choses, qui va puiser dans le réel, dans l’histoire politique. Pour moi, c’est une tentative de cinéma. À Cannes, des journalistes ont dit : « Run, c’est un jeune Africain qui s’invente sur l’écran ». Je crois que c’est ça, et il y a une écriture de cinéma qui est proposée. Bien sûr, elle n’est pas parfaite. C’est une écriture faite de heurts, de chocs, de cassures, qui mélange des genres. Elle est hyper narrative comme ça. C’est ça que j’ai envie de défendre.
Produire Run comme un film d’auteur
- Le projet est il né au départ, avec l’envie de mélanger les écritures ?
Le projet a toujours été comme ça. Mes autres films aussi. Dans mon documentaire, Chroniques de guerre en Côte d’Ivoire, il y a déjà trois parties. Dans mes fictions, ce sont des choses qu’on retrouve aussi, avec des personnages qui courent, qui inventent leur présent. L’enjeu a été de traduire cette histoire en scénario, susceptible d’aller convaincre Arte, l’Avance sur recettes. C’était comme ça, et ça n’a pas été inventé au montage.
- Comment avez vous convaincu les financiers qui vous ont aidé ?
Il y avait des réticences. C’est normal, c’est un premier film. On trouvait qu’il y avait trop de flashbacks, que le récit pouvait partir dans tous les sens. A partir du moment où le présent du film fait 20 minutes et le passé 1h20, il faut qu’on aborde ça autrement. On n’est plus dans la notion de flashbacks mais dans une succession de temps, présent, ancien, futur. Il y a des prémonitions aussi. C’est comme ça qu’on l’a expliqué. Et le fait que ça puisse partir dans tous les sens, c’est mon écriture. Je travaille avec ce que je suis, un raconteur d’histoires. J’aime le cinéma, je vais puiser dans des histoires des autres, dans des genres différents. Comme le fait Sergio Leone par exemple.
- Comment avez vous pu monter concrètement, la production ?
On l’a monté entre la Côte d’Ivoire et la France : Wassakara Productions avec Ernest Konan, le producteur ivoirien, et Claire Gadéa, la productrice française sur Banshee Films même si je suis impliqué. Au départ, on est allé chercher de l’argent vers le Sud et en même temps, dans le système français. A un moment, une chaîne, Arte, nous a suivis, et sur l’Afrique, Canal Afrique. Après comme partenaire important, il y a la Francophonie (l’OIF), qui nous a suivis sur le Sud et l’UE-ACP, le Groupe des Etats ACP, puis sur le Nord, l’Avance sur recettes. Voilà comment on a monté le projet, avec un Prix du scénario à Jérusalem qui est entré en production.
- Cela fait un gros budget ?
Non. C’est 1,5 million d’euros. C’est un gros budget pour la Côte d’Ivoire parce qu’il n’y a pas beaucoup de films qui se font aujourd’hui et peu de réalisateurs arrivent à ramener ces sommes là. C’est un petit budget pour la France. Je dirai que ça m’a permis de travailler correctement. Pour la prochaine fois, je ne recherche pas plus. Je cherche à rendre ce budget plus efficace, à connaître bien cette taille. Je la trouve juste pour moi, et je vais retravailler dans un dispositif proche.
- Avez-vous la même implication dans les deux structures de production, en Côte d’Ivoire et en France ?
En Côte d’Ivoire, je suis impliqué parce qu’il n’y a pas de structure. On est un collectif avec les acteurs du film, le producteur. Le collectif a tout mis en place. En France, c’est Claire Gadéa qui a produit le film. On a aussi travaillé avec Isabelle Fauvel qui s’est occupée du développent. Je suis impliqué parce que je pense que c’est bien, quand l’économique est au service de l’artistique pour des films comme ça. Ils ne font pas des millions de recettes. L’objectif c’est d’arriver à un objet qu’on défend. Par exemple, il y a des effets spéciaux dans le film et on a eu l’aide des nouvelles technologies CNC. Pour moi, ils étaient très importants. Donc on mène des discussions à cheval entre l’artistique et l’économique.
Run pour réveiller le cinéma en Côte d’Ivoire
- Pourquoi avant Run, avez-vous produit les films des autres ?
J’ai un parcours de réalisateur et de producteur. J’ai commencé à faire mes courts-métrages en 1993, en France. Ils étaient en noir et blanc, très expressionnistes, en 35mm. Après il fallait bien survivre et je n’avais pas envie d’être assistant réalisateur. Je suis allé travailler en tant qu’assistant producteur. Là j’ai côtoyé des producteurs comme Jacques Bidou, j’ai travaillé avec Andrée Daventure dans le cinéma africain, et avec d’autres producteurs. J’ai côtoyé Humbert Balsan même si je n’ai pas travaillé avec lui. La production m’a toujours intéressé. C’est pour ça qu’avec Claire Gadéa, on a fabriqué un tandem pour Banshee Films. Je me considère plus comme un producteur artistique. Sur les projets que je produits, mon action, c’est plus l’accompagnement en écriture, repérer les réalisateurs.
- Les réalisateurs de documentaires africains que vous avez produits ne viennent pas de la Côte d’Ivoire, pourquoi ?
Ça a été plus facile de les produire sur la structure ivoirienne, Wassakara Productions. C’est vrai que Run est le premier long-métrage de la structure française, Banshee Films, avec un budget plus important. Le djassa a pris feu, tourné à Abidjan, l’a été avec 10 000 euros. C’était une fiction très Nouvelle Vague, filmée en 11 jours. Boul Fallé de Rama Thiaw, tourné au Sénégal, un film sur la lutte, n’a pas couté un énorme budget. Aujourd’hui, c’est peut-être plus facile de déclencher des choses dans l’urgence, plus nécessaires, du côté du Sud. La Côte d’Ivoire est vraiment le terrain où j’ai envie de raconter mes prochaines histoires et continuer à produire des jeunes documentaristes.
- Vous y trouvez la situation favorable pour des projets de cinéma ?
Il y a maintenant une Commission. Il y avait la décision de l’ancien président Laurent Gbagbo de créer une Commission de cinéma. Elle a été mise en place par le nouveau pouvoir. Elle fonctionne. Run a été le premier film à en bénéficier, grâce à une avance sur recettes de 150 000 euros. Deux réalisateurs ivoiriens, Jacques Trabi et Owell Brown, ont aussi bénéficié de cette aide. On n’a jamais eu une configuration aussi précise. Il y a déjà eu de l’argent mais jamais une Commission.
Pour 2015, le montant du fond a été doublé parce qu’il y a eu des résultats. C’est une bonne chose. Après, il y a encore des choses sur lesquelles il faut progresser. La Côte d’Ivoire reste un pays fragile. Personne ne peut dire où on va. Un pays, ça se construit. Si on veut faire des films, si on veut que la Côte d’Ivoire revienne à un niveau de cinématographie qu’elle avait, il faut y aller. Il y a des jeunes qui ont des projets de documentaires, de courts-métrages. Il s’agit avec le peu d’expérience en plus qu’on a, de les accompagner, de partager ça.
- Les spectateurs sont-ils prêts à venir, ou à revenir, dans les salles en Côte d’Ivoire ?
Les Ivoiriens sont très intéressés par le cinéma, ou alors ils sont très nostalgiques des années 80 où il y avait 50 salles de cinéma. C’est à partir du coup d’Etat de 1999, par le Général Robert Guéï, que les salles ont été vidées, complètement désertées. Au Nigéria, ça a été pareil. On voit que la raison sécuritaire est très forte. Les Ivoiriens sont de grands amateurs de cinéma. Quand on tourne dans la rue, ils viennent nous voir, nous féliciter. Mais c’est une pratique qui a disparu. Pour un film comme Run, on réussit à mobiliser les gens en salles, mais pas sur du long terme. Il faut recréer des événements à chaque fois. C’est pour ça qu’en mars 2015, on va recréer un événement avec le cinquantenaire du cinéma et l’ouverture de l’Institut français. C’est progressif.
Run pour télescoper les sensations
- Les spectateurs ivoiriens vous ont suivi comme vous le pensiez ?
Je pensais qu’ils allaient être intéressés par le film et ça a été le cas. Il y a eu beaucoup de questions autour du travail de mémoire, de reconstruction. J’ai été surpris sur certains points comme par exemple, la nudité. Dans le film, il y a une scène où l’acteur principal est nu, ça a choqué. Et puis il y a le coté politique. Quand je montre les Jeunes Patriotes, même ceux qui ne sont pas politiquement impliqués, se demandaient pourquoi on parlait de ça, pourquoi on allait aussi loin dans le sujet. Il y avait une sorte de silence dans la salle, comme si personne ne voulait être associé à ça. Ça a réveillé des questions sur la mémoire. Maintenant le film va tourner dans différentes villes, je vais l’accompagner, on va voir les réactions. Mais les Ivoiriens sont fiers de l’aspect technique du film, la lumière, la caméra. C’est dans ce sens qu’il faut qu’on aille.
- La narration que vous avez voulue éclatée, ne déconcerte pas les gens ?
Non. J’avais peur de ça parce que c’est une narration qui est peut-être celle de cinéphiles ou de gens qui jouent avec le langage cinématographique. Là ça n’a pas choqué parce que, en même temps, c’est assez narratif. Il y a toujours un fil, la voix off qui amène. Cette narration déconstruite, je dirais que c’est plus en France qu’elle choque. Aujourd’hui, être linéaire au cinéma, c’est une position idéologique. Ça veut dire qu’on croit à une chronologie, à une avancée du temps. Ça veut dire qu’on pense que demain sera meilleur qu’aujourd’hui, et qu’on tire des leçons des choses. C’est complètement faux, ce n’est pas ma perception ni du temps, ni des formes, ni ma pensée philosophique.
- Ça veut dire que vous vous mettez en rupture par rapport à l’esprit occidental, plus cartésien, qui a une vision progressiste de la société ?
Tout à fait. Je me place avec des personnages, et mon objectif est toujours de raconter ce qu’il y a dans leur tête. Je me place avec eux dans des situations de chaos, de présent très fort, qui vont créer des ruptures chez les personnages. Ils sont toujours dans un grand questionnement identitaire et se demandent si ce qu’ils ont fait hier, avant-hier, était bien… Ça construit complètement leur présent, ça le contamine, ça le dynamise. Donc ils sont dans des allers-retours. Un personnage comme Run dit : « Voici ce que j’ai fait ». Ça représente 20% du film et il est en train de dire : « Mais pourquoi je n’ai pas fait ça, pourquoi je n’ai pas fait cela… » Pour moi, ce temps là est beaucoup plus juste sur la nature humaine, les expériences qu’on tire. Les flashbacks ne sont pas formels. Tout être humain qui marche dans la rue, fait des flashbacks dans sa tête. C’est une dynamique de pensée. Cette superposition de temps m’intéresse. C’est ma culture, toutes mes cultures en tous cas. Et c’est en même temps, ce temps de cinéma, ce temps réel, ce temps mystique. Dans ces trois temps, aujourd’hui en Côte d’Ivoire, la frontière entre le visible et l’invisible, entre le monde onirique et le monde réel est très mince. Dans le film, j’ai joué avec tous ces éléments. On peut parler des Jeunes Patriotes, on peut filmer caméra à l’épaule dans les rues de Yopougon, et le jeune Run qui est là, peut y être parce que, un jour, à dix ans, sur une colline, son maître lui a fait une prédiction. Tout ça, c’est l’Afrique aujourd’hui. En tous cas, c’est la Côte d’Ivoire. La part de mystique est très importante dans la politique. Le conflit qu’on a vécu est très réel. Tous ces matériaux très cinématographiques m’accompagnent depuis un moment. J’ai envie de continuer avec ça, de les préciser. C’est une vision.
- Pourquoi cette vision finit au moment où le film commence ?
Parce que j’aime bien travailler sur les boucles. L’idéal pour moi, serait que le film passe sans s’arrêter… Ce qui était important, ce n’était pas le geste de Run, dire : « Je tire, j’ai tué le premier ministre », c’était à partir de ce geste, de reconstruire tout le parcours de ce jeune homme, et l’histoire de la Côte d’Ivoire. J’avais envie de cet impact pour qu’on s’intéresse à ce jeune, qu’il traverse toute son histoire et qu’on le retrouve au même endroit comme si nous, on avait évolué avec lui. J’aime bien quand les personnages s’inventent sur l’écran avec nous. La plupart de mes personnages n’ont pas de nom. Ils se font baptiser sur l’écran. J’aime quand les personnages se fabriquent à l’instant présent et que le spectateur participe à ça. J’avais envie qu’on retrouve Run dans cette cathédrale, dans la même séquence que la première, là où il a tiré. Mais là, Run n’est plus un jeune homme qu’on ne connaît pas, transformé en fou qui tire. Run est un jeune homme dont on a suivi l’enfance, l’adolescence, les relations avec le premier ministre sur qui il va tirer, dont on a suivi tous les tremblements, et donc on le revoit autrement.
- Ça voudrait dire aussi que l’histoire est cyclique ?
L’histoire de la Côte d’Ivoire a quelque chose à voir avec un cercle, un cycle. Mon propos était de poser la question aux Ivoiriens, de savoir comment on avait basculé dans la violence. Est-ce que cette violence n’était pas là avant ? N’était-elle pas inscrite dans les années Houphouët-Boigny quand on disait que tout allait bien ? Nous, on était enfants mais on savait bien que tout n’allait pas bien puisque nos parents étaient en prison. Donc la violence était déjà là et elle a pris d’autres formes. Si l’on veut penser les choses pour le futur en Côte d’Ivoire, il faut questionner toutes les violences successives qu’il y a eu. L’idée n’est pas d’accuser un camp ou l’autre, ce n’est pas mon rôle en tous cas. L’histoire de ce film, c’est l’histoire d’un jeune homme qui refuse la violence, qui va fuir sa vie pour ça, et qui, à la fin, va commettre cet acte de violence… En terme d’écriture, on part de quelque chose de très classique, de très harmonieux avec des travellings, avec de la nature, des montagnes, et on arrive, en passant par le personnage de Gladys la mangeuse, à quelque chose de très déstructuré avec une caméra à l’épaule. Je voulais aussi à travers la forme, dire cette histoire de la Côte d’Ivoire.
Run pour dépasser les genres
- Vous allez poursuivre ce souci de la forme dans un prochain projet ?
Oui, je travaille sur un nouveau projet qui va être encore fait de flashbacks, et va se tourner en Côte d’Ivoire. A la prison d’Abidjan, il y a une pratique qui fait que les prisonniers choisissent l’un d’entre eux et l’appellent Roman. Ça désigne celui qui est chargé toutes les nuits, de raconter une histoire aux autres, jusqu’au matin. Je vais raconter l’histoire de cet homme, quelqu’un qui n’a toujours pas de nom. Il va raconter des histoires avec des flashbacks, dont le récit d’un naufrage, qui est une histoire de Edgar Allan Poe.
- Allez-vous monter la production de la même manière que pour Run ?
On espère le faire parce que ça a bien fonctionné, avec un partenaire ivoirien qui est celui qui gère le terrain, des appels vers des fonds du Sud, et avec une structure de France, Banshee Films, qui va rechercher une chaîne, l’Avance sur recettes. C’est un projet qui est ouvert et va peut-être faire rentrer un partenaire plus costaud, plus expérimenté. Pour l’instant, je suis en écriture et les ingrédients sont les même, avec de la magie, de l’onirisme encore mais tout ça tiré dans du réel. Ca sera aussi un portrait de l’après guerre en Côte d’Ivoire. Il y aura des personnages fracassés, à qui il manque des choses, qui ont perdu des gens, et qui sont là en train d’essayer de s’associer pour se ressouder.
- Vous avez besoin de concevoir les choses seul ou en collectif ?
Je travaille avec des collaborateurs qui sont là depuis longtemps, un mixeur comme Emmanuel Croset que je connais depuis 15 ans, Delphine Jaquet, ma collaboratrice artistique, Claire Gadéa qui a produit mes courts-métrages. Dans mon prochain film, il y aura les acteurs que vous avez vus dans Run : Isaach de Bankolé, Abdoul Karim Konaté. Après, j’ai ma vision des choses que je n’explique pas forcément. Dans le domaine artistique, je ne crois pas à un compromis de tout le monde. Il y a des choses que je défends et je vais chercher les arguments. Par exemple, l’Avance sur recettes, on ne l’a pas eu du premier coup. Je comprends que cet univers ne passe pas toujours. Donc on va chercher les arguments, on essaie de convaincre. Si vous lisez un écrivain comme Gabriel Garcia Marquez, vous voyez qu’on n’a rien inventé, c’est juste une sensibilité.
- Pourquoi faites vous référence à un écrivain plutôt qu’à un cinéaste ?
Parce que ce réalisme magique, comme on l’appelle, c’est une culture. Je fais référence à deux personnes qui ne sont pas cinéastes. D’abord il y a Gabriel Garcia Marquez pour le picaresque, pour le fantastique. Ca peut se côtoyer pour dire des choses, en tous cas dans certaines cultures. Et je fais appel à John Coltrane pour le rythme, le souffle. Quand je regarde ce que j’ai fait, si je ne suis pas bien callé dans le siège au début, si je ne rentre pas bien dedans, même moi, je rate le film. Donc c’est un souffle, c’est un beat avec des breaks, des ruptures, des sons qui sont au même niveau que les dialogues, des choses relais, des tentatives dans d’autres genres, des allers-retours. C’est quelque chose que je vais chercher chez quelqu’un comme John Coltrane qui travaillait aussi ces formes cycliques.
- Vous êtes satisfait du résultat final ?
J’ai coupé quatre minutes après Cannes, parce qu’on avait fini le film juste trois jours avant. Aujourd’hui, sur la forme, je suis satisfait à 95%. C’est ce que je voulais faire. En fait, j’aime bien circuler dans le cinéma et je ne crois pas à la synthèse. Je ne crois pas au réalisateur qui pense tout chez lui, qui sort et met la ligne pure sur l’écran. Moi je mets ce qui me traverse et ce qui bouillonne. Je le mets comme ça parce que je pense que l’échange avec le spectateur, c’est un échange au présent. C’est un échange dans la complexité, pas dans la synthèse. Si je veux qu’on débatte, et si j’ai déjà tout synthétisé, on ne va pas débattre. Ma matière peut paraître brouillonne, impulsive, mais c’est un respect pour le spectateur.
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
(Africiné / Paris)
pour Images Francophones
Suivre l'actualité du film
www.facebook.com/events/898231236861931
À lire
* Run, Course à la liberté en Côte d’Ivoire, par Michel Aamrger (Africiné)
* "J'aime quand le merveilleux vient éclairer le réel", entretien d'Olivier Barlet avec Philippe Lacôte et Isaac de Bankolé à propos de Run (Africultures)
* Run, de Philippe Lacôte, de Hassouna Mansouri (Africiné), lors de la présentation à Cannes.
Photo : Scène du film Run de Philippe Lacôte
Crédit : Banshee Films / Wassakara Productions / Diam Production
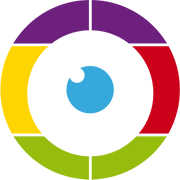 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images