Festival Black Movie à Genève

Jeux de pouvoirs africains en Suisse. Avec Rama Thiaw, Samantha Biffot, Ala Eddine Slim, Ousmane Samassékou, Johnathan Littell et Malek Bensmaïl.
La 18ème édition de Black Movie - Festival International du Film Indépendant, qui a lieu à Genève, du 20 au 29 janvier 2017, relève avec pertinence les mouvements de pouvoirs qui animent et résonnent sur le continent africain. De nouveaux films s'y discutent avec leurs auteurs.
Annoncé par une affiche sombre où se dévoilent des palmiers mystérieux, Black Movie balaie comme à l'accoutumée, une large gamme de films venus d'Asie, d'Amérique Latine, d'Europe avec une attention particulière, depuis sa création, pour l'Afrique et ses images. La compétition et les diverses sections proposent 48 longs-métrages et 68 courts, représentant 40 pays, pour échanger, en présence d'une vingtaine de réalisateurs invités dont certains viennent directement d'Afrique pour commenter leur travail. On relève 71 premières suisses dont 3 européennes, présentées dans 5 salles de Genève, où figurent les nouveaux films de Kim-Ki-duk, Amat Escalante, Joseph Israel Laban. Ils sont répartis dans 6 sections thématiques dont "Post-Millennials", "Sexualités, etc", "Cinéma et plus si entente". A côté du Prix du Public, celui de la Presse et des Jeunes, complètent les distinctions du Petit Black Movie, section attachée aux animations et films pour enfants. Les adultes se réservent pour les fameuses Nuits Blanches musicales, titrées Blackingrad, mais aussi des ciné concerts et autres découvertes.
En parallèle des projections, on note une session IFFR LIVE, organisée en partenariat avec le Festival du Film de Rotterdam, où Mister Universo de Tizza Covi et Rainer Frimmel, 2016, est projeté simultanément dans 45 salles européennes. Une table ronde avec le Mapping Festival, s'articule autour de Lo and Behold : Reveries of a Connected World de Werner Herzog, 2016. Et il y a un point rencontre sur le Ciné Guimbi de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, qui inaugure sa première salle en juin 2017. Parmi les programmes, ce sont les mouvements autour du pouvoir, les corruptions galopantes, l'émigration mal encadrée, qui caractérisent les films traitant du continent africain. On les remarque dans la section " Black Power ? ", en lien avec la section " Abus de pouvoirs ". Ce sont pour la plupart, des films issus de la nouvelle génération, des premières oeuvres documentaires avec un regard neuf, mordant, qui témoignent de l'effervescence de la jeunesse en Afrique.
Cadrer les contestations
La réalisatrice Rama Thiaw, venue du Sénégal, s'enflamme pour la contestation pacifique menée contre la ré-investiture présidentielle de Abdoulaye Wade, en 2012, avec The Revolution won't be televised, 2015. Pendant plus d'un an, la caméra colle aux positions tumultueuses des membres du groupe de rap, les Keur Gui, Thiat et Kilifeu, devenus leaders du fameux collectif Y'en a marre qui se mobilise lorsque le Conseil constitutionnel du Sénégal permet une nouvelle candidature du président sortant. Proche des rappeurs contestataires, présente lors des échauffourées avec les forces de l'ordre, la caméra capte le ras-le-bol des jeunes et les crispations du pouvoir.
Puis lorsque les élections sont passées au profit de Macky Sall, les rappeurs doivent trouver un autre mode de positionnement pour continuer leur musique et leur action contestataire. On suit alors Thiat et Kilifeu en studio, sur scène, pour des morceaux qui visent à dépasser l'amertume envers le pouvoir, en encourageant les jeunes. C'est cette constance que souligne Rama Thiaw dans ce deuxième long-métrage documentaire après Boul Fallé, la voie de la lutte, 2009. La réalisatrice née en Mauritanie, se place sous le parrainage de la cinéaste et auteure disparue, Khady Sylla, qui lit un de ses textes virulents à l'écran. Rama Thiaw a pu trouver des aides occidentales comme celle de l'OIF mais a dû recourir à une campagne de crowdfunding, d'avril à juillet 2013, pour arriver à boucler son budget en 2015, avant d'intéresser la 66ème Berlinale, où elle a reçu le Prix de la critique internationale.
L'idée d'évoquer des mouvements de masse en isolant des protagonistes privilégiés pour mieux captiver le spectateur, conduit Jonathan Littell à mettre en scène Wrong Elements, 2015. C'est une première pour cet auteur né aux Etats-Unis, naturalisé français en 2007, après avoir écrit Les Bienveillantes, roman couronné du Prix Goncourt, qui traite des massacres nazis et de la violence institutionnelle. Jonathan Littell, après des reportages en Tchétchénie, en RDC, au Sud Soudan et autres endroits chauds de la planète, s'oriente vers l'Ouganda pour signer son premier documentaire. Wrong Elements, produit en France, évoque le destin des enfants soldats à partir des confidences de deux garçons, Geoffrey et Mike, et deux filles, Nighty et Lapisa, issus des rangs de la Lord's Resistance Army, fondée par Joseph Kony au nord de l'Ouganda.
Forte de 60 000 enfants, raflés à leurs familles, cette force vengeresse a pu faire 100 000 victimes parmi les populations qu'elle était censée défendre contre le pouvoir en place, avant d'être dispersée en 2008. Jonathan Littell écoute les réactions des quatre ex soldats, les provoque en les accompagnant sur les lieux de l'ancien quartier général de la LRA, et mesure leur implication dans les massacres passés en leur projetant des images de Dominic Ongween, un officier supérieur de la LRA, transféré au Tribunal Pénal International de La Haye après s'être rendu aux autorités en pensant être amnistié. En combinant des images d'archives, des plans pris sur le vif dans la forêt, le discours de Wrong Elements s'articule en longs chapitres, ponctués par des cartons, comme pour mieux poser la question dérangeante de la responsabilité des enfants pris dans le tourbillon de la guerre, lorsqu'ils deviennent des adultes.
Cette question de l'engagement de la jeunesse se retrouve plein cadre dans le premier documentaire du Malien Ousmane Samassékou, Les Héritiers de la colline, 2016. Étudiant lui-même à l‘université de Bamako, située sur la " colline du savoir ", le réalisateur établit des ponts avec la " colline du pouvoir " qui lui fait face dans la capitale malienne, là où siègent les responsables politiques. Le cinéaste s'intéresse aux élections organisées chaque année par l'AEEM [Association des Élèves et Étudiants Maliens, Ndlr], de janvier à octobre, pour exposer le fonctionnement du syndicat étudiant unique.
Les témoignages laissent entendre que le syndicat rackette les élèves, use de corruption, intimidation et fraude pour remporter les élections. Les candidats les plus zélés sont appuyés par l'AEEM, incitant les autres à un retrait "démocratique", perpétuant les passe-droits et l'usage d'un pouvoir lucratif. Ousmane Samassékou filme sans recul leurs meetings, les assemblées, en tentant de restituer les traces d'un système qui filtre la jeunesse motivée au profit du pouvoir. L'appui d'une production française, du Fonds Hubert Bals, du Fonds Image de la Francophonie, lui permet de soulever les problèmes de l'éducation dans le Mali d'aujourd'hui.
Accompagner les migrations
Face à ces réalités que soulignent volontiers les nouveaux réalisateurs africains lorsqu'ils s'emparent des caméras numériques, la tentation de partir est forte. La question des migrations motive de nombreuses fictions récentes mais aussi des documentaires subjectifs, pris sur le terrain. C'est le cas avec Les Sauteurs, 2016, une production danoise, aidée par le Danish Film Institute, qui réunit un trio de réalisateurs éclectiques. Moritz Siebert, né en Allemagne, est l'auteur du documentaire Harvest Hands, 2013. A ses côtés, Estephan Wagner, originaire du Chili, est monteur en Allemagne. Ils se sont associés pour réaliser Les Sauteurs, en confiant la caméra à Abou Bakar Sidibé, un professeur malien, né en 1985, tenté par l'émigration clandestine vers l'Espagne.
Basé sur le Mont Gurugu qui surplombe l'enclave espagnole de Melilla, au Maroc, le Malien tente plusieurs fois de franchir les barbelés pour accéder en terre d'Espagne où son frère l'a précédé. Caméra au poing, il filme le camp, l'attente, les tentatives de passage, livrant un regard de l'intérieur sur la vie d'une communauté de migrants. Le tournage lui permet de trouver une raison d'être, une motivation, entretenue par la confiance des réalisateurs européens qui le rétribuent pour éviter qu'il ne revende la caméra. Ils encadrent ses plans par des images de surveillance, prises à l'infrarouge, qui révèlent les colonies de migrants à l'assaut concerté des barbelés. Le regard individuel s'inscrit alors dans une perspective plus large qui caractérise un phénomène de société en extension.
Le documentaire parait ainsi le témoin des tentatives de l'exode vers l'Europe tandis que les cinéastes africains qui emploient la fiction sont sensibles aux aspects symboliques du voyage. Ainsi le Tunisien Ala Eddine Slim qui a participé avec Youssef Chebbi, au film collectif, Babylon, 2012, sur un camp de réfugiés, s'éloigne du réalisme pour traiter de l'émigration avec The Last of Us, 2015. On y suit les péripéties d'un jeune Subsaharien d'abord flanqué d'un compagnon, qui sort du désert pour transiter en camionnette. Détroussé, isolé, il fuit vers la côte et emprunte une barque pour prendre le large. Mais en sortant de l'eau, il accède à une forêt dense où un étrange individu, sauvage, le piège puis le rend sensible à la vie en pleine nature. Peu à peu, le migrant se fond dans l'environnement jusqu'à s'y confondre.
Cette évolution est comme magnifiée par des images poétiques des éléments, qui inscrivent l'homme dans un voyage initiatique, lyrique et mutique. Le plasticien Jawher Soudani s'y impose jusqu'à sa rencontre avec l'homme des bois, interprété par le célèbre acteur Fathi Akkari. Leur prestation est orchestrée avec soin par Alaeddine Slim, au rythme des paysages de Tunis, Zarzis, Ain Drahem, dans une expérience sensible qui parcourt le pays du nord au sud. Entrepris en toute indépendance par son auteur, The Last of Us vise à proposer une nouvelle expérience de cinéma contemplatif. Une fois engagée, la démarche a pu convaincre des fonds venus du Golfe et d'autres aides institutionnelles d'épauler la dérive symbolique et métaphysique de Ala Eddine Slim, au-delà de l'itinéraire d'un migrant.
Cette ouverture au panthéisme, à l'ailleurs, trouve un écho singulier dans L'Africain qui voulait voler de Samantha Biffot, 2016. Ce documentaire portrait s'attache au destin insolite de Luc Bendza, un Gabonais fan des arts martiaux et des films de genre, devenu professeur de Wushu et champion de cette discipline en Chine. On l'y retrouve adulte alors lorsqu'il confie ses souvenirs d'enfant, s'entraînant à 10 ans dans son quartier de Libreville avec ses copains, et affichant sa maîtrise technique en kimono dans un petit film amateur. Sa sœur et ses proches aujourd'hui, racontent son engagement fanatique, sa formation par les films de karaté de Bruce Lee et Jackie Chan, qui le poussent à partir à la conquête de la Chine dans l'espoir de voler comme il l'a vu faire au cinéma. Un traducteur chinois, en poste au Gabon, lui sert de relais et de caution tandis que ses amis restés au pays, évoquent son look de karatéka décalé pour les Africains.
Luc Bendza, installé et marié en Chine, retrace son parcours, son désir de pratiquer le Wushu jusqu'à susciter la jalousie des Chinois, intrigués par sa démarche et étonnés de ses connaissances si profondes de leur culture. En livrant ce portrait qui fait le pont entre deux espaces lointains, Samantha Biffot donne une vision tonique des migrations sans occulter les problèmes d'intégration ou d'acceptation dans le pays choisi. En accompagnant aussi les séjours de plus en plus fréquents de Luc Bendza au Gabon pour y transmettre son art, la réalisatrice souligne la force des liens avec son terroir. D'ailleurs cette Franco-Gabonaise qui a débuté comme assistante sur des productions françaises, s'est installée depuis 2010, à Libreville pour devenir monteuse et cogérer la société Princesse M Productions. Le projet de L'Africain qui voulait voler, développé dans une résidence Africadoc, est une coproduction entre le Gabon, avec le concours de Imunga Ivanga, la France, par la société Néon Rouge, et la Belgique via la RTBF. Il a reçu le soutien du Fonds francophone de production autour du Sud (OIF / CIRTEF), signalant la vitalité des jeunes cinéastes gabonais engagés dans le croisement des cultures.
Exploiter des relations
Au-delà des parcours individuels, ce sont pourtant bien les évolutions des conditions de vie en Afrique qui fixent les cinéastes du continent. La question de l'influence du pouvoir, soulignée par les sections de Black Movie, livre des regards pénétrants sur des sociétés en crise, larvée ou déclarée. L'attachement au pays malgré les difficultés d'y résider et de s'y épanouir, est souvent un axe central du traitement des réalisateurs d'Afrique. Mohamed Ouzine le souligne dans le contexte algérien avec Samir dans la poussière, 2015, en recueillant les impressions de son neveu. Celui-ci vit de la contrebande de pétrole en transportant sa marchandise sur le dos d'un mulet, de son village d'Algérie à la frontière du Maroc. C'est une région aride où la vie difficile de Samir semble contenue et limitée. Mohamed Ouzine la porte à l'écran en valorisant la beauté du paysage rural alors que Samir n'y voit que du sable et des pierres.
Cette fascination pour la terre originelle révèle l'état d'un cinéaste décentré, installé en France où il développe son travail, tandis que son neveu paraît prisonnier du cadre qu'il ne sait remettre en question pour l'éviter, le dépasser ou l'améliorer. Le documentaire aborde alors en filigrane, la question de l'attachement aux traditions qui persistent et plombent souvent la société algérienne, comme la position de l'émigré et les rapports ambigus qui se nouent entre les espaces culturels. Samir dans la poussière est le premier long-métrage de Mohamed Ouzine, auteur de courts-métrages dont Lieux communs, 2007, participant au film collectif, Un jour en France. Il a bénéficié d'une production française modeste avec une télévision locale, TV Tours, l'Aide à l'écriture de la Région Centre, le CNC, la SACEM, ainsi que le concours du Doha Film Institute, souvent prêt à seconder l'émergence d'un documentaire sur l'identité arabe.
En complément, d'autres réalisateurs prennent plus de hauteur pour aborder les mécanismes de fonctionnement de leur société. C'est ce qui caractérise la démarche de l'Algérien Malek Bensmaïl depuis ses premiers documentaires, à partir de Territoires, 1996. Attaché aux événements de la politique algérienne avec Boudiaf, un espoir assassiné, 1999, le cinéaste approfondit avec Aliénations, 2004, qui examine les rapports des malades psychiatriques avec l'état du pays, dans un service hospitalier de Constantine. Il explore l'Histoire avec La Chine est encore loin, 2010, Guerres secrètes du FLN, 2012. Pour Contre-Pouvoirs, 2015, Malek Bensmaïl s'immerge dans la rédaction du journal francophone El Watan, alors que le président Bouteflika broque un quatrième mandat. Le film s'attache alors à quelques figures clés de la rédaction pendant que la construction d'un nouveau siège pour le journal, se poursuit sur les hauteurs d'Alger. Le regard s'articule autour du directeur de publication, Omar Beluchet. Résistant aux menaces de mort, aux attentats, ce dernier a modernisé le journal en introduisant la couleur mais aussi en autonomisant l'impression, la diffusion et les recettes.
En s'affranchissant ainsi d'un pouvoir que les journalistes bousculent parfois dans leurs pages, le quotidien entend " préserver la liberté d'informer dans un pays politiquement et socialement sclérosé ", selon le réalisateur. Ce dernier s'intéresse alors plus aux échanges d'idées et de positions entre les journalistes qu'à montrer le fonctionnement du journal et ses réunions éditoriales. L'enjeu de Contre-pouvoirs est de saisir dans les forces et les réflexions qui s'opposent et se conjuguent, l'émergence d'un véritable creuset où la conscience politique se forge et se renforce pour faire réfléchir les citoyens. Cet élan est favorisé par l'engagement d'une société de production algérienne, Hikayet Films, et l'apport de nombreux contributeurs qui ont appuyé le propos de Malek Bensmaïl. Car malgré sa notoriété en France où il est établi, et les distinctions reçues dans nombre de festivals pour ses documentaires, aucune télévision française n'a voulu s'intéresser à Contre-Pouvoirs pour le diffuser. Sa présence dans les programmes de Black Movie 2017, à Genève, motive pourtant une rencontre débat animée sur les " contre-pouvoirs " qui s'expriment parfois par la presse mais aussi par le cinéma.
Il est vrai que les films critiques sont plus appréciés dans les salles ou dans les festivals propices aux échanges comme Black Movie. En mettant sur la table les dérives, les excès, les maux mais aussi les luttes qui s'impriment dans les sociétés africaines actuelles, la 18ème édition suscite des débats opportuns, imprégnés de la noirceur du temps. La présence des réalisateurs d'Afrique, venus accompagner leurs premiers films à Genève, est un signe de l'engagement multiple que suscitent les productions récentes, attachées au continent noir et à ses sombres jeux de pouvoirs.
par Michel AMARGER
(Africiné / Paris)
pour Images Francophones
en collaboration avec Africultures
Image : The Revolution won't be televised
Crédit : Boul Fallé Images (BFI)
Annoncé par une affiche sombre où se dévoilent des palmiers mystérieux, Black Movie balaie comme à l'accoutumée, une large gamme de films venus d'Asie, d'Amérique Latine, d'Europe avec une attention particulière, depuis sa création, pour l'Afrique et ses images. La compétition et les diverses sections proposent 48 longs-métrages et 68 courts, représentant 40 pays, pour échanger, en présence d'une vingtaine de réalisateurs invités dont certains viennent directement d'Afrique pour commenter leur travail. On relève 71 premières suisses dont 3 européennes, présentées dans 5 salles de Genève, où figurent les nouveaux films de Kim-Ki-duk, Amat Escalante, Joseph Israel Laban. Ils sont répartis dans 6 sections thématiques dont "Post-Millennials", "Sexualités, etc", "Cinéma et plus si entente". A côté du Prix du Public, celui de la Presse et des Jeunes, complètent les distinctions du Petit Black Movie, section attachée aux animations et films pour enfants. Les adultes se réservent pour les fameuses Nuits Blanches musicales, titrées Blackingrad, mais aussi des ciné concerts et autres découvertes.
En parallèle des projections, on note une session IFFR LIVE, organisée en partenariat avec le Festival du Film de Rotterdam, où Mister Universo de Tizza Covi et Rainer Frimmel, 2016, est projeté simultanément dans 45 salles européennes. Une table ronde avec le Mapping Festival, s'articule autour de Lo and Behold : Reveries of a Connected World de Werner Herzog, 2016. Et il y a un point rencontre sur le Ciné Guimbi de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, qui inaugure sa première salle en juin 2017. Parmi les programmes, ce sont les mouvements autour du pouvoir, les corruptions galopantes, l'émigration mal encadrée, qui caractérisent les films traitant du continent africain. On les remarque dans la section " Black Power ? ", en lien avec la section " Abus de pouvoirs ". Ce sont pour la plupart, des films issus de la nouvelle génération, des premières oeuvres documentaires avec un regard neuf, mordant, qui témoignent de l'effervescence de la jeunesse en Afrique.
Cadrer les contestations
La réalisatrice Rama Thiaw, venue du Sénégal, s'enflamme pour la contestation pacifique menée contre la ré-investiture présidentielle de Abdoulaye Wade, en 2012, avec The Revolution won't be televised, 2015. Pendant plus d'un an, la caméra colle aux positions tumultueuses des membres du groupe de rap, les Keur Gui, Thiat et Kilifeu, devenus leaders du fameux collectif Y'en a marre qui se mobilise lorsque le Conseil constitutionnel du Sénégal permet une nouvelle candidature du président sortant. Proche des rappeurs contestataires, présente lors des échauffourées avec les forces de l'ordre, la caméra capte le ras-le-bol des jeunes et les crispations du pouvoir.
Puis lorsque les élections sont passées au profit de Macky Sall, les rappeurs doivent trouver un autre mode de positionnement pour continuer leur musique et leur action contestataire. On suit alors Thiat et Kilifeu en studio, sur scène, pour des morceaux qui visent à dépasser l'amertume envers le pouvoir, en encourageant les jeunes. C'est cette constance que souligne Rama Thiaw dans ce deuxième long-métrage documentaire après Boul Fallé, la voie de la lutte, 2009. La réalisatrice née en Mauritanie, se place sous le parrainage de la cinéaste et auteure disparue, Khady Sylla, qui lit un de ses textes virulents à l'écran. Rama Thiaw a pu trouver des aides occidentales comme celle de l'OIF mais a dû recourir à une campagne de crowdfunding, d'avril à juillet 2013, pour arriver à boucler son budget en 2015, avant d'intéresser la 66ème Berlinale, où elle a reçu le Prix de la critique internationale.
L'idée d'évoquer des mouvements de masse en isolant des protagonistes privilégiés pour mieux captiver le spectateur, conduit Jonathan Littell à mettre en scène Wrong Elements, 2015. C'est une première pour cet auteur né aux Etats-Unis, naturalisé français en 2007, après avoir écrit Les Bienveillantes, roman couronné du Prix Goncourt, qui traite des massacres nazis et de la violence institutionnelle. Jonathan Littell, après des reportages en Tchétchénie, en RDC, au Sud Soudan et autres endroits chauds de la planète, s'oriente vers l'Ouganda pour signer son premier documentaire. Wrong Elements, produit en France, évoque le destin des enfants soldats à partir des confidences de deux garçons, Geoffrey et Mike, et deux filles, Nighty et Lapisa, issus des rangs de la Lord's Resistance Army, fondée par Joseph Kony au nord de l'Ouganda.
Forte de 60 000 enfants, raflés à leurs familles, cette force vengeresse a pu faire 100 000 victimes parmi les populations qu'elle était censée défendre contre le pouvoir en place, avant d'être dispersée en 2008. Jonathan Littell écoute les réactions des quatre ex soldats, les provoque en les accompagnant sur les lieux de l'ancien quartier général de la LRA, et mesure leur implication dans les massacres passés en leur projetant des images de Dominic Ongween, un officier supérieur de la LRA, transféré au Tribunal Pénal International de La Haye après s'être rendu aux autorités en pensant être amnistié. En combinant des images d'archives, des plans pris sur le vif dans la forêt, le discours de Wrong Elements s'articule en longs chapitres, ponctués par des cartons, comme pour mieux poser la question dérangeante de la responsabilité des enfants pris dans le tourbillon de la guerre, lorsqu'ils deviennent des adultes.
Cette question de l'engagement de la jeunesse se retrouve plein cadre dans le premier documentaire du Malien Ousmane Samassékou, Les Héritiers de la colline, 2016. Étudiant lui-même à l‘université de Bamako, située sur la " colline du savoir ", le réalisateur établit des ponts avec la " colline du pouvoir " qui lui fait face dans la capitale malienne, là où siègent les responsables politiques. Le cinéaste s'intéresse aux élections organisées chaque année par l'AEEM [Association des Élèves et Étudiants Maliens, Ndlr], de janvier à octobre, pour exposer le fonctionnement du syndicat étudiant unique.
Les témoignages laissent entendre que le syndicat rackette les élèves, use de corruption, intimidation et fraude pour remporter les élections. Les candidats les plus zélés sont appuyés par l'AEEM, incitant les autres à un retrait "démocratique", perpétuant les passe-droits et l'usage d'un pouvoir lucratif. Ousmane Samassékou filme sans recul leurs meetings, les assemblées, en tentant de restituer les traces d'un système qui filtre la jeunesse motivée au profit du pouvoir. L'appui d'une production française, du Fonds Hubert Bals, du Fonds Image de la Francophonie, lui permet de soulever les problèmes de l'éducation dans le Mali d'aujourd'hui.
Accompagner les migrations
Face à ces réalités que soulignent volontiers les nouveaux réalisateurs africains lorsqu'ils s'emparent des caméras numériques, la tentation de partir est forte. La question des migrations motive de nombreuses fictions récentes mais aussi des documentaires subjectifs, pris sur le terrain. C'est le cas avec Les Sauteurs, 2016, une production danoise, aidée par le Danish Film Institute, qui réunit un trio de réalisateurs éclectiques. Moritz Siebert, né en Allemagne, est l'auteur du documentaire Harvest Hands, 2013. A ses côtés, Estephan Wagner, originaire du Chili, est monteur en Allemagne. Ils se sont associés pour réaliser Les Sauteurs, en confiant la caméra à Abou Bakar Sidibé, un professeur malien, né en 1985, tenté par l'émigration clandestine vers l'Espagne.
Basé sur le Mont Gurugu qui surplombe l'enclave espagnole de Melilla, au Maroc, le Malien tente plusieurs fois de franchir les barbelés pour accéder en terre d'Espagne où son frère l'a précédé. Caméra au poing, il filme le camp, l'attente, les tentatives de passage, livrant un regard de l'intérieur sur la vie d'une communauté de migrants. Le tournage lui permet de trouver une raison d'être, une motivation, entretenue par la confiance des réalisateurs européens qui le rétribuent pour éviter qu'il ne revende la caméra. Ils encadrent ses plans par des images de surveillance, prises à l'infrarouge, qui révèlent les colonies de migrants à l'assaut concerté des barbelés. Le regard individuel s'inscrit alors dans une perspective plus large qui caractérise un phénomène de société en extension.
Le documentaire parait ainsi le témoin des tentatives de l'exode vers l'Europe tandis que les cinéastes africains qui emploient la fiction sont sensibles aux aspects symboliques du voyage. Ainsi le Tunisien Ala Eddine Slim qui a participé avec Youssef Chebbi, au film collectif, Babylon, 2012, sur un camp de réfugiés, s'éloigne du réalisme pour traiter de l'émigration avec The Last of Us, 2015. On y suit les péripéties d'un jeune Subsaharien d'abord flanqué d'un compagnon, qui sort du désert pour transiter en camionnette. Détroussé, isolé, il fuit vers la côte et emprunte une barque pour prendre le large. Mais en sortant de l'eau, il accède à une forêt dense où un étrange individu, sauvage, le piège puis le rend sensible à la vie en pleine nature. Peu à peu, le migrant se fond dans l'environnement jusqu'à s'y confondre.
Cette évolution est comme magnifiée par des images poétiques des éléments, qui inscrivent l'homme dans un voyage initiatique, lyrique et mutique. Le plasticien Jawher Soudani s'y impose jusqu'à sa rencontre avec l'homme des bois, interprété par le célèbre acteur Fathi Akkari. Leur prestation est orchestrée avec soin par Alaeddine Slim, au rythme des paysages de Tunis, Zarzis, Ain Drahem, dans une expérience sensible qui parcourt le pays du nord au sud. Entrepris en toute indépendance par son auteur, The Last of Us vise à proposer une nouvelle expérience de cinéma contemplatif. Une fois engagée, la démarche a pu convaincre des fonds venus du Golfe et d'autres aides institutionnelles d'épauler la dérive symbolique et métaphysique de Ala Eddine Slim, au-delà de l'itinéraire d'un migrant.
Cette ouverture au panthéisme, à l'ailleurs, trouve un écho singulier dans L'Africain qui voulait voler de Samantha Biffot, 2016. Ce documentaire portrait s'attache au destin insolite de Luc Bendza, un Gabonais fan des arts martiaux et des films de genre, devenu professeur de Wushu et champion de cette discipline en Chine. On l'y retrouve adulte alors lorsqu'il confie ses souvenirs d'enfant, s'entraînant à 10 ans dans son quartier de Libreville avec ses copains, et affichant sa maîtrise technique en kimono dans un petit film amateur. Sa sœur et ses proches aujourd'hui, racontent son engagement fanatique, sa formation par les films de karaté de Bruce Lee et Jackie Chan, qui le poussent à partir à la conquête de la Chine dans l'espoir de voler comme il l'a vu faire au cinéma. Un traducteur chinois, en poste au Gabon, lui sert de relais et de caution tandis que ses amis restés au pays, évoquent son look de karatéka décalé pour les Africains.
Luc Bendza, installé et marié en Chine, retrace son parcours, son désir de pratiquer le Wushu jusqu'à susciter la jalousie des Chinois, intrigués par sa démarche et étonnés de ses connaissances si profondes de leur culture. En livrant ce portrait qui fait le pont entre deux espaces lointains, Samantha Biffot donne une vision tonique des migrations sans occulter les problèmes d'intégration ou d'acceptation dans le pays choisi. En accompagnant aussi les séjours de plus en plus fréquents de Luc Bendza au Gabon pour y transmettre son art, la réalisatrice souligne la force des liens avec son terroir. D'ailleurs cette Franco-Gabonaise qui a débuté comme assistante sur des productions françaises, s'est installée depuis 2010, à Libreville pour devenir monteuse et cogérer la société Princesse M Productions. Le projet de L'Africain qui voulait voler, développé dans une résidence Africadoc, est une coproduction entre le Gabon, avec le concours de Imunga Ivanga, la France, par la société Néon Rouge, et la Belgique via la RTBF. Il a reçu le soutien du Fonds francophone de production autour du Sud (OIF / CIRTEF), signalant la vitalité des jeunes cinéastes gabonais engagés dans le croisement des cultures.
Exploiter des relations
Au-delà des parcours individuels, ce sont pourtant bien les évolutions des conditions de vie en Afrique qui fixent les cinéastes du continent. La question de l'influence du pouvoir, soulignée par les sections de Black Movie, livre des regards pénétrants sur des sociétés en crise, larvée ou déclarée. L'attachement au pays malgré les difficultés d'y résider et de s'y épanouir, est souvent un axe central du traitement des réalisateurs d'Afrique. Mohamed Ouzine le souligne dans le contexte algérien avec Samir dans la poussière, 2015, en recueillant les impressions de son neveu. Celui-ci vit de la contrebande de pétrole en transportant sa marchandise sur le dos d'un mulet, de son village d'Algérie à la frontière du Maroc. C'est une région aride où la vie difficile de Samir semble contenue et limitée. Mohamed Ouzine la porte à l'écran en valorisant la beauté du paysage rural alors que Samir n'y voit que du sable et des pierres.
Cette fascination pour la terre originelle révèle l'état d'un cinéaste décentré, installé en France où il développe son travail, tandis que son neveu paraît prisonnier du cadre qu'il ne sait remettre en question pour l'éviter, le dépasser ou l'améliorer. Le documentaire aborde alors en filigrane, la question de l'attachement aux traditions qui persistent et plombent souvent la société algérienne, comme la position de l'émigré et les rapports ambigus qui se nouent entre les espaces culturels. Samir dans la poussière est le premier long-métrage de Mohamed Ouzine, auteur de courts-métrages dont Lieux communs, 2007, participant au film collectif, Un jour en France. Il a bénéficié d'une production française modeste avec une télévision locale, TV Tours, l'Aide à l'écriture de la Région Centre, le CNC, la SACEM, ainsi que le concours du Doha Film Institute, souvent prêt à seconder l'émergence d'un documentaire sur l'identité arabe.
En complément, d'autres réalisateurs prennent plus de hauteur pour aborder les mécanismes de fonctionnement de leur société. C'est ce qui caractérise la démarche de l'Algérien Malek Bensmaïl depuis ses premiers documentaires, à partir de Territoires, 1996. Attaché aux événements de la politique algérienne avec Boudiaf, un espoir assassiné, 1999, le cinéaste approfondit avec Aliénations, 2004, qui examine les rapports des malades psychiatriques avec l'état du pays, dans un service hospitalier de Constantine. Il explore l'Histoire avec La Chine est encore loin, 2010, Guerres secrètes du FLN, 2012. Pour Contre-Pouvoirs, 2015, Malek Bensmaïl s'immerge dans la rédaction du journal francophone El Watan, alors que le président Bouteflika broque un quatrième mandat. Le film s'attache alors à quelques figures clés de la rédaction pendant que la construction d'un nouveau siège pour le journal, se poursuit sur les hauteurs d'Alger. Le regard s'articule autour du directeur de publication, Omar Beluchet. Résistant aux menaces de mort, aux attentats, ce dernier a modernisé le journal en introduisant la couleur mais aussi en autonomisant l'impression, la diffusion et les recettes.
En s'affranchissant ainsi d'un pouvoir que les journalistes bousculent parfois dans leurs pages, le quotidien entend " préserver la liberté d'informer dans un pays politiquement et socialement sclérosé ", selon le réalisateur. Ce dernier s'intéresse alors plus aux échanges d'idées et de positions entre les journalistes qu'à montrer le fonctionnement du journal et ses réunions éditoriales. L'enjeu de Contre-pouvoirs est de saisir dans les forces et les réflexions qui s'opposent et se conjuguent, l'émergence d'un véritable creuset où la conscience politique se forge et se renforce pour faire réfléchir les citoyens. Cet élan est favorisé par l'engagement d'une société de production algérienne, Hikayet Films, et l'apport de nombreux contributeurs qui ont appuyé le propos de Malek Bensmaïl. Car malgré sa notoriété en France où il est établi, et les distinctions reçues dans nombre de festivals pour ses documentaires, aucune télévision française n'a voulu s'intéresser à Contre-Pouvoirs pour le diffuser. Sa présence dans les programmes de Black Movie 2017, à Genève, motive pourtant une rencontre débat animée sur les " contre-pouvoirs " qui s'expriment parfois par la presse mais aussi par le cinéma.
Il est vrai que les films critiques sont plus appréciés dans les salles ou dans les festivals propices aux échanges comme Black Movie. En mettant sur la table les dérives, les excès, les maux mais aussi les luttes qui s'impriment dans les sociétés africaines actuelles, la 18ème édition suscite des débats opportuns, imprégnés de la noirceur du temps. La présence des réalisateurs d'Afrique, venus accompagner leurs premiers films à Genève, est un signe de l'engagement multiple que suscitent les productions récentes, attachées au continent noir et à ses sombres jeux de pouvoirs.
par Michel AMARGER
(Africiné / Paris)
pour Images Francophones
en collaboration avec Africultures
Image : The Revolution won't be televised
Crédit : Boul Fallé Images (BFI)
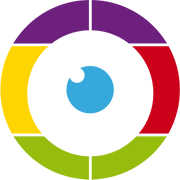 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images