Festival Black Movie à Genève, 16–25 janvier 2015

Pigments noirs à Black Movie. Avec Chika Anadu, Dieudo Hamadi, Egome Amah, Rehad Desai et Joris Lachaise.
La 16ème édition du Festival Black Movie 2015 qui s’est tenu du 16 au 25 janvier 2015, à Genève, en Suisse, rallume les feux des engagements africains. Au milieu d’une programmation internationale fournie, les regards portés sur l’Afrique embrasent les discussions.
Chaque année, à Genève, l’ambiance monte d’un cran pour le Festival Black Movie. On compte cette fois, 112 films, répartis en 10 sections qui font la part belle au cinéma d’auteur et aux genres. Le festival est une occasion unique de mesurer la vitalité des productions qui échappent au commerce et à la standardisation. Il y a 12 premières européennes, 51 premières suisses. 50 longs-métrages sont présentés. 22 réalisateurs sont invités pour débattre en public et partager les fêtes.
L’attention aux évolutions de l’Asie ne se dément pas avec la section « A mains nues » qui avance une rétrospective du Chinois Wang Bing, documentariste frondeur, qui filme depuis les années 2000, les oubliés de la Chine et de son orientation capitaliste. Il assure une master class à Genève, pour expliquer comment il développe un style naturaliste, dépouillé, en s’appuyant sur des financements indépendants.
La section « Sexties » rend hommage à l’Art Theater Guild, maison de production qui a contribué à la Nouvelle vague japonaise des années 60. De son côté, « Le Petit Black Movie », destiné aux enfants, fait découvrir 56 films, avec un focus sur le Brésil. D’autres sections thématiques, « La peur au ventre », « Pas à pas », « Matière grise », proposent de suivre les nouveaux élans des auteurs d’Asie, d’Amérique Latine avec quelques images fortes de l’Afrique.
Exemplaires, les animateurs du Ciné Guimbi viennent du Burkina Faso, exposer l’avancée des travaux de reconstruction de leur cinéma (à lire, l’article Projet "Il faut sauver le ciné Guimbi"). Cinq réalisateurs, interpellés par les réalités du continent, se trouvent en sélection. Ils sont mobilisés par Black Movie pour expliquer leur engagement dans la production de documentaires ou de fictions en Afrique. Leurs expériences contrastées permettent d’esquisser à Genève, quelques modes d’approches.
Survivre en collectif
Le documentaire reste le mode privilégié de résistance aux difficultés économiques qui touchent nombre de pays africains. Au Togo, Egome Amah cherche à élargir le cadre d’observation avec Les Hustlers, 2014, portrait de quatre pêcheurs amers d’un quartier de Lomé. Ils s’appellent Aaron, Léo, Zorro, Gombo, et vivent en marge du port, dans le bidonville de Katanga. Pêcheurs sans grand succès le matin, occupés de petits trafics de survie l’après-midi, ils s’évadent matin et soir en consommant la drogue, réunis par la misère et la survie sans cesse renouvelée. En les suivant sur trois ans, dans leurs embrouilles, leurs rêves, leurs familles dépendantes, Egome Amah capte leur humanité et leur sens de la dérision, eux qui se nomment « les Hustlers », les arnaqueurs, comme pour revendiquer leur place de parias.
Ce portrait de proximité s’appuie sur l’attitude patiente et le sens du rythme du cinéaste togolais. Il est réalisé dans le cadre de la collection Africadoc, Lumières d’Afrique, soutenue par l’Ecole documentaire de Lussas, en France. Egome Amah a pu bénéficier d’une résidence Africadoc à Niamey, au Niger, en 2010, pour étayer ses projets documentaires et s’engager dans la réalisation de Les Hustlers. Le film est coproduit par La Maison du directeur, en France, Merveilles Productions, et TVR Rennes 35 Bretagne. Il a pu ainsi avoir le soutien du Centre National du Cinéma français et la Procirep Angoa-Agicoa. Cette configuration lui permet d’être déposé au Club du Doc’, la vidéothèque permanente gérée par la Maison du documentaire en France. Les Hustlers est aussi disponible en dvd pour renforcer la circulation des images de Egome Amah. Sa sélection au Festival Black Movie 2015 de Genève est alors l’occasion d’aborder les problèmes liés à l’absence de politique véritable du cinéma, et de lieu de formation stable au Togo.
Organiser sa réussite
Le Congolais Dieudo Hamadi dénonce toujours avec fougue le manque d’éduction au cinéma dans son pays. Les mouvements sociaux congolais [manifestations pacifiques contre des propositions de changement de la loi électorale à Kinshasa, réprimées dans le sang, ndlr] l’empêchent, au dernier moment, de revenir au festival. Révélé par Atalaku, 2013, Prix des Jeunes à Black Movie 2013, prélude à la préparation d’élections en RDC, il se confirme avec Examen d'État, 2014, qui connaît un succès d’audience international et trouve un bon écho à Genève.
Habile à approcher ses sujets avec une caméra curieuse mais discrète, Hamadi suit un groupe d’étudiants qui préparent le bac en s’organisant par eux-mêmes. En marge de l’école que les parents ne peuvent plus payer, ils se réunissent pour étudier les sujets entre eux. Leur détermination à obtenir le diplôme indispensable à l’entrée dans la vie économique, les pousse à emprunter des moyens pas toujours légaux pour augmenter leur chance. On les voit tenter d’acheter les bons sujets pour mieux les étudier avant, prêts à tout pour échapper à la misère ambiante. Des gestes désespérés mais combatifs, que le cinéaste enregistre comme les signaux visibles d’une éducation manquée et d’un système en faillite, incapable de fonder des diplômés compétents.
L’engagement de Dieudo Hamadi dans cette forme aigüe de cinéma vérité trouve un précieux relais avec une productrice française, Marie Balducchi, active au sein de AGAT Films, qu’il a rencontrée lors d’une formation à la Femis de Paris. Motivée par le sujet de Examen d'État, développé avant Atalaku, elle a épaulé les longs préliminaires et les mésaventures des recherches pour trouver les étudiants prêts à se laisser filmer. Le projet a obtenu le soutien de l’OIF qui a subventionné le film, bénéficiaire de la commission sélective du Cosip au CNC en France, grâce à la présence de Vosges Télévision Images Plus. Une aide de l’Ambassade de France à Kinshasa s’est ajoutée à ces moyens et la structure Vidéo de Poche à Paris a soutenu la postproduction. Le film a profité aussi des moyens de Karoninka du Sénégal, et des Studios Kabako en RDC où Dieudo Hamadi a suivi une formation en 2007, perfectionnée par une autre session à Kinshasa. Le cinéaste a signé deux courts-métrages, Dames en attente, 2009, sur la pratique des hôpitaux consistant à séquestrer des malades qui ne peuvent pas payer, et Tolérance zéro, portrait d’une femme, major de police de Bukavu, coordonnant la lutte contre les violences sexuelles. Ces réalisations ont précédé une Université d’été à la Femis, en 2010, où Dieudo Hamadi a pu amorcer des contacts avec la productrice de Examen d'État, livrant un regard respectueux mais sans concession sur la manière de créer une société singulière pour affronter le social.
Soigner les esprits
Si les réalisateurs africains explorent volontiers les groupes sociaux qui resserrent leurs rangs pour mieux s’intégrer, c’est aussi pour éclairer en contrepoint le fonctionnement de la société et sa norme. La question se pose aussi sur le plan de l’individu et son rapport psychologique à la société africaine où il vit. En réalisant Ce qu'il reste de la folie, 2014, le Français Joris Lachaise plonge directement dans le cœur du sujet, au Sénégal. Il pénètre l’hôpital psychiatrique de Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, en accompagnant la cinéaste Khady Sylla qui y revient après avoir été traitée pour dépressions chroniques.
Décédée en 2013, auteure de Les Bijoux, 1997, Colobane Express, 1999, Une fenêtre ouverte, 2005, et Le Monologue de la muette coréalisé avec Charlie Van Damme, 2008, ainsi que Une simple parole coréalisé en 2013 avec sa sœur Mariama Faye, la réalisatrice sert d’amorce pour soulever les questions de traitement médical des fous par une institution héritée de la vision occidentale de la médecine. La caméra s’attarde sur les patients désorientés, les médecins bienveillants, les aides soignants plus fermes, pour débusquer les pouvoirs, les contradictions et les limites de cette pratique que d’autres types de soins, traditionnels, pratiqués dans les villages, ou religieux, à base de désenvoutements, peuvent relayer, ou remplacer, avec une certaine efficacité. Croisant les témoignages, les questions, les approches, Joris Lachaise semble mesurer aussi les séquelles de l’emprise coloniale dans les esprits sénégalais troublés, comme le désarroi toujours palpable de la société actuelle face à la folie qui la désigne en menaçant les définitions établies.
Le film a été engagé après une résidence de travail à Saint Louis, au Sénégal, en 2013. Joris Lachaise a obtenu le soutien de la société française KS Visions qu’il a connue en collaborant avec Jean-Pierre Krief, un de ses fondateurs, et Arte, à la réalisation d’un film sur le Tribunal Spécial Irakien. Son inclination pour le documentaire est renforcée par sa rencontre avec Jean Rouch, en 1999, puis un DEA qui le conduit sur le terrain de l’investigation. Il questionne une anthropologie de la mort et le statut des collections du Musée de l’Homme, avant de se dédier au cinéma. Après avoir conçu des pièces vidéos à partir de compositions sonores, il coréalise avec Thomas Roussillon, Comme un océan dans un aquarium, 2010, un documentaire sur le combat de demandeurs d’asile, venus de la Corne d’Afrique, de Roumanie, aux côtés de sans logis, expulsés d’un squat à Angers.
Mais c’est à Marseille où il réside, qu’il participe à la fondation de l’association Babel XIII pour produire des œuvres multimédias, traitant des cultures mélangées. Cette structure diffuse aussi les films de Joris Lachaise dont En attendant Jean-Paul, court-métrage de 2009, et Convention : Mur noir / Trous blancs, 2011. Tourné à l’occasion de l’anniversaire des 50 ans de l’indépendance du Mali, ce long-métrage documentaire parcourt le pays, en mesurant les effets de la post colonisation et de la colonisation des esprits. L’appui de Babel XIII se retrouve aussi à la production de Ce qu'il reste de la folie, écrit, filmé et monté avec peu de moyens par Joris Lachaise. Il rend hommage avec un grand sens du cadre, aux artistes indépendants sénégalais, particulièrement Khady Sylla et le plasticien Joe Ouakam, compagnon de jeunesse du réalisateur Djibril Diop Mambety, qui joue son personnage de révolté sensible dans quelques scènes symboliques du film.
Faire évoluer les mœurs
L’impact de la fiction est plus efficace pour toucher les individus et les faire discuter selon Chika Anadu. La réalisatrice du Nigéria, conviée à Black Movie avec B for Boy, 2013, ne peut y arriver à temps, faute de visa. Elle préfère conter des histoires divertissantes pour provoquer des débats autour de la famille. Son premier long-métrage s’inscrit dans la veine prolifique des comédies de mœurs populaires du Nigéria, en évaluant de manière appuyée la condition de la femme. Amaka, son héroïne de 39 ans, mère d’une fille, attend un enfant que sa belle-mère espère être un garçon pour prolonger sa lignée. Elle menace Amaka de donner une autre femme à son fils et invite la belle Chima, à la fête des 40 ans de son fils. Effrayée, Amaka accepte une échographie qui est positive, mais elle accouche d’un bébé mort-né qui rend impossible une autre grossesse. N’osant l’avouer à son mari qui vient de perdre son frère, elle feint d’être toujours enceinte, tente d’adopter sans succès. La belle–mère projette de s’installer chez eux avec Chima, alors que Amaka peut prétendre à l’adoption convoitée.
En réalisant ce drame moralisateur, Chika Anadu questionne l’idée largement répandue qui valorise les femmes qui ont des garçons. Avec ses cadres serrés, ses dialogues fournis, B for Boy est fait pour dénoncer une tradition qui handicape les femmes d’après la réalisatrice. Son ambition est de traiter de sujets de sociétés africains avec professionnalisme pour améliorer la qualité de la production de Nollywood.
Née à Lagos, diplômée de la New York Film Academy’s Four Week, Chika Anadu est l’auteure de trois courts-métrages : Epilogue, 2009, avec un couple qui règle ses comptes, Ava, 2010, où une femme s’interroge sur son futur époux, présenté au Short Film Corner du Festival de Cannes, The Marriage Factor, 2011, sur une jeune femme que sa mère veut caser, avec le concours du Focus Features’ Africa First Programme. Pour étayer son travail, défendu au Talent Campus de la Berlinale, Chika Anadu a participé à la création de No Blondes Productions. Elle écrit, dirige B for Boy, produit avec Arie Esiri, pour défendre la condition des femmes à travers des personnages expressifs et représentatifs. Concentrant son propos sur une héroïne battante, et la belle-mère qui reproduit sans réfléchir des valeurs oppressantes pour les femmes, elle met en scène un système qui doit être révisé pour faire évoluer la société. Le tout mené avec les codes du spectacle familial de bon ton et le désir de renforcer le potentiel du cinéma au Nigeria.
Combattre la répression
L’ambition de Rehad Desai, connu comme producteur en Afrique du Sud, n’est pas d’isoler des individus pour en faire des symboles d’un mal social mais au contraire de rassembler les forces pour dénoncer la répression. Miners Shot Down, 2014, revient, documents à l’appui, sur le massacre des mineurs grévistes de Lonmin Marikana, par la police sud-africaine, le 16 août 2012. Quelques jours auparavant, le réalisateur montre les manifestations des mineurs et les heurts successifs avec la police qui aboutissent à la mort de 34 manifestants noirs d’un coup. Ce drame qui a profondément marqué l’Afrique du Sud post apartheid, survient après la lutte pacifiste des mineurs pour obtenir de meilleurs salaires. La compagnie minière ne veut pas céder tant que le travail ne reprend pas, le gouvernement l’appuie en fonction du jeu du Syndicat de l’Union Nationale des Mines.
Rehad Desai retrace la spirale de la violence à l’aide d’images de surveillance des autorités, de scènes filmées pendant le travail de la Commission d’enquête, de témoignages posés et de scènes enregistrées sur le vif. Trois opérateurs et cinq monteurs sont engagés pour composer Miners Shot Down, au terme d’un long processus de montage qui combine des archives de SABC, Al Jazeera, ITN Reuters, Marikana Commission of Inquiry, VNS Archive et CNBS Africa. La musique de Philip Miller contribue à la puissance de feu de ce documentaire ambitieux, supervisé par Uhuru Productions, la société de Rehad Desai, avec le concours de trois producteurs consultants : Anita Khanna, Brian Tilley et Bheki Peterson.
Le réalisateur a bénéficié du support de la Ford Fundation JustFilms pour lui permettre d’engager les recherches sur la condition des mineurs, et le concours de Bertha Fundation. Miners Shot Down s’inscrit dans le cadre des initiatives pour réhabiliter la mémoire des mineurs tués, sous la bannière de Campaign Justice New for Marikana Strikers. Le documentaire est alors un moyen de renforcer la réflexion sur la collision du pouvoir avec l’entreprise minière et les violences qui en découlent. La démarche de Rehad Desai qui a un temps séjourné en Inde, repose sur son intérêt pour l’Histoire qu’il a étudié à Londres, avant de sortir diplômé de l’Université du Zimbabwe. Devenu producteur à partir de 1996, il soutient des sujets historiques et socio politiques pour la télé comme le cinéma. Il passe une Maitrise d’Histoire sociale à l’Université de Witwatersrand, et fonde Uhuru Productions, en 1997, réalisant lui même quelques films. Il évoque la figure contrastée de son père, héros de la lutte anti apartheid, moins attachant en famille, dans Born into Struggle, 2004, vu à Black Movie, signe Bhe Bushman's Secret, 2006, sur le rôle du hoodia, plante utilisée par les Sans comme coupe-faim, convoitée par l’industrie alimentaire, Bhambatha, 2007, rappelant la résistance des chefs coutumiers à une taxe, imposée en 1906, par les colons, sur les hommes de 18 ans. Avec The Battle For Johannesburg, 2010, il évoque à travers le regard d’une petite fille, les transformations d’un village pour la Coupe du Monde de foot.
Ces films reflètent la vision critique de Rehad Desai sur la société sud-africaine. La diffusion mondiale de Miners Shot Down qui s’inscrit bien dans les programmes exigeants et allumés de Black Movie, vise à élargir le cercle des débats pour combattre la répression et l’injustice.
Ainsi les pigments noirs, relevés cette année à Genève, creusent le sillon d’un cinéma en lutte, bien construit, porté avec ferveur par les cinéastes présents. Paroles et images par vent debout, dans le cœur de l’Afrique remuante d’aujourd’hui, investie et exacerbée par Black Movie.
Michel AMARGER
(Africiné / Paris)
pour Images Francophones
A lire
Black Movie - Les Lauréats 2015 (par Michel Amarger)
Illustration : Ce qu'il reste de la folie, de Joris Lachaise, 2014
Crédit : KS VISIONS et Babel XIII.
Chaque année, à Genève, l’ambiance monte d’un cran pour le Festival Black Movie. On compte cette fois, 112 films, répartis en 10 sections qui font la part belle au cinéma d’auteur et aux genres. Le festival est une occasion unique de mesurer la vitalité des productions qui échappent au commerce et à la standardisation. Il y a 12 premières européennes, 51 premières suisses. 50 longs-métrages sont présentés. 22 réalisateurs sont invités pour débattre en public et partager les fêtes.
L’attention aux évolutions de l’Asie ne se dément pas avec la section « A mains nues » qui avance une rétrospective du Chinois Wang Bing, documentariste frondeur, qui filme depuis les années 2000, les oubliés de la Chine et de son orientation capitaliste. Il assure une master class à Genève, pour expliquer comment il développe un style naturaliste, dépouillé, en s’appuyant sur des financements indépendants.
La section « Sexties » rend hommage à l’Art Theater Guild, maison de production qui a contribué à la Nouvelle vague japonaise des années 60. De son côté, « Le Petit Black Movie », destiné aux enfants, fait découvrir 56 films, avec un focus sur le Brésil. D’autres sections thématiques, « La peur au ventre », « Pas à pas », « Matière grise », proposent de suivre les nouveaux élans des auteurs d’Asie, d’Amérique Latine avec quelques images fortes de l’Afrique.
Exemplaires, les animateurs du Ciné Guimbi viennent du Burkina Faso, exposer l’avancée des travaux de reconstruction de leur cinéma (à lire, l’article Projet "Il faut sauver le ciné Guimbi"). Cinq réalisateurs, interpellés par les réalités du continent, se trouvent en sélection. Ils sont mobilisés par Black Movie pour expliquer leur engagement dans la production de documentaires ou de fictions en Afrique. Leurs expériences contrastées permettent d’esquisser à Genève, quelques modes d’approches.
Survivre en collectif
Le documentaire reste le mode privilégié de résistance aux difficultés économiques qui touchent nombre de pays africains. Au Togo, Egome Amah cherche à élargir le cadre d’observation avec Les Hustlers, 2014, portrait de quatre pêcheurs amers d’un quartier de Lomé. Ils s’appellent Aaron, Léo, Zorro, Gombo, et vivent en marge du port, dans le bidonville de Katanga. Pêcheurs sans grand succès le matin, occupés de petits trafics de survie l’après-midi, ils s’évadent matin et soir en consommant la drogue, réunis par la misère et la survie sans cesse renouvelée. En les suivant sur trois ans, dans leurs embrouilles, leurs rêves, leurs familles dépendantes, Egome Amah capte leur humanité et leur sens de la dérision, eux qui se nomment « les Hustlers », les arnaqueurs, comme pour revendiquer leur place de parias.
Ce portrait de proximité s’appuie sur l’attitude patiente et le sens du rythme du cinéaste togolais. Il est réalisé dans le cadre de la collection Africadoc, Lumières d’Afrique, soutenue par l’Ecole documentaire de Lussas, en France. Egome Amah a pu bénéficier d’une résidence Africadoc à Niamey, au Niger, en 2010, pour étayer ses projets documentaires et s’engager dans la réalisation de Les Hustlers. Le film est coproduit par La Maison du directeur, en France, Merveilles Productions, et TVR Rennes 35 Bretagne. Il a pu ainsi avoir le soutien du Centre National du Cinéma français et la Procirep Angoa-Agicoa. Cette configuration lui permet d’être déposé au Club du Doc’, la vidéothèque permanente gérée par la Maison du documentaire en France. Les Hustlers est aussi disponible en dvd pour renforcer la circulation des images de Egome Amah. Sa sélection au Festival Black Movie 2015 de Genève est alors l’occasion d’aborder les problèmes liés à l’absence de politique véritable du cinéma, et de lieu de formation stable au Togo.
Organiser sa réussite
Le Congolais Dieudo Hamadi dénonce toujours avec fougue le manque d’éduction au cinéma dans son pays. Les mouvements sociaux congolais [manifestations pacifiques contre des propositions de changement de la loi électorale à Kinshasa, réprimées dans le sang, ndlr] l’empêchent, au dernier moment, de revenir au festival. Révélé par Atalaku, 2013, Prix des Jeunes à Black Movie 2013, prélude à la préparation d’élections en RDC, il se confirme avec Examen d'État, 2014, qui connaît un succès d’audience international et trouve un bon écho à Genève.
Habile à approcher ses sujets avec une caméra curieuse mais discrète, Hamadi suit un groupe d’étudiants qui préparent le bac en s’organisant par eux-mêmes. En marge de l’école que les parents ne peuvent plus payer, ils se réunissent pour étudier les sujets entre eux. Leur détermination à obtenir le diplôme indispensable à l’entrée dans la vie économique, les pousse à emprunter des moyens pas toujours légaux pour augmenter leur chance. On les voit tenter d’acheter les bons sujets pour mieux les étudier avant, prêts à tout pour échapper à la misère ambiante. Des gestes désespérés mais combatifs, que le cinéaste enregistre comme les signaux visibles d’une éducation manquée et d’un système en faillite, incapable de fonder des diplômés compétents.
L’engagement de Dieudo Hamadi dans cette forme aigüe de cinéma vérité trouve un précieux relais avec une productrice française, Marie Balducchi, active au sein de AGAT Films, qu’il a rencontrée lors d’une formation à la Femis de Paris. Motivée par le sujet de Examen d'État, développé avant Atalaku, elle a épaulé les longs préliminaires et les mésaventures des recherches pour trouver les étudiants prêts à se laisser filmer. Le projet a obtenu le soutien de l’OIF qui a subventionné le film, bénéficiaire de la commission sélective du Cosip au CNC en France, grâce à la présence de Vosges Télévision Images Plus. Une aide de l’Ambassade de France à Kinshasa s’est ajoutée à ces moyens et la structure Vidéo de Poche à Paris a soutenu la postproduction. Le film a profité aussi des moyens de Karoninka du Sénégal, et des Studios Kabako en RDC où Dieudo Hamadi a suivi une formation en 2007, perfectionnée par une autre session à Kinshasa. Le cinéaste a signé deux courts-métrages, Dames en attente, 2009, sur la pratique des hôpitaux consistant à séquestrer des malades qui ne peuvent pas payer, et Tolérance zéro, portrait d’une femme, major de police de Bukavu, coordonnant la lutte contre les violences sexuelles. Ces réalisations ont précédé une Université d’été à la Femis, en 2010, où Dieudo Hamadi a pu amorcer des contacts avec la productrice de Examen d'État, livrant un regard respectueux mais sans concession sur la manière de créer une société singulière pour affronter le social.
Soigner les esprits
Si les réalisateurs africains explorent volontiers les groupes sociaux qui resserrent leurs rangs pour mieux s’intégrer, c’est aussi pour éclairer en contrepoint le fonctionnement de la société et sa norme. La question se pose aussi sur le plan de l’individu et son rapport psychologique à la société africaine où il vit. En réalisant Ce qu'il reste de la folie, 2014, le Français Joris Lachaise plonge directement dans le cœur du sujet, au Sénégal. Il pénètre l’hôpital psychiatrique de Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, en accompagnant la cinéaste Khady Sylla qui y revient après avoir été traitée pour dépressions chroniques.
Décédée en 2013, auteure de Les Bijoux, 1997, Colobane Express, 1999, Une fenêtre ouverte, 2005, et Le Monologue de la muette coréalisé avec Charlie Van Damme, 2008, ainsi que Une simple parole coréalisé en 2013 avec sa sœur Mariama Faye, la réalisatrice sert d’amorce pour soulever les questions de traitement médical des fous par une institution héritée de la vision occidentale de la médecine. La caméra s’attarde sur les patients désorientés, les médecins bienveillants, les aides soignants plus fermes, pour débusquer les pouvoirs, les contradictions et les limites de cette pratique que d’autres types de soins, traditionnels, pratiqués dans les villages, ou religieux, à base de désenvoutements, peuvent relayer, ou remplacer, avec une certaine efficacité. Croisant les témoignages, les questions, les approches, Joris Lachaise semble mesurer aussi les séquelles de l’emprise coloniale dans les esprits sénégalais troublés, comme le désarroi toujours palpable de la société actuelle face à la folie qui la désigne en menaçant les définitions établies.
Le film a été engagé après une résidence de travail à Saint Louis, au Sénégal, en 2013. Joris Lachaise a obtenu le soutien de la société française KS Visions qu’il a connue en collaborant avec Jean-Pierre Krief, un de ses fondateurs, et Arte, à la réalisation d’un film sur le Tribunal Spécial Irakien. Son inclination pour le documentaire est renforcée par sa rencontre avec Jean Rouch, en 1999, puis un DEA qui le conduit sur le terrain de l’investigation. Il questionne une anthropologie de la mort et le statut des collections du Musée de l’Homme, avant de se dédier au cinéma. Après avoir conçu des pièces vidéos à partir de compositions sonores, il coréalise avec Thomas Roussillon, Comme un océan dans un aquarium, 2010, un documentaire sur le combat de demandeurs d’asile, venus de la Corne d’Afrique, de Roumanie, aux côtés de sans logis, expulsés d’un squat à Angers.
Mais c’est à Marseille où il réside, qu’il participe à la fondation de l’association Babel XIII pour produire des œuvres multimédias, traitant des cultures mélangées. Cette structure diffuse aussi les films de Joris Lachaise dont En attendant Jean-Paul, court-métrage de 2009, et Convention : Mur noir / Trous blancs, 2011. Tourné à l’occasion de l’anniversaire des 50 ans de l’indépendance du Mali, ce long-métrage documentaire parcourt le pays, en mesurant les effets de la post colonisation et de la colonisation des esprits. L’appui de Babel XIII se retrouve aussi à la production de Ce qu'il reste de la folie, écrit, filmé et monté avec peu de moyens par Joris Lachaise. Il rend hommage avec un grand sens du cadre, aux artistes indépendants sénégalais, particulièrement Khady Sylla et le plasticien Joe Ouakam, compagnon de jeunesse du réalisateur Djibril Diop Mambety, qui joue son personnage de révolté sensible dans quelques scènes symboliques du film.
Faire évoluer les mœurs
L’impact de la fiction est plus efficace pour toucher les individus et les faire discuter selon Chika Anadu. La réalisatrice du Nigéria, conviée à Black Movie avec B for Boy, 2013, ne peut y arriver à temps, faute de visa. Elle préfère conter des histoires divertissantes pour provoquer des débats autour de la famille. Son premier long-métrage s’inscrit dans la veine prolifique des comédies de mœurs populaires du Nigéria, en évaluant de manière appuyée la condition de la femme. Amaka, son héroïne de 39 ans, mère d’une fille, attend un enfant que sa belle-mère espère être un garçon pour prolonger sa lignée. Elle menace Amaka de donner une autre femme à son fils et invite la belle Chima, à la fête des 40 ans de son fils. Effrayée, Amaka accepte une échographie qui est positive, mais elle accouche d’un bébé mort-né qui rend impossible une autre grossesse. N’osant l’avouer à son mari qui vient de perdre son frère, elle feint d’être toujours enceinte, tente d’adopter sans succès. La belle–mère projette de s’installer chez eux avec Chima, alors que Amaka peut prétendre à l’adoption convoitée.
En réalisant ce drame moralisateur, Chika Anadu questionne l’idée largement répandue qui valorise les femmes qui ont des garçons. Avec ses cadres serrés, ses dialogues fournis, B for Boy est fait pour dénoncer une tradition qui handicape les femmes d’après la réalisatrice. Son ambition est de traiter de sujets de sociétés africains avec professionnalisme pour améliorer la qualité de la production de Nollywood.
Née à Lagos, diplômée de la New York Film Academy’s Four Week, Chika Anadu est l’auteure de trois courts-métrages : Epilogue, 2009, avec un couple qui règle ses comptes, Ava, 2010, où une femme s’interroge sur son futur époux, présenté au Short Film Corner du Festival de Cannes, The Marriage Factor, 2011, sur une jeune femme que sa mère veut caser, avec le concours du Focus Features’ Africa First Programme. Pour étayer son travail, défendu au Talent Campus de la Berlinale, Chika Anadu a participé à la création de No Blondes Productions. Elle écrit, dirige B for Boy, produit avec Arie Esiri, pour défendre la condition des femmes à travers des personnages expressifs et représentatifs. Concentrant son propos sur une héroïne battante, et la belle-mère qui reproduit sans réfléchir des valeurs oppressantes pour les femmes, elle met en scène un système qui doit être révisé pour faire évoluer la société. Le tout mené avec les codes du spectacle familial de bon ton et le désir de renforcer le potentiel du cinéma au Nigeria.
Combattre la répression
L’ambition de Rehad Desai, connu comme producteur en Afrique du Sud, n’est pas d’isoler des individus pour en faire des symboles d’un mal social mais au contraire de rassembler les forces pour dénoncer la répression. Miners Shot Down, 2014, revient, documents à l’appui, sur le massacre des mineurs grévistes de Lonmin Marikana, par la police sud-africaine, le 16 août 2012. Quelques jours auparavant, le réalisateur montre les manifestations des mineurs et les heurts successifs avec la police qui aboutissent à la mort de 34 manifestants noirs d’un coup. Ce drame qui a profondément marqué l’Afrique du Sud post apartheid, survient après la lutte pacifiste des mineurs pour obtenir de meilleurs salaires. La compagnie minière ne veut pas céder tant que le travail ne reprend pas, le gouvernement l’appuie en fonction du jeu du Syndicat de l’Union Nationale des Mines.
Rehad Desai retrace la spirale de la violence à l’aide d’images de surveillance des autorités, de scènes filmées pendant le travail de la Commission d’enquête, de témoignages posés et de scènes enregistrées sur le vif. Trois opérateurs et cinq monteurs sont engagés pour composer Miners Shot Down, au terme d’un long processus de montage qui combine des archives de SABC, Al Jazeera, ITN Reuters, Marikana Commission of Inquiry, VNS Archive et CNBS Africa. La musique de Philip Miller contribue à la puissance de feu de ce documentaire ambitieux, supervisé par Uhuru Productions, la société de Rehad Desai, avec le concours de trois producteurs consultants : Anita Khanna, Brian Tilley et Bheki Peterson.
Le réalisateur a bénéficié du support de la Ford Fundation JustFilms pour lui permettre d’engager les recherches sur la condition des mineurs, et le concours de Bertha Fundation. Miners Shot Down s’inscrit dans le cadre des initiatives pour réhabiliter la mémoire des mineurs tués, sous la bannière de Campaign Justice New for Marikana Strikers. Le documentaire est alors un moyen de renforcer la réflexion sur la collision du pouvoir avec l’entreprise minière et les violences qui en découlent. La démarche de Rehad Desai qui a un temps séjourné en Inde, repose sur son intérêt pour l’Histoire qu’il a étudié à Londres, avant de sortir diplômé de l’Université du Zimbabwe. Devenu producteur à partir de 1996, il soutient des sujets historiques et socio politiques pour la télé comme le cinéma. Il passe une Maitrise d’Histoire sociale à l’Université de Witwatersrand, et fonde Uhuru Productions, en 1997, réalisant lui même quelques films. Il évoque la figure contrastée de son père, héros de la lutte anti apartheid, moins attachant en famille, dans Born into Struggle, 2004, vu à Black Movie, signe Bhe Bushman's Secret, 2006, sur le rôle du hoodia, plante utilisée par les Sans comme coupe-faim, convoitée par l’industrie alimentaire, Bhambatha, 2007, rappelant la résistance des chefs coutumiers à une taxe, imposée en 1906, par les colons, sur les hommes de 18 ans. Avec The Battle For Johannesburg, 2010, il évoque à travers le regard d’une petite fille, les transformations d’un village pour la Coupe du Monde de foot.
Ces films reflètent la vision critique de Rehad Desai sur la société sud-africaine. La diffusion mondiale de Miners Shot Down qui s’inscrit bien dans les programmes exigeants et allumés de Black Movie, vise à élargir le cercle des débats pour combattre la répression et l’injustice.
Ainsi les pigments noirs, relevés cette année à Genève, creusent le sillon d’un cinéma en lutte, bien construit, porté avec ferveur par les cinéastes présents. Paroles et images par vent debout, dans le cœur de l’Afrique remuante d’aujourd’hui, investie et exacerbée par Black Movie.
Michel AMARGER
(Africiné / Paris)
pour Images Francophones
A lire
Black Movie - Les Lauréats 2015 (par Michel Amarger)
Illustration : Ce qu'il reste de la folie, de Joris Lachaise, 2014
Crédit : KS VISIONS et Babel XIII.
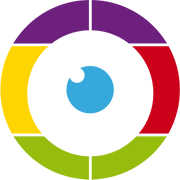 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images