Entretien avec… Luc Damiba, cofondateur du festival Ciné Droit Libre

"Il faut que nous-mêmes nous défendions nos propres droits et libertés".
Dans des circonstances exceptionnelles où les libertés et droits des citoyens sont menacés et où l'intolérance gagne du terrain, il existe une alternative capable de sauver les esprits de l'obscurantisme et de la désinformation. Dans l'objectif de susciter le débat, puis l'action, le concept du Festival Ciné Droit Libre (CDL) reste un outil important en Afrique encore menacée par des dictatures et par le djihadisme devenu un thème de préoccupation transnationale.
Parlez-nous un peu de la philosophie de Ciné Droit Libre (CDL).
CDL est un cinéma citoyen alternatif qui se focalise sur des films qui abordent des thématiques sur les droits humains et sur la liberté d'expression. CDL est né ainsi : un film sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo a été réalisé et a été censuré par le régime de Blaise Compaoré [Borry Bana, 2003, coréalisé par Abdoulaye Diallo et Luc Damiba. Alors nous avons pensé créer un espace alternatif pour passer des films qui sont censurés ou qui sont politiquement incorrects, ou qui dérangent ou des films polémiques, avec un objectif derrière : susciter l'action. Donc c'est un festival citoyen qui veut que le film aille vers le public et non le contraire. Puisqu'aujourd'hui nos salles de cinéma sont transformées en églises, mosquées ou supermarchés, on a vendu la culture aux plus offrants.
Du coup c'est pour nous une alternative consistant à dire : tournons des films, emmenons-les auprès du public, et demandons lui ce que ce que nous devons faire ; en suivant le film, on identifie le problème posé par celui-ci et on se demande ce que l'on peut poser comme action. Personne ne viendra à notre place trouver des solutions à nos problèmes concernant notre quotidien. Il faut que nous-mêmes nous défendions nos propres droits et libertés.
Comment avez-vous réussi à rallier à votre cause des personnes de compétences et d'origines différentes ?
Il faut souligner que nous sommes des produits du Fespaco [Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, Ndlr] qui est le creuset de plusieurs nationalités. Nous avons ressenti une frustration, nous qui étions chargés de tenir le journal du festival, le Fespaco News. Nous nous sommes dit que nous pouvions avoir notre espace alternatif à l'occasion du Fespaco en transformant celui-ci en un festival citoyen plus proche du public. Le Fespaco est devenu élitiste, organisé par les politiques pour satisfaire les politiques. Et rien d'autre.
Comment nous avons fait pour mobiliser des compétences diverses ? Nous avons pu convaincre des journalistes, des artistes, des militants des droits humains, des cinéastes. Nous nous sommes convaincus du fait que nous ne pouvions faire ce festival sans réunir au maximum toutes ces compétences diverses. Ciné Droit Libre en est aujourd'hui à la 12e, 13e édition, nous en sommes présentement au premier évènement ouest-africain qui se tient à Dakar, Abidjan, Bamako et bientôt à Niamey, Nouakchott, Cotonou, Lomé, etc. Notre ambition, c'est d'en faire un festival citoyen.
Est-ce le concept sera élargi aux pays anglophones d'Afrique ?
Je discutais ce matin avec un grand artiste nigérian. Il m'a dit que c'était la première fois qu'il participait à Ciné Droit Libre et qu'il souhaiterait que ce festival se tienne en 2017 à Abuja. On a commencé les échanges par mail. Il m'a suggéré de débuter dès maintenant les démarches. J'en suis d'autant plus fier que le Nigeria, c'est Nollywood qui est une approche novatrice du cinéma africain. Il ne faut pas que nous nous refermions dans une zone franco-francophone.
Il faut ce brassage africain. Pour nous, le festival Ciné Droit Libre devra aller au Ghana et ailleurs sur le continent. Des demandes nous sont venues du Gabon, mais compte-tenu de la situation socio-électorale, une situation où la démocratie est prise au piège, il sera difficile d'y amener le festival, du Congo. Nous voulons ensemencer parce que nous voudrions que les acteurs locaux s'approprient du concept et puissent se l'appliquer eux-mêmes.
Pourrait-on s'attendre à une délocalisation vers des pays comme la France, le Canada, la Belgique, etc. pour toucher la diaspora ?
Dans ces pays, il y a déjà des festivals de droits humains qui sont organisés de façon autre que le nôtre. Mais nous sommes partenaires du festival du film des droits de l'homme de Genève, de Paris, du Canada ; certains jurys nous sollicitent même, à l'image du Festival du film qui dérange, en Belgique. Nous sommes en synergie parce qu'il faut dire que les peuples ont les mêmes problèmes liés aux questions des droits humains. Avec le terrorisme en Europe, on veut réduire les libertés des citoyens en peau de chagrin. Tout ce qu'ils ont obtenu comme gloire, comme valeurs cardinales y compris la démocratie sont en train de tomber à l'eau, avec ce terrorisme inventé. Et la méthode avec laquelle on le combat aujourd'hui va échouer. On a éliminé Ben Laden, et pourtant le terrorisme continue à toujours faire mal. Au contraire, ça s'est aggravé. Le système mondial de libéralisme et toute la politique sécuritaire devraient être repensés. Nous avons le droit de vivre. Nous voulons réfléchir sur ce qui se passe en termes de mécanismes, de stratégies et de politiques nationales et internationales pour lutter contre le terrorisme, contre l'extrémisme violent.
Est-ce que c'est le même thème qui sera reconduit à Ouaga, Bamako, etc. ?
Ce que nous faisons, c'est de retenir un même thème valable pour une année que nous soyons à Dakar, Ouaga, Bamako. La première étape pour le Festival, c'est Dakar, ensuite ce sera le tour pour Abidjan, puis Ouagadougou et enfin Bamako. En 2017, la liste des pays va certainement s'allonger. Et nous aurons une autre thématique générale, avec des sous-thèmes qui seront choisis en fonction des réalités locales de chaque pays. Nous allons aussi aller dans le Maghreb. Quelqu'un a si bien dit d'ailleurs que les pays dans lesquels une révolution a été possible, ce sont ces pays qui ont une certaine culture cinématographique : la Tunisie et le Burkina-Faso. Le cinéma est un outil de sensibilisation et de conscientisation. Pas une révolution inventée, comme c'est le cas pour la Lybie.
Pour cette troisième édition pour Dakar, comment s'est faite la sélection, puis la programmation ?
Nous avons lancé un appel à films qui a duré au moins six mois sur le site du festival, sur d'autres sites comme celui du studio Sankara. Nous avons reçu un nombre important de films aussi bien sénégalais qu'internationaux. Par la suite, nous avons procédé à une sélection. Je dois dire que pour Dakar, nous avons un festival en deux phases : une première beaucoup plus intellectuelle se tenant sur trois sites que sont l'Institut Français, le centre culturel Douta Seck et au G Hip Hop [à Guédiawaye, banlieue de Dakar, ndlr] ; la seconde a lieu à l'Université Cheikh Anta Diop, dans certaines écoles professionnelles et sur la ville de Mbour, du 1er au 5 décembre 2016.
Depuis que vous avez commencé à véhiculer ce concept, avez-vous obtenu des motifs de satisfaction ?
Les espaces de liberté étaient réduits, commençons par la politique. Dans certains pays où nous avons aidé à installer ce type de festival, il y a des histoires assez intéressantes. L'espace que nous mettons en place qui permet la formation des jeunes avec des masters class, crée le débat, permet de passer les courts-métrages des jeunes réalisateurs. Ce qui a créé un engouement. Les gens ont besoin d'un autre espace d'échanges, parce qu'aujourd'hui, si c'est la télévision, presque personne ne la regarde plus ; chacun a sa tablette. On peut dire que c'est pour nous un motif de satisfaction. Cette initiative a permis d'accompagner l'insurrection populaire contre révision constitutionnelle au Burkina, y compris la résistance contre le coup d'État qui a voulu renverser le gouvernement de transition. Au moment de ce coup d'État, pendant que toutes les télévisions, journaux et radios étaient fermés, nous étions la seule télévision sur internet à émettre.
Les rencontres de ce genre coûtent beaucoup d'argent, comment vous faites pour tenir financièrement ?
Nous avons plusieurs niveaux d'engagement. Déjà le Studio Sankara met à la disposition de Ciné Droit Libre son personnel. Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire que quelqu'un, durant une semaine, abandonne toutes ses activités pour se mettre au service du festival sans être payé. Didier Awadi a annulé les concerts qu'il devait animer un peu partout pour travailler pour le festival. Pour nous, c'est cela le premier financement. Nous avons aussi des partenaires financiers qui croient en ce que nous faisons. Le budget global pour ce qui est de l'édition de Dakar tourne autour de 25 millions de Fcfa, parce qu'il faut acheter les billets d'avion, acheter les droits des films, s'occuper de la logistique, avoir des frais de communication. A Ouaga, on a presque le double du budget de Dakar, à Abidjan, comme ils sont plus nantis, le budget pourrait être plus consistant, à Bamako, il sera à peu près pareil à celui de Dakar. L'un dans l'autre, nous avons les moyens qu'il faut pour organiser cet évènement.
Avez-vous des contraintes dans votre travail ?
Nous en avons plusieurs. D'abord tout le monde n'a pas les capacités organisationnelles qu'il faut. Et quand c'est le cas dans un pays, ça pose des problèmes. Ensuite, il y a la tentation de la censure à tous les moments. Ici, à Dakar, nous avons donné un espace aux jeunes Gabonais ; le préfet de Dakar n'a pas autorisé la marche qu'ils comptaient organiser. Ça peut aussi être dangereux pour Ciné Droit Libre. Parfois aussi on nous demande de ne pas diffuser un film que nous avons pourtant décidé de mettre dans le programme. Mais nous mettons d'abord en avant tout notre propre engagement.
Entretien réalisé par Bassirou NIANG
Dakar, Africiné Magazine
pour Images Francophones
en collaboration avec Africultures
Image : Luc Damiba, journaliste et réalisateur burkinabè
Crédit : DR
Parlez-nous un peu de la philosophie de Ciné Droit Libre (CDL).
CDL est un cinéma citoyen alternatif qui se focalise sur des films qui abordent des thématiques sur les droits humains et sur la liberté d'expression. CDL est né ainsi : un film sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo a été réalisé et a été censuré par le régime de Blaise Compaoré [Borry Bana, 2003, coréalisé par Abdoulaye Diallo et Luc Damiba. Alors nous avons pensé créer un espace alternatif pour passer des films qui sont censurés ou qui sont politiquement incorrects, ou qui dérangent ou des films polémiques, avec un objectif derrière : susciter l'action. Donc c'est un festival citoyen qui veut que le film aille vers le public et non le contraire. Puisqu'aujourd'hui nos salles de cinéma sont transformées en églises, mosquées ou supermarchés, on a vendu la culture aux plus offrants.
Du coup c'est pour nous une alternative consistant à dire : tournons des films, emmenons-les auprès du public, et demandons lui ce que ce que nous devons faire ; en suivant le film, on identifie le problème posé par celui-ci et on se demande ce que l'on peut poser comme action. Personne ne viendra à notre place trouver des solutions à nos problèmes concernant notre quotidien. Il faut que nous-mêmes nous défendions nos propres droits et libertés.
Comment avez-vous réussi à rallier à votre cause des personnes de compétences et d'origines différentes ?
Il faut souligner que nous sommes des produits du Fespaco [Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, Ndlr] qui est le creuset de plusieurs nationalités. Nous avons ressenti une frustration, nous qui étions chargés de tenir le journal du festival, le Fespaco News. Nous nous sommes dit que nous pouvions avoir notre espace alternatif à l'occasion du Fespaco en transformant celui-ci en un festival citoyen plus proche du public. Le Fespaco est devenu élitiste, organisé par les politiques pour satisfaire les politiques. Et rien d'autre.
Comment nous avons fait pour mobiliser des compétences diverses ? Nous avons pu convaincre des journalistes, des artistes, des militants des droits humains, des cinéastes. Nous nous sommes convaincus du fait que nous ne pouvions faire ce festival sans réunir au maximum toutes ces compétences diverses. Ciné Droit Libre en est aujourd'hui à la 12e, 13e édition, nous en sommes présentement au premier évènement ouest-africain qui se tient à Dakar, Abidjan, Bamako et bientôt à Niamey, Nouakchott, Cotonou, Lomé, etc. Notre ambition, c'est d'en faire un festival citoyen.
Est-ce le concept sera élargi aux pays anglophones d'Afrique ?
Je discutais ce matin avec un grand artiste nigérian. Il m'a dit que c'était la première fois qu'il participait à Ciné Droit Libre et qu'il souhaiterait que ce festival se tienne en 2017 à Abuja. On a commencé les échanges par mail. Il m'a suggéré de débuter dès maintenant les démarches. J'en suis d'autant plus fier que le Nigeria, c'est Nollywood qui est une approche novatrice du cinéma africain. Il ne faut pas que nous nous refermions dans une zone franco-francophone.
Il faut ce brassage africain. Pour nous, le festival Ciné Droit Libre devra aller au Ghana et ailleurs sur le continent. Des demandes nous sont venues du Gabon, mais compte-tenu de la situation socio-électorale, une situation où la démocratie est prise au piège, il sera difficile d'y amener le festival, du Congo. Nous voulons ensemencer parce que nous voudrions que les acteurs locaux s'approprient du concept et puissent se l'appliquer eux-mêmes.
Pourrait-on s'attendre à une délocalisation vers des pays comme la France, le Canada, la Belgique, etc. pour toucher la diaspora ?
Dans ces pays, il y a déjà des festivals de droits humains qui sont organisés de façon autre que le nôtre. Mais nous sommes partenaires du festival du film des droits de l'homme de Genève, de Paris, du Canada ; certains jurys nous sollicitent même, à l'image du Festival du film qui dérange, en Belgique. Nous sommes en synergie parce qu'il faut dire que les peuples ont les mêmes problèmes liés aux questions des droits humains. Avec le terrorisme en Europe, on veut réduire les libertés des citoyens en peau de chagrin. Tout ce qu'ils ont obtenu comme gloire, comme valeurs cardinales y compris la démocratie sont en train de tomber à l'eau, avec ce terrorisme inventé. Et la méthode avec laquelle on le combat aujourd'hui va échouer. On a éliminé Ben Laden, et pourtant le terrorisme continue à toujours faire mal. Au contraire, ça s'est aggravé. Le système mondial de libéralisme et toute la politique sécuritaire devraient être repensés. Nous avons le droit de vivre. Nous voulons réfléchir sur ce qui se passe en termes de mécanismes, de stratégies et de politiques nationales et internationales pour lutter contre le terrorisme, contre l'extrémisme violent.
Est-ce que c'est le même thème qui sera reconduit à Ouaga, Bamako, etc. ?
Ce que nous faisons, c'est de retenir un même thème valable pour une année que nous soyons à Dakar, Ouaga, Bamako. La première étape pour le Festival, c'est Dakar, ensuite ce sera le tour pour Abidjan, puis Ouagadougou et enfin Bamako. En 2017, la liste des pays va certainement s'allonger. Et nous aurons une autre thématique générale, avec des sous-thèmes qui seront choisis en fonction des réalités locales de chaque pays. Nous allons aussi aller dans le Maghreb. Quelqu'un a si bien dit d'ailleurs que les pays dans lesquels une révolution a été possible, ce sont ces pays qui ont une certaine culture cinématographique : la Tunisie et le Burkina-Faso. Le cinéma est un outil de sensibilisation et de conscientisation. Pas une révolution inventée, comme c'est le cas pour la Lybie.
Pour cette troisième édition pour Dakar, comment s'est faite la sélection, puis la programmation ?
Nous avons lancé un appel à films qui a duré au moins six mois sur le site du festival, sur d'autres sites comme celui du studio Sankara. Nous avons reçu un nombre important de films aussi bien sénégalais qu'internationaux. Par la suite, nous avons procédé à une sélection. Je dois dire que pour Dakar, nous avons un festival en deux phases : une première beaucoup plus intellectuelle se tenant sur trois sites que sont l'Institut Français, le centre culturel Douta Seck et au G Hip Hop [à Guédiawaye, banlieue de Dakar, ndlr] ; la seconde a lieu à l'Université Cheikh Anta Diop, dans certaines écoles professionnelles et sur la ville de Mbour, du 1er au 5 décembre 2016.
Depuis que vous avez commencé à véhiculer ce concept, avez-vous obtenu des motifs de satisfaction ?
Les espaces de liberté étaient réduits, commençons par la politique. Dans certains pays où nous avons aidé à installer ce type de festival, il y a des histoires assez intéressantes. L'espace que nous mettons en place qui permet la formation des jeunes avec des masters class, crée le débat, permet de passer les courts-métrages des jeunes réalisateurs. Ce qui a créé un engouement. Les gens ont besoin d'un autre espace d'échanges, parce qu'aujourd'hui, si c'est la télévision, presque personne ne la regarde plus ; chacun a sa tablette. On peut dire que c'est pour nous un motif de satisfaction. Cette initiative a permis d'accompagner l'insurrection populaire contre révision constitutionnelle au Burkina, y compris la résistance contre le coup d'État qui a voulu renverser le gouvernement de transition. Au moment de ce coup d'État, pendant que toutes les télévisions, journaux et radios étaient fermés, nous étions la seule télévision sur internet à émettre.
Les rencontres de ce genre coûtent beaucoup d'argent, comment vous faites pour tenir financièrement ?
Nous avons plusieurs niveaux d'engagement. Déjà le Studio Sankara met à la disposition de Ciné Droit Libre son personnel. Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire que quelqu'un, durant une semaine, abandonne toutes ses activités pour se mettre au service du festival sans être payé. Didier Awadi a annulé les concerts qu'il devait animer un peu partout pour travailler pour le festival. Pour nous, c'est cela le premier financement. Nous avons aussi des partenaires financiers qui croient en ce que nous faisons. Le budget global pour ce qui est de l'édition de Dakar tourne autour de 25 millions de Fcfa, parce qu'il faut acheter les billets d'avion, acheter les droits des films, s'occuper de la logistique, avoir des frais de communication. A Ouaga, on a presque le double du budget de Dakar, à Abidjan, comme ils sont plus nantis, le budget pourrait être plus consistant, à Bamako, il sera à peu près pareil à celui de Dakar. L'un dans l'autre, nous avons les moyens qu'il faut pour organiser cet évènement.
Avez-vous des contraintes dans votre travail ?
Nous en avons plusieurs. D'abord tout le monde n'a pas les capacités organisationnelles qu'il faut. Et quand c'est le cas dans un pays, ça pose des problèmes. Ensuite, il y a la tentation de la censure à tous les moments. Ici, à Dakar, nous avons donné un espace aux jeunes Gabonais ; le préfet de Dakar n'a pas autorisé la marche qu'ils comptaient organiser. Ça peut aussi être dangereux pour Ciné Droit Libre. Parfois aussi on nous demande de ne pas diffuser un film que nous avons pourtant décidé de mettre dans le programme. Mais nous mettons d'abord en avant tout notre propre engagement.
Entretien réalisé par Bassirou NIANG
Dakar, Africiné Magazine
pour Images Francophones
en collaboration avec Africultures
Image : Luc Damiba, journaliste et réalisateur burkinabè
Crédit : DR
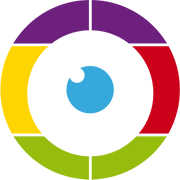 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images