Entretien avec Karim Moussaoui, auteur du film En attendant les hirondelles

Pour questionner les images algériennes. Sortie du film le 08 novembre 2017, en France.
Après sa sélection au Festival de Cannes, la sortie française de En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui, le 8 novembre 2017, s'inscrit dans un renouveau du cinéma algérien où les auteurs élargissent le champ.
Karim Moussaoui fait partie de la génération qui a décidé de réveiller le cinéma en Algérie après la "décennie noire". Il est l'un des fondateurs de l'association Chrysalide, en 2001, avec des réalisateurs complices comme Hassen Ferhani (Dans ma tête un rond-point, 2015), pour animer des séances de ciné-club à Alger, et produire des films en s'affranchissant des contraintes étatiques. Cet engagement se manifeste dans les premiers courts-métrages de Karim Moussaoui dont Ce qu'on doit faire, 2006.
Après avoir épaulé son collègue Tariq Teguia pour Inland, 2008, où il est premier assistant, Karim Moussaoui se fait connaître à l'international en signant Les Jours d'avant, 2013, un moyen-métrage qui suggère l'arrachement de jeunes gens, en cumulant leurs points de vue. Puis il entreprend son premier long-métrage, En attendant les hirondelles, 2017, retenu à la section Un Certain Regard au Festival de Cannes avant d'être présenté et récompensé dans d'autres manifestations à l'étranger.
Karim Moussaoui tisse trois récits successifs pour étoffer son observation sensible de l'Algérie contemporaine. Un homme d'affaires d'Alger n'arrive pas à stabiliser sa relation avec son fils tandis que sa seconde femme, française, veut quitter l'Algérie. Plus au sud, deux amoureux se retrouvent lors d'un trajet en voiture, alors que la fille s'apprête à rejoindre son futur mari pour ses noces. Plus loin, un médecin, désireux de se caser, se voit rappeler son passé par une femme, violée en sa présence par les intégristes.
En filmant ces relations douloureuses, Karim Moussaoui esquisse le portrait d'une Algérie en marche où chacun doit assumer ses positions et ses choix. Son goût pour le pouvoir du cinéma motive une coproduction élargie qui propose de nouvelles perspectives autour de l'Algérie comme il l'explicite posément avec un demi-sourire.
- Que nous révèle le titre que vous avancez : En attendant les hirondelles ?
C'est un titre que j'avais trouvé dès les premières versions du scénario. C'était avant les printemps arabes et moi, je voulais surtout parler du printemps, globalement, dire comment doit être le printemps dans des pays comme l'Algérie. C'est le moment où les individus se rendent dans les endroits où il y a cette harmonie entre la tête et le corps, pour trouver une espèce de bien-être. A ce moment là, je me posais la question du changement. C'était une période assez angoissante pour moi en Algérie, parce que je sentais une espèce d'inertie globale, qui était dans l'air. Il y avait des choses qui se passaient sur le plan politique qui me déplaisaient. Donc j'ai voulu écrire un scénario où je voulais surtout essayer de comprendre un peu le processus du changement, même si je n'ai pas de réponse. J'ai eu envie de parler de comment on se retrouve dans des situations où on est amené à bouger les lignes. Donc en attendant de trouver ce printemps-là, celui des individus, on va raconter ces histoires-là.
- Pourquoi le film est-il composé de plusieurs histoires ?
Je voulais apporter un regard subjectif, mon regard sur un pays qui est le mien, sans rentrer dans une forme de discours qui serait un peu réducteur, un discours qui serait explicatif de ce qui se passe en Algérie. Je m'étais dit qu'en racontant plusieurs histoires - je ne savais pas encore combien j'allais en raconter - et si on traverse plusieurs territoires et qu'on parle de plusieurs générations, peut-être qu'à la fin, on aura l'impression qu'on parle d'un pays. Le faux départ sur la quatrième histoire suggère qu'on pourrait continuer indéfiniment tout en se baladant dans ce pays. Et puis surtout la troisième histoire est liée à une tragédie nationale qui continue à hanter un peu le pays, et qui n'est pas réglée.
- Y a-t-il un point commun aux trois récits traités par le film ?
Pour moi, le point commun ce sont les situations des personnages. Ils arrivent tous à un moment où ils sont allés au bout d'une logique à eux, de leur réalité, et ils n'arrivent plus à faire avec. Ils n'arrivent plus à trouver le bonheur dans le chemin consensuel, le chemin balisé tel qu'ils l'ont trouvé. Ils sont amenés à se poser des questions sur ces choix de vie. Est-ce que ce sont vraiment des choix ? Est-ce qu'il y a possibilité de bouger les lignes ? Est-ce qu'il y a une possibilité de bifurquer, d'aller vers l'inconnu ? Le risque, c'est de perdre ce qui est déjà là, ce qu'on a déjà sous la main. Les trois personnages vivent ces trois situations. Ils ont peur de bouger les lignes parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont déjà, et surtout ils ont peur de l'inconnu. Ils ne savent pas où pourrait les amener un chemin différent. C'est le sentiment que j'avais à l'époque, de la situation globale : on avait peur de prendre des risques. C'est lié à plein de choses d'où le récit sur la période qu'on a appelé la "décennie noire" en Algérie. C'est ça qui a fait aussi que les gens ne prennent plus de risques. Il y a une situation de paix, ce n'est pas l'idéal mais on ne va pas aller chercher plus loin.
- Pourtant dans les trois histoires que vous montrez, il y a une perte de quelque chose…
Forcément, oui. Il y a la perte d'un possible bonheur. Le bonheur est sacrifié et on préfère garder ce qui est sûr même si on n'est pas très heureux avec. Mais ce n'est pas un drame…
Des angles de vue sur l'Algérie
- Vous suggérez dans la première histoire, celle du promoteur immobilier divorcé, qu'il n'y a pas de transmission véritable et qu'il y a une communication difficile entre les générations, celle du père et celle du fils. C'est un problème de société qui touche l'Algérie ?
Oui complètement. C'est mon sentiment, je sens qu'il n'y a pas eu transmission. L'ancienne génération s'est positionnée par rapport à la nouvelle, comme étant la génération de l'indépendance, la génération qui est arrivée pour construire le pays. Comme si finalement, on était incapable de faire mieux. Comme si pour la nouvelle génération, il y avait cette impossibilité d'être meilleur ou d'avancer. Donc forcément il y a une transmission de l'histoire comme on l'a voulu, avec cette génération qui a œuvré pour l'indépendance et puis qui a été à la tête de l'Algérie indépendante, qui a été à la tête de la construction de ce pays. Je crois qu'il y a une volonté de maintenir toute la jeunesse sous le pouvoir de cette génération. Peut-être parce que l'ancienne génération avait peur de perdre justement, cette position de dominant, de héros de la société. Ils avaient peur, peut-être, qu'elle n'ait plus de place dans cette future Algérie. Il n'y a pas eu de transmission de valeurs pour libérer les futures générations de leurs chaînes, pour qu'elles puissent s'émanciper.
- Est-ce pour cela que le couple du deuxième récit, par exemple, où une future mariée regarde avec regret son ancien prétendant, est soumis à la tradition, à ce passé qui réglemente la société ?
Oui, ils sont volontairement soumis, pas au diktat mais à la base morale, au mode de vie, à ce qui est considéré comme étant la voie ultime, la voie possible pour vive dans le bonheur. Cette génération-là est dépendante de cet enseignement de ce qu'est la vie, de ses valeurs, et elle est incapable de s'écouter elle-même, de remettre en question ces valeurs-là. C'est très compliqué parce que autour de soi, il n'y a que ça. Il y a très peu de voies qui proposent autre chose et qui osent défier l'ordre établi. Je parle de l'ordre établi de la culture, de la religion, de la tradition, de ce qui est admis, acceptable.
- Le désir doit-il être auto réprimé dans le cas de ce couple d'anciens amoureux que le mariage de la fille va séparer ?
Oui, complètement. Je pense que la violence que vivent ces personnages a un impact sur une forme de violence qu'on va forcément retrouver dans leur vie. Parce que d'abord ils ne la comprennent pas et puis parce que c'est une violence qu'ils vont porter forcément. On se fait violence pour correspondre à ce qu'on attend de nous et puis on finit par en être persuadé. On s'en accommode bien mais ça finit par être une terrible frustration de ne pas aller là où notre désir nous emmène. Après je ne dis pas qu'on doit rompre forcément avec la tradition, la pensée ancienne, ni que ça convient à tout le monde, mais c'est cet empêchement d'aller vers une nouvelle expérience qui est terrible, que je trouve très frustrant et qui génère de la violence. C'est comme vivre avec une amertume de ne pas avoir réalisé quelque chose, de ne pas être allé jusqu'au bout d'un rêve, d'un désir. Quand on y repense, on est toujours mal quelque part.
- N'est-ce pas un peu le cas de la troisième histoire où le personnage principal qui est un médecin en quête de respectabilité, n'est pas allé jusqu'au bout de son désir d'aider une jeune femme malmenée par les islamistes ?
Oui. Ce que je raconte, c'est qu'il s'est retrouvé dans une situation où peut-être il aurait pu l'aider, ou peut-être pas parce qu'il aurait pu se faire tuer aussi. Mais la question de la responsabilité se pose à lui d'une autre façon. Il considère qu'il n'est pas responsable de ce qui est arrivé à cette femme mais quand elle vient lui demander de l'aide, il ne peut pas ignorer qu'il est responsable à ce moment là. C'est comme quand quelqu'un est en danger, c'est un cas de non assistance à personne en danger. Il ne peut pas dire : "Je n'étais pas au courant, je ne suis pas responsable donc je m'en lave les mains". Elle est venue vers lui parce qu'elle n'a pas d'autre solution. C'est aussi une partie du film qui a un sens très symbolique de ce qui s'est passé dans les années 90, et comment nous réagissons, comment on vit avec ce passé qu'on n'a toujours pas réglé. Le personnage de la troisième histoire, au lieu de regarder les choses en face, va essayer de fuir un peu la situation parce qu'il a aussi quelque chose à perdre. Il a une réputation, et puis il a envie d'oublier cette partie là de sa vie. Il va se marier, il veut s'installer, il est en train de se construire son statut social. Donc cette personne qui débarque du passé arrive et risque de lui gâcher un peu tout. Au lieu d'assumer, de faire quelque chose pour elle, il va essayer d'abord de se convaincre qu'il n'y est pour rien, qu'il n'est pas responsable de son malheur. Et il n'y arrive pas…
- Pensez-vous que l'Algérie est rattrapée par son passé ?
On est toujours rattrapé par le passé. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas grave parce que personne n'est parfait. La question, c'est comment on regarde ce passé là. Comment on le prend en main ou on le laisse encore nous hanter pendant des années, au risque de le passer aux futures générations. On a tous un passé avec lequel on doit vivre et apprendre à vivre. La question est comment on le prend en charge de manière à ce qu'il ne devienne plus un handicap comme une espèce de fantôme qui nous hante, mais plutôt comme un élément qui peut justement nous servir à exorciser ces mauvaises ondes qui nous habitent, et ces pensées qui en découlent.
Une production bien réfléchie
- Comment avez-vous pu inscrire ce film dans la production du cinéma algérien aujourd'hui ?
C'est un film que j'ai d'abord pensé dans une production plus globale et je ne l'ai pas restreint dans une production algérienne. Le fait qu'il y ait des coproducteurs a permis à ce que le film ait plus de chances d'être financé, donc à trouver des financements. Et puis comme Les jours d'avant, mon précédent moyen-métrage, n'a pas été soutenu du côté algérien, j'avais bon espoir que cette fois, ils allaient au minimum m'aider un peu. Je ne sais pas si le film, lorsqu'il a été présenté au sein des commissions, laissait voir toutes les dimensions de ces trois histoires et le lien avec le pays. Je pense que oui, mais peut être pas à ce point, avec cette dimension sur la responsabilité, le choix, qui est abordée.
- Est-ce un gros budget que vous avez pu constituer ?
C'est un film qui a coûté 1 800 000 euros. Pour un premier film, c'est un budget très correct.
- Qui sont vos partenaires ?
Nous avons été soutenus par l'Aide aux Cinémas du Monde, donc le CNC, la chaîne Arte… Il y a eu des coproducteurs comme Ad Vitam, MK2, en France, et le Ministère de la Culture en Algérie... Il y a eu des fonds du Qatar, du Liban, le World Cinema Fund en Allemagne puisqu'on a un coproducteur allemand. Il y a eu Eurimages aussi parmi d'autres soutiens. Donc voilà, il y a eu plusieurs sources de financement. Je pense que c'est un film qui n'aurait pas pu être financé autrement parce que c'est un scénario qui n'était pas évident à défendre. On a commencé par avoir d'abord les fonds du Qatar puis du Liban, et par la suite, sont venus les autres. A chaque fois, il fallait faire en sorte que le projet soit compris et retravailler dans ce sens.
- Sur quoi vous êtes-vous appuyé pour convaincre : le scénario ou la renommée du film précédent, Les jours d'avant ?
Les deux. Je pense que s'il n'y avait pas eu le film précédent, je n'aurais pas pu défendre un film comme celui-là. On aime bien savoir si le réalisateur est capable de mener et de diriger un film comme ça avec trois histoires, avec des situations complexes, donc on a besoin de voir ce qui a été fait avant.
- Le fait que l'Algérie ne puisse pas bénéficier des fonds et des aides attribués aux pays francophones vous a-t-il pénalisé ?
Non, je ne pense pas parce qu'en même temps, il y a d'autres sources de financement. C'est ça qui est magnifique : rien qu'en France, en Allemagne et aussi en Algérie, c'est intéressant de travailler à trois productions établies dans trois pays. Mais ça n'a pas été facile de monter le film financièrement, parce que chaque fois, il fallait aller chercher 50 000 euros par ci, 70 000 euros par là… C'est du travail, beaucoup de dépôts de dossiers mais on le savait bien. On s'était un peu préparé à ça.
- Avez-vous pu avoir les acteurs qu'on voit dans En attendant les hirondelles parce que le budget de la production était suffisant ou les avez-vous choisis avant d'avoir la production ?
Une partie des acteurs a été choisie avant de boucler le financement et en même temps, je ne me souciais pas trop de ça parce que je savais que je ne faisais pas appel à des stars. La seule personne qui était connue à l'international était Aure Atika et j'ai laissé mon producteur gérer ça. Je lui ai dit que je la voulais si c'était possible et puis un jour, il m'appelle et me dit : "C'est bon, elle est d'accord". Donc voilà, j'étais content. Le reste des acteurs sont algériens, certains vivent en France et d'autres en Algérie. Je n'ai pas pris ça en considération. Bien sûr, je n'allais pas faire appel à je ne sais quel acteur qu'on aurait payé 2 millions d'euros pour faire le film. Ça non !
- Pourtant vous employez des acteurs qui ont souvent une certaine épaisseur dans le cinéma algérien. Qu'est-ce qui les a convaincus de vous suivre ?
Oui bien sûr, mes acteurs ont du métier. Alors le fait de prendre des acteurs en Algérie, c'est que ce sont des comédiens que je trouve super et qui ont malheureusement très peu l'occasion d'être vus à l'extérieur. Je sais que le rapport avec eux est différent parce que quand je les vois, on parle de travail, de projet et de cette envie de faire le film. Je sens que la question financière n'est pas tellement posée. C'est quelque chose qui est négociée bien sûr, mais je laisse faire les producteurs. Ce n'est pas la partie la plus compliquée parce qu'il y a ce désir d'abord de faire un film, et je le sens très fort de leur part.
Cultiver les perspectives du doute
- Vous exportez en même temps des images plus rares de l'Algérie. Ce sont des images multiples puisqu‘on part de la ville, on va plus au sud et on voyage. Serait-ce pour établir une sorte de cartographie ?
Oui, complètement. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer aussi un pays qui finalement est un peu comme tous les autres pays. Je voulais montrer sa partie sombre et sa partie joyeuse, belle et rayonnante, la complexité des personnages, les territoires différents, les endroits ordinaires et pas ordinaires. Il y a souvent cette question qui revient chez les journalistes, surtout en Algérie, et on me demande : "Pourquoi vous montrez les poubelles, des immeubles moches ?" J'avais cette envie en tous cas, de tout montrer et je me dis que c'est la seule façon de les accepter, de vivre avec, d'apprendre à les intégrer comme faisant partie d'un décor qui peut être aussi intéressant. Ce n'est pas forcément que négatif parce qu'il y a ce souci de la représentation qu'on trouve beaucoup en Algérie. Très peu d'images sont faites jusqu'à présent selon moi, très peu de films représentent l'Algérie de maintenant. Chaque fois qu'il y a un film comme ça, on dit : "Ah oui, là vous montrez et c'est sale, ce n'est pas beau." Puis quand on montre un film avec des images léchées, bien faites, on dit : "Ah mais ça n'est pas réaliste ça !" Donc on ne sait pas réellement ce qu'on veut. L'objectif, c'était de montrer les choses telles qu'elles sont en étant dans les endroits qu'on peut traverser en faisant une sorte de voyage comme ça, du nord au sud.
- Vous semblez aimer la multiplicité des points de vue. On l'a vu avec Les jours d'avant qui présentait le récit sous des regards différents. Dans En attendant les hirondelles, ce sont des points de vues multiples sur la géographie, les personnages, qu'on remarque. Vous ne faites donc pas confiance à l'histoire plus linéaire d'un seul point de vue, clair, pour faire un film ?
Si, je peux faire confiance à une histoire linéaire mais ce qui est intéressant, c'est que la multiplicité du point de vue permet de relativiser. Ça permet aussi de ne pas avoir ce sentiment de vérité absolue apportée. C'est ça que je crains souvent. Je n'aime pas avoir cette impression qu'on essaie de me délivrer un message et qu'on essaie de me convaincre de quelque chose. C'est là où je deviens méfiant. Ce qui m'intéresse, c'est cette possibilité de ne pas tomber dans le discours, qu'il ne passe plus forcément par la parole mais qu'il passe par des images complètement différentes. Elles vous mettent dans des situations d'avoir cette possibilité de voir quelque chose et son contraire, de la remise en question. Le film est bâti sur ça. Je me suis refusé de me reposer sur quoi que ce soit comme idée affirmée. Au moment où, peut-être, on a l'impression de comprendre quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre pour le remettre en question. La question du mouvement est très importante. Le mouvement, c'est ne pas être sûr tout le temps de quoi que ce soit. C'est pour ça que le film propose ce voyage qui intègre un mouvement physique mais il y a aussi le mouvement intérieur des personnages, le mouvement des événements, des histoires. La question que je me pose c'est : est-ce que j'arriverai à créer ce mouvement là au sein du spectateur ? Est-ce que lui aussi va être déstabilisé, va être amené à bouger intérieurement, à considérer aussi qu'un film ce n'est pas que linéaire, ce n'est pas qu'un récit où tout est balisé ? Je voulais vraiment qu'on se perde dans ce film parce qu'il propose de se perdre. Il raconte l'histoire de personnages qui ont peur de se perdre. Donc formellement je dois défendre cette idée, faire en sorte qu'on se perde nous-mêmes dans le film.
- Est-ce pour cela que vous préférez toujours suggérer même dans les courts-métrages de vos débuts, plutôt qu'appuyer l'action et montrer plus de choses que ce que vous le faites ?
Oui, il y a toujours une manière de suggérer tout en maintenant le point de vue, tout en gardant un point de vue clair. C'est comme si je disais : "Regardez ce qui se passe : qu'est-ce que vous en pensez ? Quelque part n'y a-t-il pas une possibilité d'aller vers cette direction plutôt que vers celle-là qui est plus tranquille ?" Donc il y a une manière de raconter tout en gardant cette distance mais aussi en défendant un point de vue.
- Votre prochain film concernera-t-il aussi l'Algérie ?
Oui, je crois. J'ai deux projets en tête mais je ne sais pas encore pour lequel je vais opter.
- Etes-vous pressé de continuer à réaliser ?
Je n'ai pas les moyens d'être pressé pour le moment. Je m'occupe de la sortie de En attendant les hirondelles et je le suis encore dans des festivals mais je pense au prochain film. J'y pense tout le temps mais je n'écris pas beaucoup. Je prends des notes…
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
Paris, Africiné Magazine
pour Images Francophones
A LIRE : En attendant les hirondelles (la critique du film), par Michel Amarger, sur Africiné Magazine .
Image : Le réalisateur algérien Karim Moussaoui
Crédit : gracieuseté Ad Vitam
Karim Moussaoui fait partie de la génération qui a décidé de réveiller le cinéma en Algérie après la "décennie noire". Il est l'un des fondateurs de l'association Chrysalide, en 2001, avec des réalisateurs complices comme Hassen Ferhani (Dans ma tête un rond-point, 2015), pour animer des séances de ciné-club à Alger, et produire des films en s'affranchissant des contraintes étatiques. Cet engagement se manifeste dans les premiers courts-métrages de Karim Moussaoui dont Ce qu'on doit faire, 2006.
Après avoir épaulé son collègue Tariq Teguia pour Inland, 2008, où il est premier assistant, Karim Moussaoui se fait connaître à l'international en signant Les Jours d'avant, 2013, un moyen-métrage qui suggère l'arrachement de jeunes gens, en cumulant leurs points de vue. Puis il entreprend son premier long-métrage, En attendant les hirondelles, 2017, retenu à la section Un Certain Regard au Festival de Cannes avant d'être présenté et récompensé dans d'autres manifestations à l'étranger.
Karim Moussaoui tisse trois récits successifs pour étoffer son observation sensible de l'Algérie contemporaine. Un homme d'affaires d'Alger n'arrive pas à stabiliser sa relation avec son fils tandis que sa seconde femme, française, veut quitter l'Algérie. Plus au sud, deux amoureux se retrouvent lors d'un trajet en voiture, alors que la fille s'apprête à rejoindre son futur mari pour ses noces. Plus loin, un médecin, désireux de se caser, se voit rappeler son passé par une femme, violée en sa présence par les intégristes.
En filmant ces relations douloureuses, Karim Moussaoui esquisse le portrait d'une Algérie en marche où chacun doit assumer ses positions et ses choix. Son goût pour le pouvoir du cinéma motive une coproduction élargie qui propose de nouvelles perspectives autour de l'Algérie comme il l'explicite posément avec un demi-sourire.
- Que nous révèle le titre que vous avancez : En attendant les hirondelles ?
C'est un titre que j'avais trouvé dès les premières versions du scénario. C'était avant les printemps arabes et moi, je voulais surtout parler du printemps, globalement, dire comment doit être le printemps dans des pays comme l'Algérie. C'est le moment où les individus se rendent dans les endroits où il y a cette harmonie entre la tête et le corps, pour trouver une espèce de bien-être. A ce moment là, je me posais la question du changement. C'était une période assez angoissante pour moi en Algérie, parce que je sentais une espèce d'inertie globale, qui était dans l'air. Il y avait des choses qui se passaient sur le plan politique qui me déplaisaient. Donc j'ai voulu écrire un scénario où je voulais surtout essayer de comprendre un peu le processus du changement, même si je n'ai pas de réponse. J'ai eu envie de parler de comment on se retrouve dans des situations où on est amené à bouger les lignes. Donc en attendant de trouver ce printemps-là, celui des individus, on va raconter ces histoires-là.
- Pourquoi le film est-il composé de plusieurs histoires ?
Je voulais apporter un regard subjectif, mon regard sur un pays qui est le mien, sans rentrer dans une forme de discours qui serait un peu réducteur, un discours qui serait explicatif de ce qui se passe en Algérie. Je m'étais dit qu'en racontant plusieurs histoires - je ne savais pas encore combien j'allais en raconter - et si on traverse plusieurs territoires et qu'on parle de plusieurs générations, peut-être qu'à la fin, on aura l'impression qu'on parle d'un pays. Le faux départ sur la quatrième histoire suggère qu'on pourrait continuer indéfiniment tout en se baladant dans ce pays. Et puis surtout la troisième histoire est liée à une tragédie nationale qui continue à hanter un peu le pays, et qui n'est pas réglée.
- Y a-t-il un point commun aux trois récits traités par le film ?
Pour moi, le point commun ce sont les situations des personnages. Ils arrivent tous à un moment où ils sont allés au bout d'une logique à eux, de leur réalité, et ils n'arrivent plus à faire avec. Ils n'arrivent plus à trouver le bonheur dans le chemin consensuel, le chemin balisé tel qu'ils l'ont trouvé. Ils sont amenés à se poser des questions sur ces choix de vie. Est-ce que ce sont vraiment des choix ? Est-ce qu'il y a possibilité de bouger les lignes ? Est-ce qu'il y a une possibilité de bifurquer, d'aller vers l'inconnu ? Le risque, c'est de perdre ce qui est déjà là, ce qu'on a déjà sous la main. Les trois personnages vivent ces trois situations. Ils ont peur de bouger les lignes parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont déjà, et surtout ils ont peur de l'inconnu. Ils ne savent pas où pourrait les amener un chemin différent. C'est le sentiment que j'avais à l'époque, de la situation globale : on avait peur de prendre des risques. C'est lié à plein de choses d'où le récit sur la période qu'on a appelé la "décennie noire" en Algérie. C'est ça qui a fait aussi que les gens ne prennent plus de risques. Il y a une situation de paix, ce n'est pas l'idéal mais on ne va pas aller chercher plus loin.
- Pourtant dans les trois histoires que vous montrez, il y a une perte de quelque chose…
Forcément, oui. Il y a la perte d'un possible bonheur. Le bonheur est sacrifié et on préfère garder ce qui est sûr même si on n'est pas très heureux avec. Mais ce n'est pas un drame…
Des angles de vue sur l'Algérie
- Vous suggérez dans la première histoire, celle du promoteur immobilier divorcé, qu'il n'y a pas de transmission véritable et qu'il y a une communication difficile entre les générations, celle du père et celle du fils. C'est un problème de société qui touche l'Algérie ?
Oui complètement. C'est mon sentiment, je sens qu'il n'y a pas eu transmission. L'ancienne génération s'est positionnée par rapport à la nouvelle, comme étant la génération de l'indépendance, la génération qui est arrivée pour construire le pays. Comme si finalement, on était incapable de faire mieux. Comme si pour la nouvelle génération, il y avait cette impossibilité d'être meilleur ou d'avancer. Donc forcément il y a une transmission de l'histoire comme on l'a voulu, avec cette génération qui a œuvré pour l'indépendance et puis qui a été à la tête de l'Algérie indépendante, qui a été à la tête de la construction de ce pays. Je crois qu'il y a une volonté de maintenir toute la jeunesse sous le pouvoir de cette génération. Peut-être parce que l'ancienne génération avait peur de perdre justement, cette position de dominant, de héros de la société. Ils avaient peur, peut-être, qu'elle n'ait plus de place dans cette future Algérie. Il n'y a pas eu de transmission de valeurs pour libérer les futures générations de leurs chaînes, pour qu'elles puissent s'émanciper.
- Est-ce pour cela que le couple du deuxième récit, par exemple, où une future mariée regarde avec regret son ancien prétendant, est soumis à la tradition, à ce passé qui réglemente la société ?
Oui, ils sont volontairement soumis, pas au diktat mais à la base morale, au mode de vie, à ce qui est considéré comme étant la voie ultime, la voie possible pour vive dans le bonheur. Cette génération-là est dépendante de cet enseignement de ce qu'est la vie, de ses valeurs, et elle est incapable de s'écouter elle-même, de remettre en question ces valeurs-là. C'est très compliqué parce que autour de soi, il n'y a que ça. Il y a très peu de voies qui proposent autre chose et qui osent défier l'ordre établi. Je parle de l'ordre établi de la culture, de la religion, de la tradition, de ce qui est admis, acceptable.
- Le désir doit-il être auto réprimé dans le cas de ce couple d'anciens amoureux que le mariage de la fille va séparer ?
Oui, complètement. Je pense que la violence que vivent ces personnages a un impact sur une forme de violence qu'on va forcément retrouver dans leur vie. Parce que d'abord ils ne la comprennent pas et puis parce que c'est une violence qu'ils vont porter forcément. On se fait violence pour correspondre à ce qu'on attend de nous et puis on finit par en être persuadé. On s'en accommode bien mais ça finit par être une terrible frustration de ne pas aller là où notre désir nous emmène. Après je ne dis pas qu'on doit rompre forcément avec la tradition, la pensée ancienne, ni que ça convient à tout le monde, mais c'est cet empêchement d'aller vers une nouvelle expérience qui est terrible, que je trouve très frustrant et qui génère de la violence. C'est comme vivre avec une amertume de ne pas avoir réalisé quelque chose, de ne pas être allé jusqu'au bout d'un rêve, d'un désir. Quand on y repense, on est toujours mal quelque part.
- N'est-ce pas un peu le cas de la troisième histoire où le personnage principal qui est un médecin en quête de respectabilité, n'est pas allé jusqu'au bout de son désir d'aider une jeune femme malmenée par les islamistes ?
Oui. Ce que je raconte, c'est qu'il s'est retrouvé dans une situation où peut-être il aurait pu l'aider, ou peut-être pas parce qu'il aurait pu se faire tuer aussi. Mais la question de la responsabilité se pose à lui d'une autre façon. Il considère qu'il n'est pas responsable de ce qui est arrivé à cette femme mais quand elle vient lui demander de l'aide, il ne peut pas ignorer qu'il est responsable à ce moment là. C'est comme quand quelqu'un est en danger, c'est un cas de non assistance à personne en danger. Il ne peut pas dire : "Je n'étais pas au courant, je ne suis pas responsable donc je m'en lave les mains". Elle est venue vers lui parce qu'elle n'a pas d'autre solution. C'est aussi une partie du film qui a un sens très symbolique de ce qui s'est passé dans les années 90, et comment nous réagissons, comment on vit avec ce passé qu'on n'a toujours pas réglé. Le personnage de la troisième histoire, au lieu de regarder les choses en face, va essayer de fuir un peu la situation parce qu'il a aussi quelque chose à perdre. Il a une réputation, et puis il a envie d'oublier cette partie là de sa vie. Il va se marier, il veut s'installer, il est en train de se construire son statut social. Donc cette personne qui débarque du passé arrive et risque de lui gâcher un peu tout. Au lieu d'assumer, de faire quelque chose pour elle, il va essayer d'abord de se convaincre qu'il n'y est pour rien, qu'il n'est pas responsable de son malheur. Et il n'y arrive pas…
- Pensez-vous que l'Algérie est rattrapée par son passé ?
On est toujours rattrapé par le passé. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas grave parce que personne n'est parfait. La question, c'est comment on regarde ce passé là. Comment on le prend en main ou on le laisse encore nous hanter pendant des années, au risque de le passer aux futures générations. On a tous un passé avec lequel on doit vivre et apprendre à vivre. La question est comment on le prend en charge de manière à ce qu'il ne devienne plus un handicap comme une espèce de fantôme qui nous hante, mais plutôt comme un élément qui peut justement nous servir à exorciser ces mauvaises ondes qui nous habitent, et ces pensées qui en découlent.
Une production bien réfléchie
- Comment avez-vous pu inscrire ce film dans la production du cinéma algérien aujourd'hui ?
C'est un film que j'ai d'abord pensé dans une production plus globale et je ne l'ai pas restreint dans une production algérienne. Le fait qu'il y ait des coproducteurs a permis à ce que le film ait plus de chances d'être financé, donc à trouver des financements. Et puis comme Les jours d'avant, mon précédent moyen-métrage, n'a pas été soutenu du côté algérien, j'avais bon espoir que cette fois, ils allaient au minimum m'aider un peu. Je ne sais pas si le film, lorsqu'il a été présenté au sein des commissions, laissait voir toutes les dimensions de ces trois histoires et le lien avec le pays. Je pense que oui, mais peut être pas à ce point, avec cette dimension sur la responsabilité, le choix, qui est abordée.
- Est-ce un gros budget que vous avez pu constituer ?
C'est un film qui a coûté 1 800 000 euros. Pour un premier film, c'est un budget très correct.
- Qui sont vos partenaires ?
Nous avons été soutenus par l'Aide aux Cinémas du Monde, donc le CNC, la chaîne Arte… Il y a eu des coproducteurs comme Ad Vitam, MK2, en France, et le Ministère de la Culture en Algérie... Il y a eu des fonds du Qatar, du Liban, le World Cinema Fund en Allemagne puisqu'on a un coproducteur allemand. Il y a eu Eurimages aussi parmi d'autres soutiens. Donc voilà, il y a eu plusieurs sources de financement. Je pense que c'est un film qui n'aurait pas pu être financé autrement parce que c'est un scénario qui n'était pas évident à défendre. On a commencé par avoir d'abord les fonds du Qatar puis du Liban, et par la suite, sont venus les autres. A chaque fois, il fallait faire en sorte que le projet soit compris et retravailler dans ce sens.
- Sur quoi vous êtes-vous appuyé pour convaincre : le scénario ou la renommée du film précédent, Les jours d'avant ?
Les deux. Je pense que s'il n'y avait pas eu le film précédent, je n'aurais pas pu défendre un film comme celui-là. On aime bien savoir si le réalisateur est capable de mener et de diriger un film comme ça avec trois histoires, avec des situations complexes, donc on a besoin de voir ce qui a été fait avant.
- Le fait que l'Algérie ne puisse pas bénéficier des fonds et des aides attribués aux pays francophones vous a-t-il pénalisé ?
Non, je ne pense pas parce qu'en même temps, il y a d'autres sources de financement. C'est ça qui est magnifique : rien qu'en France, en Allemagne et aussi en Algérie, c'est intéressant de travailler à trois productions établies dans trois pays. Mais ça n'a pas été facile de monter le film financièrement, parce que chaque fois, il fallait aller chercher 50 000 euros par ci, 70 000 euros par là… C'est du travail, beaucoup de dépôts de dossiers mais on le savait bien. On s'était un peu préparé à ça.
- Avez-vous pu avoir les acteurs qu'on voit dans En attendant les hirondelles parce que le budget de la production était suffisant ou les avez-vous choisis avant d'avoir la production ?
Une partie des acteurs a été choisie avant de boucler le financement et en même temps, je ne me souciais pas trop de ça parce que je savais que je ne faisais pas appel à des stars. La seule personne qui était connue à l'international était Aure Atika et j'ai laissé mon producteur gérer ça. Je lui ai dit que je la voulais si c'était possible et puis un jour, il m'appelle et me dit : "C'est bon, elle est d'accord". Donc voilà, j'étais content. Le reste des acteurs sont algériens, certains vivent en France et d'autres en Algérie. Je n'ai pas pris ça en considération. Bien sûr, je n'allais pas faire appel à je ne sais quel acteur qu'on aurait payé 2 millions d'euros pour faire le film. Ça non !
- Pourtant vous employez des acteurs qui ont souvent une certaine épaisseur dans le cinéma algérien. Qu'est-ce qui les a convaincus de vous suivre ?
Oui bien sûr, mes acteurs ont du métier. Alors le fait de prendre des acteurs en Algérie, c'est que ce sont des comédiens que je trouve super et qui ont malheureusement très peu l'occasion d'être vus à l'extérieur. Je sais que le rapport avec eux est différent parce que quand je les vois, on parle de travail, de projet et de cette envie de faire le film. Je sens que la question financière n'est pas tellement posée. C'est quelque chose qui est négociée bien sûr, mais je laisse faire les producteurs. Ce n'est pas la partie la plus compliquée parce qu'il y a ce désir d'abord de faire un film, et je le sens très fort de leur part.
Cultiver les perspectives du doute
- Vous exportez en même temps des images plus rares de l'Algérie. Ce sont des images multiples puisqu‘on part de la ville, on va plus au sud et on voyage. Serait-ce pour établir une sorte de cartographie ?
Oui, complètement. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer aussi un pays qui finalement est un peu comme tous les autres pays. Je voulais montrer sa partie sombre et sa partie joyeuse, belle et rayonnante, la complexité des personnages, les territoires différents, les endroits ordinaires et pas ordinaires. Il y a souvent cette question qui revient chez les journalistes, surtout en Algérie, et on me demande : "Pourquoi vous montrez les poubelles, des immeubles moches ?" J'avais cette envie en tous cas, de tout montrer et je me dis que c'est la seule façon de les accepter, de vivre avec, d'apprendre à les intégrer comme faisant partie d'un décor qui peut être aussi intéressant. Ce n'est pas forcément que négatif parce qu'il y a ce souci de la représentation qu'on trouve beaucoup en Algérie. Très peu d'images sont faites jusqu'à présent selon moi, très peu de films représentent l'Algérie de maintenant. Chaque fois qu'il y a un film comme ça, on dit : "Ah oui, là vous montrez et c'est sale, ce n'est pas beau." Puis quand on montre un film avec des images léchées, bien faites, on dit : "Ah mais ça n'est pas réaliste ça !" Donc on ne sait pas réellement ce qu'on veut. L'objectif, c'était de montrer les choses telles qu'elles sont en étant dans les endroits qu'on peut traverser en faisant une sorte de voyage comme ça, du nord au sud.
- Vous semblez aimer la multiplicité des points de vue. On l'a vu avec Les jours d'avant qui présentait le récit sous des regards différents. Dans En attendant les hirondelles, ce sont des points de vues multiples sur la géographie, les personnages, qu'on remarque. Vous ne faites donc pas confiance à l'histoire plus linéaire d'un seul point de vue, clair, pour faire un film ?
Si, je peux faire confiance à une histoire linéaire mais ce qui est intéressant, c'est que la multiplicité du point de vue permet de relativiser. Ça permet aussi de ne pas avoir ce sentiment de vérité absolue apportée. C'est ça que je crains souvent. Je n'aime pas avoir cette impression qu'on essaie de me délivrer un message et qu'on essaie de me convaincre de quelque chose. C'est là où je deviens méfiant. Ce qui m'intéresse, c'est cette possibilité de ne pas tomber dans le discours, qu'il ne passe plus forcément par la parole mais qu'il passe par des images complètement différentes. Elles vous mettent dans des situations d'avoir cette possibilité de voir quelque chose et son contraire, de la remise en question. Le film est bâti sur ça. Je me suis refusé de me reposer sur quoi que ce soit comme idée affirmée. Au moment où, peut-être, on a l'impression de comprendre quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre pour le remettre en question. La question du mouvement est très importante. Le mouvement, c'est ne pas être sûr tout le temps de quoi que ce soit. C'est pour ça que le film propose ce voyage qui intègre un mouvement physique mais il y a aussi le mouvement intérieur des personnages, le mouvement des événements, des histoires. La question que je me pose c'est : est-ce que j'arriverai à créer ce mouvement là au sein du spectateur ? Est-ce que lui aussi va être déstabilisé, va être amené à bouger intérieurement, à considérer aussi qu'un film ce n'est pas que linéaire, ce n'est pas qu'un récit où tout est balisé ? Je voulais vraiment qu'on se perde dans ce film parce qu'il propose de se perdre. Il raconte l'histoire de personnages qui ont peur de se perdre. Donc formellement je dois défendre cette idée, faire en sorte qu'on se perde nous-mêmes dans le film.
- Est-ce pour cela que vous préférez toujours suggérer même dans les courts-métrages de vos débuts, plutôt qu'appuyer l'action et montrer plus de choses que ce que vous le faites ?
Oui, il y a toujours une manière de suggérer tout en maintenant le point de vue, tout en gardant un point de vue clair. C'est comme si je disais : "Regardez ce qui se passe : qu'est-ce que vous en pensez ? Quelque part n'y a-t-il pas une possibilité d'aller vers cette direction plutôt que vers celle-là qui est plus tranquille ?" Donc il y a une manière de raconter tout en gardant cette distance mais aussi en défendant un point de vue.
- Votre prochain film concernera-t-il aussi l'Algérie ?
Oui, je crois. J'ai deux projets en tête mais je ne sais pas encore pour lequel je vais opter.
- Etes-vous pressé de continuer à réaliser ?
Je n'ai pas les moyens d'être pressé pour le moment. Je m'occupe de la sortie de En attendant les hirondelles et je le suis encore dans des festivals mais je pense au prochain film. J'y pense tout le temps mais je n'écris pas beaucoup. Je prends des notes…
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
Paris, Africiné Magazine
pour Images Francophones
A LIRE : En attendant les hirondelles (la critique du film), par Michel Amarger, sur Africiné Magazine .
Image : Le réalisateur algérien Karim Moussaoui
Crédit : gracieuseté Ad Vitam
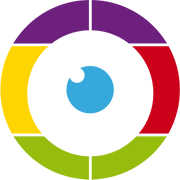 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images