Entretien avec Imunga Ivanga, Directeur de l’Institut Gabonais de l'Image et du Son

"Ce sont les salles et la télévision qui doivent susciter le besoin de films africains"
Réalisateur et scénariste diplômé de la FEMIS (Paris), Imunga Ivanga est, depuis septembre 2009, le Directeur Général de l’Institut Gabonais de l’Image et du Son (IGIS). En marge du FESPACO 2011 (Ouagadougou), le nouveau patron du cinéma gabonais nous a accordé un entretien dont voici un extrait (voir l’intégralité sur Africiné).
Qu’implique le changement de statut de Centre national du Cinéma (CENACI) à Institut du Cinéma - IGIS) ?
Les autorités publiques ont souhaité coller à l’évolution des technologies actuelles. Dans la mesure où les frontières entre les métiers classiques du cinéma et de l’audiovisuel sont aujourd’hui quasiment indistincts. Et je crois que c’est lié quelque part à la démocratisation des outils de production et de diffusion qui font d’ailleurs apparaître de nouveaux auteurs, pour ne pas dire autre chose.
C’est en prenant compte de ces paramètres que le Centre du Cinéma est devenu un Institut de Cinéma.
Cependant, les missions classiques de l’ex Centre National du Cinéma (CENACI) sont préservées, à savoir la production et la promotion du cinéma gabonais. À cela s’ajoute une nouvelle mission qui est celle de la formation qui, dans un premier temps, ne sera pas continue mais plutôt sous la forme d’ateliers spécifiques d’apprentissage aux métiers du cinéma.
Cela suppose que l’institut a un programme de formation ? C’est connecté à l’univers de formation professionnelle ou universitaire au Gabon ?
Nous sommes plutôt dans un schéma de formation professionnelle. Ça veut dire que nous allons travailler avec des personnes qui ont déjà une expérience et dont on va renforcer les capacités. Dans une phase de moyen et long terme, il y a de toutes les façons des connections qui sont faites avec l’université et pas avec des établissements secondaires ; uniquement avec des universités. La jonction de ces apports nous permettra, déjà au plan local, d’avoir des personnes qui auront une formation de base minimum, des professionnels aguerris.
Est-ce qu’il y avait dans les missions de l'ancien CENACI la dimension législative, comme en France (avec le Centre National de la Cinématographie, CNC) ? C'est-à-dire proposer des lois, intervenir au niveau de la spécification technique des salles. [..] Quid du nouvel Institut ?
La difficulté avec le CENACI (créé en 1975), c'est qu'il est resté durant trente-cinq ans juste avec une ordonnance. Il y avait une sorte de caducité par rapport à cela. Car, lorsqu’il y a une ordonnance, la loi doit être votée la même année à l’Assemblée Nationale et au Sénat ; ce qui a été fait dans le cadre de l'IGIS. Cette dimension législative devrait faire partie de nos missions. On a plus ou moins inscrit ça, mais la réalité du terrain est quand même différente.
D’abord l’existence des salles de cinéma aujourd’hui est réduite à quelque chose de très infime. On a plus qu’une salle de cinéma qui sert davantage à des églises de réveil. Et puis, comme dans un certain nombre de pays, nous avons l’espace du Centre Culturel Français ; mais c'est un espace polyvalent qui accueille à la fois des films, des pièces de théâtre et des concerts. Donc, il est important de réfléchir sur comment réhabiliter les anciennes salles, ou les racheter, ou aussi penser à également en construire de nouvelles. Sans reproduire évidemment l'idée des multiplexes, il faut essayer de tenir des spécificités, des comportements, des habitudes des gens, être inventifs à ce niveau-là pour les ramener vers le cinéma. Ce n’est pas facile.
Effectivement, autant l'État doit pouvoir se ré-impliquer, autant il faut intéresser des acteurs privés. La ville s'étend, il y a des quartiers qui aujourd'hui sont vraiment à l'opposé du centre-ville, mais avec des populations importantes. On ne peut plus se contenter de concentrer les salles uniquement dans le centre-ville. Donc je pense que s’il y a des promoteurs qui s'engagent dans la construction de ces salles-là, en créant un environnement attractif, ils devraient pouvoir quand même rentrer dans leur investissement.
Après, bien sûr, il y a un travail à faire aussi auprès des chaînes de télévision – on en a un certain nombre. Cela n’est pas spécifique au Gabon. Il faudra aussi que ces télévisions soient plus généreuses dans la mesure elles font des barterings pour obtenir de diffuser des télénovelas tout azimut. En contrepartie, elles cèdent des espaces publicitaires ; donc en général les télénovelas qu'elles diffusent coûtent deux à trois fois plus cher que leur valeur réelle. On pourrait très bien imaginer que ces télévisions-là achètent, sous forme de package, un certain nombre d'œuvres produites par des réalisateurs de différents pays africains et les proposent à leur public.
Souvent on me dit « oui, mais les Africains ils n’aiment pas, ils ne regardent pas les films africains ». Je trouve ça totalement erroné, parce qu’il n'y a pas de statistiques déjà. Ensuite, on le voit dans nos différents festivals qu'il s'agisse du FESPACO ou des Escales Documentaires de Libreville ou des Journées Cinématographiques à Carthage, que les salles sont pleines, je suis désolé. Donc cela veut dire qu'il y a une demande; il y a une attente. Il faut pouvoir la satisfaire.
Ce n'est pas le public qui fait le goût. C'est celui qui a la télévision, celui qui a la salle, qui va commander et qui va susciter le besoin.
Donc, je pense que cela relève plus d'une paresse, je crois, ou d'habitudes qui sont ancrées, de ne pas vouloir considérer les choses autrement. C'est une piste que je suggère ; je pense qu’il y en a d’autres. C’est une piste qui peut être exploitée. Ces espaces publicitaires sont occupés par des maisons de téléphonie mobiles ou bien de grands magasins qui peuvent tout à fait acheter nos programmes qui coûteraient pas forcément plus cher. C'est aussi cela, si on veut essayer de renforcer une identité au niveau du continent. Dans la mesure où, en termes de représentation, lorsque les gens grandissent, lorsqu'ils sont attirés par des modèles qui viennent d'ailleurs, il y a un problème d'identité quand même qui se pose fondamentalement.
Ce qui est bien aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le Maghreb [révolutions en Tunisie, Égypte, Lybie]. On voit bien qu'on a des révolutions qui ne sont importées, comme avec certains de nos aînés qui sont revenus d'Europe et qui y ont vécu mai 68, ou qui ont été formés sous le communisme ou tout ce qui est lié à l’influence politique. Cela n'a jamais marché ce qu’ils ont essayé d'appliquer, parce qu’ils n'ont pas forcément intégré les réalités locales.
Donc ce n'est pas seulement un discours, il y a une réalité des attentes. Et tout ça part d'une identité, à mon avis, sur laquelle on se repose, sur qui on est, d'où on vient et comment on veut se construire par la suite. On est tous fatigués d’être à la traîne, car on sait tout le potentiel qu’a ce continent et c’est tout à fait légitime de vouloir voir, de vouloir essayer de se définir autrement que ce les autres veulent que nous soyons, ce qui n’est pas la même chose.
Vous parlez de la dimension continentale, cela pose la question de la coordination (ou pas) entre organisations cinématographiques africaines. Est-ce qu’il y a des choses qui ont été ébauchées dans ce sens ? […]
Pour prolonger la question : à cette édition, le FESPACO invite les écoles de cinéma du continent. Est-ce que le Gabon a été invité ? Est-ce que cet institut gabonais est perçu comme une école de formation ?
Je n’ai pas eu d’invitation de la part l’ISIS. Mais j’ai envie de dire que nous ne sommes pas une école de cinéma, au sens classique. J’ai dit tout à l’heure quelles sont les missions que nous avons. Je crois qu’il y a une réflexion qui est perpétuelle. Mon premier Fespaco date d’il y a quinze ans et le problème de la coordination entre Africains se posait déjà. Nous sommes en 2011, et nous vieillissons maintenant. À l’époque, les Aînés c’étaient les pères Sembène, Djibril Diop, Souleymane Cissé, après c’était la génération de [Gaston] Kaboré, Idrissa [Ouédraogo]. Aujourd’hui c’est nous : Bekolo, Imunga, Haroun, voilà quoi.
On n’a pas encore trouvé le chemin, malheureusement. Ce n’est pas pour autant que la réflexion ne doit pas se poursuivre.
La FEPACI [Fédération Panafricaine des Cinéastes] a initié une opération de soutien à la production et à la diffusion. Malheureusement les États n’ont pas toujours suivi. Des propositions ont été faites par l’Algérie qui a mis pas mal d’argent durant le PANAF. Je pense qu’il ne faut pas s’arrêter. Il faut persévérer. Il faut que l’Union Africaine – et ça c’est l’aspect politique – puisse vraiment se réapproprier ce projet de soutien au cinéma. Parce que la FEPACI s’est appuyée en termes d’études, sur l’expérience de l’OIF [Organisation Internationale de la Francophonie] ; ce n’est pas pour autant que l’Union Africaine doit avoir une distance par rapport à ce projet. Parce que c’est elle qui peut, à mon avis, véritablement interpeller, impliquer, les États de notre continent. C’est aussi ça son rôle quelque part. D’autant plus que je crois que nous avions une commission de cinéma là-dedans …
…une commission des Arts.
Oui, des Arts. Donc, qu’elle joue pleinement son rôle. C’est aussi ce que l’on voudra faire, nous. Après, il y a des initiatives individuelles. On sait aujourd’hui quelle est l’expérience de la Tunisie, du Maroc ou du Nigéria qui est totalement différente de l’Afrique du Sud. On oublie toujours – et je ne sais pas pourquoi – l’Égypte qui est pionnière quand même, elle a fait des films moins de dix ans après l’invention du cinéma. Donc l’Égypte a une très forte expérience, une très grande expertise.
Je crois qu’il faut des pays comme ça qui tirent les autres, au-delà des égos et des égoïsmes, à la fois des individus et des États. C’est quelle chose qu’il faut surmonter. Ce n’est pas évident, je crois que si les choses étaient simples ce serait fait depuis. Ce n’est pas la volonté qui manque ; ce qui manque c’est à un moment donné d’avoir des hommes, dans tous ces différents pays, capables d’abnégation, ayant des forces de persuasion auprès des politiques. Il faut que dans chaque pays, il y ait des dynamiques individuelles fortes mais qui sachent également s’imbriquer dans une initiative collective, communautaire, à l’échelle du continent. C’est une machinerie qui va de pair. L’expérience du Maroc est là : ils sont construits des salles, ils font plus de films qu’il y a trente-cinq ans. Il y a d’autres pays.
Nous, dans le cadre du Gabon, on n’a pas le même tissu industriel au niveau du cinéma, mais on pourrait très bien. D’ailleurs je pense que peut-être qu’il faudrait qu’on théorise moins sur cette question. Dans la mesure où vous prenez une personne comme Sembène Ousmane, sans se poser trop de questions il a fait ses films sans attendre forcément un fonds venant de quelque part. C’est aussi ça, c’est une attitude de liberté, d’état d’esprit. Qu’est-ce qu’on veut faire ? Est-ce que j’attends un an, deux ans, ou bien est-ce que je m’adapte ? Et tant pis si j’ai pas les sous, tant pis si je n’ai pas une lumière magnifique, mais j’aurai une belle histoire quand même. J’aurai une histoire forte et c’est ça qui reste.
Car un film, on va le regarder même si on voit la perche dans l’écran, même si le son est mauvais, même si l’image est mauvaise, une fois qu’on a identifié ces défauts, on reste pour cette histoire qui est racontée. Parce qu’il y a des trajectoires de personnages qui peuvent vous interpeller. Cela permet de rencontrer l’univers d’un auteur, de découvrir un pays, de découvrir les problèmes, les préoccupations de ce pays-là. Ou tout simplement les angoisses, les tourments d’un auteur qu’il donne en partage. Et ça, c’est magnifique aussi.
Il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous amener à comprendre que jusqu’à maintenant les Africains se sont trompés de chemin. On a toujours pensé à l’urgence de la production et on n’a jamais envisagé la chose à l’envers peut-être. Cela peut-être une solution de penser d’abord au marché avant de produire. Et si on arrive à distribuer (la distribution, la diffusion peut importe, quelle que soit la forme que cela peut prendre : DVD, télévision, cinéma, peu importe), cela peut financer, si ce n’est pas entièrement, au moins aider à financer, la production. Qu’est-ce que vous en pensez ?
De toute façon, le marché n’a de sens que s’il y a une offre ; quand la production est là. Initialement, il y a la production, le développement de projets qui immédiatement conduisent à une production. Moi je pense que peut-être nous nous formalisons, nous sommes encore trop formalistes sur les choses. Okay, il y a un problème avec les salles. J’évoquais tout à l’heure l’engagement que la télévision pourrait avoir et qu'elle n'a pas, parce qu’elle opère des choix. Je veux dire qu’aujourd’hui des salles de cinéma, il n'y en a pas partout, mais il y a la télévision comme nouvelle réalité, car les gens se retrouvent à plusieurs pour la regarder chez nous, que l'on soit dans une ville ou dans une zone rurale. C'est quand même un outil qui a pénétré nos espaces quels qu'ils soient. Donc, c’est un outil qui doit être réellement investi.
On voit bien que dans l'appropriation des espaces donnés par cet outil, nous sommes très peu représentés en fait. Je ne pense pas que cela soit quelque chose qui soit difficile à surmonter. C'est d’abord une question d'état d'esprit, de volonté. Ils peuvent acheter un film africain à cinq cents mille francs ou un million. Mais le film s'il est repris plusieurs fois, on rebondit. Après tout quel tarif offrent les chaînes de télévision européennes quand elles achètent (pas quand elles sont dans la coproduction)? Elles offrent deux millions, un million cinq cents. Le montant n'est pas ce qui empêcherait une télévision, un Etat africain de le faire. Donc, c'est une question de volonté, de désir de faire, d'avoir une cohérence aussi sur le fait que nous sommes un continent, mais un continent qui a plusieurs identités, des identités qui se croisent, qui malgré tout avancent ensemble et qui doivent apprendre à mieux se connaître. Il y a des pistes qui peuvent relever de la musique, de la politique, etc...
Mais il y a le cinéma pour ce qui nous intéresse nous. Donc c'est quelque chose qui peut figurer dans les priorités. Maintenant, je rajoute ceci : même s'il y a des difficultés techniques, j'envisage fortement la vente de films par téléchargement, en utilisant le web. Parce que c'est notre technologie aujourd'hui, c'est notre temps et il ne faut pas s'en priver. Maintenant, après on est confronté à des questions de débit etc..., mais il est évident que ce n'est pas quelque chose qui va résoudre les problèmes de diffusion, mais ce sera un apport à côté de la télévision, des salles qui existeront, à côté de l'édition en DVD. C'est tout cela qu'il faut attaquer de front.
Je crois qu'un film africain, lorsqu'il est bon (et même lorsqu'il manque de rigueur), il trouve toujours son public. Donc le public il est là. Toute cette campagne pour dire que les Africains n'aiment pas leurs cinémas, moi je n’y adhère pas, je n'y crois pas. Tout à l'heure, on a eu un échange avec Ramadan [Suleman, cinéaste sud-africain, ndrl] et il disait qu'il y a des films qui sont célébrés par l'Occident mais ces mêmes films, ils n’en veulent pas, ils ne les diffusent pas chez eux. C'est bien que nous mêmes puissions mettre nos notes d’experts, en déterminant nos choix, nos priorités, en nous cassant la figure si besoin, en nous relevant, en avançant. Les solutions ne sont pas forcément immédiates ; elles seraient là qu'on n’en parlerait pas. Mais il faut le faire, il faut le faire.
[…]
On évoque la question des séries au Fespaco ; est-ce qu’on n’a pas l’impression que nous sommes à un moment où il faut comprendre qu’on a une certaine vision qui date ? Et le Fespaco est un festival qui date, comme les JCC, comme les anciens festivals : Le Caire, …
…comme Cannes.
Oui, tout à fait. Le Fespaco maintenant, comme beaucoup de festivals, il grandit et devient incontrôlable. La fiction, le documentaire, la vidéo télé, les séries, cela devient un peu trop spécialisé. Apparemment le Fespaco n’a pas le moyen de supporter tout ce poids là. Il est peut-être temps de réfléchir, peut-être, à un concept de libérer un peu les genres, d’aérer un peu et de réfléchir à de nouvelles formes de promotion, de formation et de rencontres des professionnels. Quelles seraient les solutions ?
Je pense aussi sur les problèmes qui sont constatés dans l’organisation du Fespaco, dans l’esprit même des choses qui sont proposées, ce qui serait bien c’est qu’en priorité, les acteurs, les créatifs et tous ceux qui contribuent à faire exister le cinéma soient consultés. Qu’ils soient consultés réellement, et cela sans détour, de se dire que ce n’est pas une affaire d’individus, d’un état, c’est un festival qui, d’un point de vue affectif, voilà, il y a différents festivals sur la planète mais c’est à Ouaga que l'on se retrouve tous. C’est un temps de rencontres. Les uns et les autres sont dans un temps de création. Naturellement il faut arrêter. Entendre aussi qu’il y a des propositions qui sont faites par d’autres acteurs, par d’autres pays pour améliorer. Maintenant, le Fespaco grandit mais c’est naturel.
Les outils de production changent sont nouveaux et grandissent aussi. Affolement de la création tout azimut. On fait des films avec des appareils photo, les Canon. Mais ce n’est pas tant l’appareil. La création ce n’est pas l’outil, c’est ce que l’on a à proposer, ce qu’on a dire, comment il faut le dire à qui il faut le dire, avec quels moyens ? C'est-à-dire que cela fait plusieurs choses c’est vrai. Le temps à ce moment là peut s’avérer court en termes de diversité des offres aujourd’hui. C’est pourquoi ils ont des problèmes. Quelqu’un qui utilise un outil, cela relève du fait de mettre en valeur des choses. On peut imaginer qu’on peut le faire pour la vidéo, etc… Un certain nombre de films sont faits en vidéo, quand ils arrivent dans certains festivals, ils ne sont pas pris avec le même prestige qu’en argentique. Du coup, les gens deviennent réfractaires et globalement. On a un genre de système équivoque et on est un peu schizo.
Mais, on peut effectivement se poser cette question là. Mais si naturellement le Fespaco n’arrive pas à répondre à cette question, il y aura peut-être des solutions qui naîtront d’elles-mêmes, ici ou ailleurs.
Une question sur le système de production de la série Pango et Wally (produite par l’IGIS) : le fait de prendre des acteurs et techniciens, les enfermer dans une maison pendant un certain temps, avec un certain budget. Qu’est-ce qui a conduit à ce choix de production ? Quel a été le budget ? Cela a pris combien de temps ?
Il y a eu pour Pango et Wally un moment assez long pour l’écriture. J’en ai eu l’idée, j’ai pris quelqu’un, Francis, comme dialoguiste. Je trouve que c’est quelqu’un qui a des trouvailles ; il faut très peu repasser derrière pour ajuster certaines choses. Ce n’est pas quelqu’un du cinéma ni du théâtre, en tant que tel. Il faisait des choses originales. Il est bien rentré dans l’esprit de ce que je voulais donc cela été une vraie collaboration.
Maintenant j’étais confronté à une question pratique. Je n’avais pas un équipement qui me permettait de faire une grosse production en extérieur, mais j’avais de quoi faire un tournage en, intérieur. De même en termes d’équipement son, je n’avais pas de quoi capter 10 protagonistes, mais j’en avais assez pour deux ou quatre personnages. J’ai décidé de travailler avec ça, de privilégier à la base le scénario.
Ensuite pouvoir concentrer sur un lieu, dans le même lieu et l’équipe. C’est un lieu qui était très bien, nous avions le décor un espace pour le tournage, la restauration, le maquillage, le repos des comédiens, la production ; c’était le truc l’idéal. Donc, cela me permettait de faire une économie, en termes de coûts, réellement importante. Et de créer la tension dans cette espèce de vigilance quelque part permanente à la fois des techniciens et des comédiens, parce qu’il y a toujours des relâchements. Les épisodes (de 5 min) ont été tournés en 30 jours, donc en raison de un épisode par jour. C’est ce que nous avons fait. Après, j’ai explosé mon budget (rires).
Quel budget ?
On est dans la soixantaine de millions de francs CFA. Si vous convertissez en euros, je ne sais pas ce que ça donne précisément [environ 100.000 euros, ndlr].
Propos recueillis par
Hassouna Mansouri et Thierno Ibrahima Dia
Africiné / Hotel Azalaï, Ouagadougou, 2011.
Bartering : littéralement « échange de marchandise ». Contre le financement de la diffusion d’une série, la télévision fait de la publicité pour la marque qui finance le programme : sa publicité est diffusée avant et après.
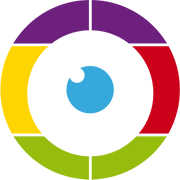 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images