Entretien avec François Woukoache : nouveau regard sur le Rwanda

Ntarabana, son dernier film de sa trilogie autour du génocide au Rwanda (ayant débuté il y a 24 ans jour pour jour), est diffusé. Le cinéaste est présent à 2 pojections à Bruxelles.
Le Camerounais François Woukoache clôt une trilogie sur les échos du génocide rwandais avec Ntarabana. Un documentaire engagé et poétique sur la réconciliation. Positif et opportun. Depuis ses premiers films, François Woukoache travaille sur la mémoire et la résilience. Mélina, 1992, réfléchissait un rituel de deuil, Asientos, 1995, les traces de l'esclavage. Après un détour par la fiction pour Fragments de vie, 1998, le cinéaste s'est investi dans l'introspection et le dépassement du génocide rwandais auquel il a consacré plusieurs documentaires. Le dernier, Ntarabana, 2017, s'impose comme une évocation humaniste et lyrique de la réconciliation.
Le film prend appui sur le génocide des Tutsis et les massacres de Hutus modérés qui ont fait un million de morts au Rwanda, en 1994. Durant cette tragédie, des citoyens ont pris la responsabilité de cacher et de protéger des Tutsis. Parmi eux, Froduald Rugwiza et Anne-Marie Mukankundiye témoignent de la manière dont ils ont sauvé des Tutsis tandis qu'une rescapée, Anastasie Murekaze, explique comment elle a pu pardonner et de se réconcilier avec ceux qui ont tué les siens. Un milicien repenti qui évolue à leur côté, se souvient.
Ces personnages semblent pour François Woukoache, un exemple pour donner à réfléchir aux populations africaines en dépassant le drame du Rwanda. Ce pays meurtri mais vivant, est pour le cinéaste qui y vit depuis près de 20 ans, un creuset d'observations et d'actions. Engagé dans un travail de formation et de production audiovisuelle, il a enseigné à l'école de communication de l'Université nationale tout en lançant un Fonds documentaire sur la mémoire du génocide, et en cordonnant une initiation au cinéma en milieu scolaire.
Son engagement, manifesté par des stages, des productions pour la télévision, est mené par François Woukoache, en parallèle avec une réflexion profonde sur le sens de l'image. Son aspiration à un langage poétique, apte à véhiculer des questions de société, s'illustre avec Ntarabana. C'est aussi l'aboutissement d'une démarche volontaire, ouverte à la parole et à la proximité des habitants.
François Woukoache qui réside au Rwanda, a séjourné un bon moment en Belgique. Il y a fait un détour avant de venir accompagner une des premières projections européennes de Ntarabana en France. A l'occasion de son passage au Centre Wallonie-Bruxelles, lors de la 26ème Quinzaine du cinéma francophone (*), le réalisateur camerounais nous a confié quelques unes des ses visions sur le Rwanda. Le film Ntarabana sort en salles et il est prévu deux séances en présence du réalisateur au Cinéma Aventure (**), lundi 30 avril 2018 à 20h00 et jeudi 02 mai 2018, à 19h30.
Organiser un film sur les échos du génocide
Quels sont les thèmes qu'aborde Ntabarana pour vous ?
Ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait pour rester humain. Quel genre de choix on fait, qu'est-ce qui fait que certaines personnes basculent dans l'horreur et que d'autres restent humaines, simplement en faisant des choix, tout en étant des personnes qu'on qualifierait d'ordinaires. Tous les personnages du film sont des paysans qui dans des circonstances les plus extrêmes, ont fait des choses que je trouve extraordinaires. J'aborde ça à travers ce qu'on appelle les Justes, ce qui pour moi ne se limite pas à la définition qu'on en a et qui vient de la Shoah, donc des gens qui ont sauvé des vies. Mais c'est aussi des gens qui ont subi des choses terribles et qui arrivent à regarder les personnes qui leur ont fait ça, et arrivent non seulement à les pardonner mais à les aimer en retour. Pour moi, c'est aussi une autre facette du Juste. C'est pour ça que l'un des personnages les plus importants du film, est une femme qui a fait ce parcours. Ce sont un peu ces questions que je traite.
Et comment montrez-vous ces questions ?
Depuis toujours dans mon travail, j'ai plutôt tendance à " m'effacer " par rapport à mes personnages, et à les laisser s'exprimer. Tout le travail que j'ai fait au Rwanda, depuis toutes ces années, ça a été vraiment axé sur la parole, la parole des protagonistes. Que ce soit les rescapés ou les bourreaux ou d'autres personnes qui n'étaient pas là, ou qui étaient là mais qui ont tenu un autre " rôle ". Donc c'est un film qui travaille beaucoup sur la parole, sur l'espace, sur la mémoire toujours. Qu'est ce qui reste, de quoi on se souvient-on ? D'où ça vient, ce qu'on est aujourd'hui, le fait que certaines personnes sont ce qu'elles sont ? C'est très intéressant d'ailleurs cette question, parce que c'est vrai que ça me renvoie à des interrogations personnelles mais en même temps au Rwanda, ça renvoie à la question de la transmission, la question d'un héritage culturel parce que la plupart des gens, la plupart des analyses du génocide fondent leur théorie sur le fait que le christianisme entre autres, la colonisation, auraient complètement éradiqué la culture rwandaise… Ce qui est vrai en partie mais en même temps, il en est resté des choses très fortes qui font que pour moi, le génocide a été un échec puisqu'il y a des rescapés. Donc le film questionne un peu ça aussi.
Formellement, comment procédez-vous pour réaliser Ntarabana ?
C'est un travail de création, comme toujours pour moi. Là, on est beaucoup plus proche d'un documentaire dans le sens où on est vraiment dans des éléments du quotidien, des éléments contemporains. C'est vrai que par le passé, j'ai quand même utilisé des images du génocide tel qu'on le connaît. Là, ma position en tant que cinéaste, c'était de me poser la question de comment raconter ça autrement aujourd'hui, comment dire cette chose sans forcément montrer. Comment travailler ces espaces là sans évoquer. Donc le génocide est là à travers une approche de l'image qui est en même temps à la fois très simple mais dans la construction sur la durée du film, essaie d'installer quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc on joue sur l'exposition, les cadrages… Parce que ce moment là est comme un moment qui est hors du temps. On a une sorte d'opposition entre les images exposées " normalement " et le travail sur la surexposition. Comment ça bascule, comment ça revient. Ça, c'est lié avec ce dont on parle. Si on parle du crime ou de la façon dont on s'oppose au crime… En fonction de ces différentes thématiques, le traitement de l'image et du son, parce que c'est important aussi, est particulier et différent. Moi, ça m'intéressait beaucoup d'y réfléchir et d'utiliser ce qui est en général, vu de façon basique au cinéma comme une faute. Parce que normalement, on ne surexpose pas… Mais là on utilise ça de façon très consciente pour essayer de dire autre chose. Donc formellement, on est allé vers ces eaux-là et vers un travail sur la durée. Il faut vraiment laisser les choses s'installer. Il faut laisser le temps s'installer, il faut laisser le spectateur s'imprégner…
C'est donc pour ça que la durée du film est celle d'un long-métrage ?
Non, dès le départ, dans ma tête, ça ne pouvait pas être court. L'un des précédents films que j'ai fait sur le génocide, l'un des tout premiers d'ailleurs, Nous ne sommes plus morts, durait deux heures et demie. Parce que pour moi, justement, la durée est quelque chose de fondamental si on veut essayer d'appréhender un peu ces problématiques. Dans la vitesse simplement, on ne peut pas aller au fond des choses. Donc il faut aux gens le temps de s'habituer, le temps de s'imprégner des choses. Il faut le temps de digérer parce que ça reste quand même une histoire très violente, très dure. Si on veut la raconter et si on veut faire en sorte que les gens en gardent autre chose que simplement des impressions furtives, je pense qu'il faut laisser le temps pour qu'ils rentrent dans l'histoire, s'approchent des personnages, comprennent les choses. Donc le travail sur le temps est extrêmement important.
Faire corps avec l'âme des personnages
Combien de temps avez-vous mis pour tourner Ntarabana ?
Le film a tété tourné très vite, relativement vite pour un long-métrage. On a tourné trois semaines mais c'était extrêmement préparé. J'ai commencé à travailler sur le projet en 2012, le propos était prêt à être tourné en 2014. Il y a eu quasiment un an de préparation, de travail avec les personnages, de travail sur les espaces, des repérages. Donc pour moi, le tournage, et à la grande surprise de l'équipe d'ailleurs, a duré moins longtemps que ce qui était prévu dans le plan de travail parce que les choses étaient extrêmement précises. Je savais exactement ce qu'il fallait faire. En amont, j'avais fréquenté les personnages pendant de longs mois et pour certains même plus de deux ans. Donc il y avait une proximité qui faisait que l'équipe n'existait presque pas. Ils savaient plus ou moins, ce que j'attendais d'eux et donc les choses allaient relativement vite. Ainsi on a filmé en moins de trois semaines mais par contre, derrière, le travail de postproduction a duré un an et demi avec plusieurs périodes.
Avez-vous choisi d'évoluer dans un espace éclaté ou avez-vous préféré concentrer le tournage dans un espace très délimité ?
Le titre du film, Ntarabana , renvoie au village de la colline où on a tourné. Au départ, le projet portait sur plusieurs endroits différents dans plusieurs provinces, mais il se trouve qu'au fil du temps, j'ai rencontré d'autres personnages dans le même endroit, et ils avaient des liens. Et finalement, c'était plus intéressant de travailler cette espèce d'unité de lieu, et puis c'était plus facile à gérer. J'en suis arrivé à la conclusion que ce n'était pas forcement en cumulant plusieurs histoires différentes, en accumulant les personnages que ça allait donner de la force au film. Donc on a tourné dans un seul endroit, un seul village. Après, il y a des plans qu'on a dû faire un peu ailleurs mais ça c'était vraiment plus pour faire des raccords. Car les personnages du film vivent au même endroit, dans le même village.
Où se situe précisément ce village ?
Il s'appelle donc Ntarabana et donne son titre au film. Il est à moins d'une heure de route de Kigali, dans le nord du Rwanda, dans le district de Rulindo. Ca veut dire qu'on logeait à Kigali et on se déplaçait tous les jours pour venir sur place. Ce n'est pas très loin de la capitale et c'est un village qui n'est pas isolé mais en même temps, on a l'impression qu'on est à des années lumières parce que c'est sur la colline, et parce que ce qui s'est passé là n'est pas forcement unique. Ca s'est passé à plein d'endroits ailleurs sauf que là, j'ai trouvé à mon sens, des personnages qui racontaient de façon extrêmement forte ces thématiques, ces questionnements. Ils avaient répondu d'une façon extrêmement simple mais en même temps très belle pour moi.
Est-ce que ce sont les gens qui vous donné envie de filmer là, ou est-ce que vous avez connu le village pour une autre raison ?
Non, ce sont les gens, les personnages qui m'ont motivé et qui m'ont décidé non seulement de filmer là mais de ne filmer que là. Et il y a autre chose. Dans les trois personnages principaux, il y a deux femmes âgées, deux mamans, et un monsieur qui exprimaient quelque chose que je n'ai pas trouvé ailleurs. Il s'est créé un lien très particulier, une relation très particulière entre nous, qui m'a convaincu que ce n'était pas nécessaire d'aller chercher loin, plus loin. J'avais sous la main les éléments qu'il fallait pour pouvoir dire les choses.
Quand vous dites cela, est-ce que cela signifie que vous avez préparé les gens à dire ce qu'ils disent devant la caméra ?
Il n'y a pas besoin de les préparer. C'est ça qui est le plus extraordinaire. Il y avait juste à les laisser être ce qu'ils sont, parce qu'ils sont comme ça. C'est ça qui m'a vraiment marqué. Et qui m'a décidé à travailler dans ce village avec ces personnes. En les fréquentant longtemps, finalement, on arrive à la conclusion simple qu'ils ne jouent pas, ils ne sont pas autre chose, à aucun moment. Ils ont été élevés comme ça et ils le disent d'ailleurs, à un moment donné dans le film. Ils l'expriment avec des façons différentes puisqu'ils ont des personnalités et des histoires différentes mais tous le disent, ils sont comme ça. Le principal travail que j'avais à faire, c'était d'arriver à ce qu'au moment du tournage, ils restent ce qu'ils étaient, et qu'on arrive à capter le type de relations qu'ils avaient entre eux. Quand à les préparer, c'est dans le sens où on fait quand même un film, et ce sont des gens qui pour la plupart, n'avaient jamais vu de caméra. On débarquait avec une équipe alors que pendant tout le temps d'avant lors des repérages, j'étais seul avec un assistant qui était rwandais. Donc la relation s'était construite mais là on arrivait avec d'autres gens qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils allaient découvrir. Donc il y avait ce travail de préparation pour faire en sorte que ça s'intègre mais ça s'est fait de façon tout à fait naturelle parce que ce sont des gens exceptionnels. Ils ont un c?ur, ils sont plein d'amour et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est fort.
Croyez-vous que la parole que vous filmez les libère de ce qu'ils ont vécu ?
Ces personnes là sont déjà libérées ! Sinon elles n'auraient pas fait ce qu'elles ont fait. Mais il y a un personnage dans le film qui était milicien, et qui lui a de vrais problèmes. Je pense que le film l'a aidé quelque part mais les autres n'en avaient pas besoin. Ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Et si c'était à refaire, ils le referaient, pareil. Même la rescapée qui est dans le film, elle a dépassé cette histoire déjà. Elle est à un autre niveau. Ca, c'est important. Au départ, le projet, qui n'est pas fini d'ailleurs, s'appelait Les voix de l'espoir parce que je pense que ces gens portent cette espérance. Ils sont au-delà de la compréhension que nous avons de cette histoire de crimes, de génocide. Ils sont allés au-delà et ils sont dans l'amour, dans la générosité. Donc ils n'avaient absolument pas besoin d'être libérés de quoi que ce soit.
Produire une oeuvre personnelle et salutaire
Faut-il l'artifice du cinéma et de la postproduction après, pour reconstruire vraiment cette histoire et cette relation ?
Oui, je pense qu'on en a besoin parce qu'on a tendance à banaliser ça y compris au Rwanda. On a tendance à trouver que les choses vont de soi ou même à ne pas les comprendre. En ce moment, je travaille sur un film de commande sur la réconciliation où j'ai interrogé des rescapés qui ont fait aussi ce chemin de conciliation et de pardon. Ils me disent qu'il y a des gens qui les prennent pour des fous, qui ne comprennent pas. Et je peux comprendre qu'on ne comprenne pas parce que c'est une histoire de fous ! Oui effectivement, on a besoin de l'artifice du cinéma pour en parler. On a besoin de trouver une structure narrative, de trouver quelque chose qui fasse que les gens puissent l'appréhender un peu, essayer de s'approcher un peu de ça. On en a besoin dans ce monde qui devient un peu fou. Quand je regarde en Afrique notamment, autour de moi, il y a plein de pays qui ont besoin d'entendre ça, d'entendre qu'on ne répond pas à la haine par la haine. Entendre qu'il y a des gens qui sont capables, de façon extrêmement sincère, d'amour. Et ça n'a rien de religieux, dans le sens traditionnel du terme, mais je pense que ça raconte une profonde spiritualité. C'est humain. Ce sont des choses qu'on peut retrouver dans d'autres continents, dans d'autres cultures et c'est pour ça que je trouve que c'est important de les partager.
Vous parliez d'un projet de commande que vous réalisez tout à l'heure, est-ce que Ntarabana est un projet personnel ?
Oui, c'est un projet personnel que j'ai toujours eu envie de faire. Je savais que je le ferai. Je considère que ça vient clore une sorte de triptyque qui a commencé avec Nous ne sommes plus morts (2000). Le film précédent qui s'appelait Icyzere, l'espoir (2007), était déjà un volet qui lui-même était un film composé de trois parties. Malheureusement, on n'a pas travaillé sur les deux autres parties notamment parce que je trouvais que la matière qu'on avait n'était pas suffisante pour traiter la suite. Entre-temps on n'a pas pu aboutir ce travail d'où l'idée de faire un film spécifique bien plus important sur la question des Justes. Mais cette question faisait déjà partie de ce travail préliminaire donc c'est un projet que je porte depuis 2012.
Comment avez-vous pu financer Ntarabana ?
On l'a financé de manière très compliquée comme d'habitude ! (rires) Au départ, on l'a financé avec un soutien de l'Union Européenne au niveau local, et avec des fonds propres. Ça a fini par un appel de financement participatif sur internet où heureusement on a pu trouver des gens qui ont été touchés par le projet. Ils ont permis de trouver le financement qui manquait pour boucler la postproduction.
Est-ce un film qui revient cher au final ?
Non. Moi, de toutes façons, je ne fais pas des films chers ! (rires) C'est un film qui a coûté environ 150 000 euros tout compris. Mais après c'est vrai qu'il y a plein de frais qui ne rentrent pas dans ce compte. Si j'avais été dans une production normale, en tant que réalisateur ayant travaillé quasiment trois ans en pur temps de production, c'est vrai que le budget ne serait pas de ce montant. Mais on arrive à un long-métrage qui fait 1h30 et qui a été post produit en Belgique et en France, dans de bonnes conditions avec un étalonnage normal, un mixage comme il fallait. Le temps de montage a duré en tout, sur trois périodes, à peu près huit mois.
Prévoyez-vous une sortie en salles ?
On y travaille. Le film s'est terminé au début 2017. On a mixé en décembre 2016, puis il y a eu encore des corrections d'étalonnage à faire et on a dû revoir des choses donc il s'est achevé en janvier 2017. Puis entre janvier et mars, on a travaillé sur tout ce qui était traductions, les sous-titrages. Maintenant on commence vraiment le travail de promotion mais c'est un film qui a vraiment été conçu pour la salle, pour le grand écran. Ce n'est pas un film de télé ni dans son rythme, ni dans on style. Dans son approche esthétique, ce n'est pas du tout un film télé, même si on serait heureux qu'il passe sur une chaîne. Mais il est fait d'abord pour le grand écran. On discute avec des distributeurs en Belgique et je fais des contacts en France. L'idée, c'est qu'il soit bien projeté en salles.
Pensez-vous que les gens soient prêts à entendre encore parler de cette histoire de génocide qui a touché le Rwanda ?
J'espère, en tous cas, qu'une partie du public, une partie de la population, est prête à entendre ce qu'on dit du génocide. D'une part, je ne pense pas que ce qu'ils vont voir dans le film, ils l'ont déjà entendu ailleurs. Car je ne connais pas d'autres films qui aient traité spécifiquement de cette question et en tous cas, qui l'aient traité de la façon dont on l'approche ici. Et puis comme je l'ai dit, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce sont des questions qui sont fondamentales.
Approfondir une démarche au Rwanda
Pourquoi continuez-vous à explorer encore et toujours ces réalités rwandaises ?
Parce qu'il y a peu de gens qui le font. Et que je pense que c'est incontournable. On ne peut pas juste se contenter d'y jeter un regard et de continuer son chemin. C'est ma position. Comme on en a déjà discuté à propos des premiers travaux que j'ai faits il y a 15 ans, au Rwanda, c'est une réalité qui m'a non seulement changé en tant que cinéaste mais en tant qu'homme. Et puis il y a tellement de choses à comprendre, tellement de choses à raconter, de leçons à tirer. Quand je vois ce qui se passe dans mon propre pays, le Cameroun, je me dis que malheureusement on n'a pas assez réfléchi à ce qui se passe au Rwanda. Quand on voit ce qui s'est passé en Centrafrique, en Côte d'Ivoire… Les exemples sont légions. On n'a pas assez réfléchi à tout ça. On ne s'est pas assez posé de questions sur ce qui s'est passé au Rwanda même si les contextes sont différents. Mais fondamentalement, les éléments clés sont les mêmes. Il y a quand même des choses sur lesquelles il faut s'interroger, réfléchir. Et ça ne s'adresse pas qu'aux cinéastes mais aussi aux sciences sociales, aux philosophes, aux psychiatres, aux psychanalystes… Il y a vraiment de quoi se poser des questions fondamentales à mes yeux !
Est-ce le fait d'avoir à se poser ces questions qui vous a fixé au Rwanda ?
En grande partie, oui. Pour moi aussi, ce n'était pas concevable de travailler sur le Rwanda à distance. C'est une approche personnelle. Pendant presque dix ans, j'ai fait des films en Afrique en vivant en Europe. J'ai bien vu au fil des années, qu'il manquait quelque chose. A mon sens, il y avait toujours quelque chose qui nous échappait, à nous les Africains, et qui aussi à conduit au fait qu'on n'a pas vu venir le génocide. On a fait plein de films, raconté des choses. On pensait raconter l'Afrique qu'on connaissait mais comment est-ce qu'on a pu passer à côté de ça ? Ça ne veut pas dire qu'en vivant là on voit plus les choses ou qu'on les voit mieux. Mais en tous cas, je pense qu'en vivant là, c'est différent. On est plus imprégné des choses, plus attentif à certaines choses. On se pose d'autres questions, on se les pose différemment. Peut-être d'autres ont besoin de la distance pour pouvoir le faire mais moi, j'avais besoin et j'ai toujours besoin d'être là. Je pense que ce film n'aurait pas été ce qu'il est si je n'avais pas passé autant de temps avec les personnages. Pas seulement dans ce village mais à sillonner le Rwanda pendant toutes ces années, à connaître comment les gens réfléchissent, pensent… Derrière ce film, il y a dix ans de connaissance du pays. J'ai vécu là et je n'ai fait que sillonner le pays de long en large, j'ai rencontré des gens, j'ai parlé avec eux. Donc tout d'un coup, les choses deviennent plus " simples "…
Votre désir de faire changer la condition audiovisuelle au Rwanda était-il une évidence dès le début de votre présence dans le pays ?
Oui, dans les années 1996, quand je suis arrivé au Rwanda, c'était un pays qui n'avait pas de passé audiovisuel. Quand à la télé… Donc il était important d'initier des choses et heureusement aujourd‘hui, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup changé même si ce n'est pas toujours en bien… Il y a des cinéastes qui ont émergé, ils commencent à avoir des prix dans des festivals. Il y a des choses qui se passent. Les Rwandais commencent à raconter leur pays eux-mêmes, ce qui pour moi, est quelque chose d'inestimable. Le travail n'est pas terminé mais au moins, on commence à voir des choses qui se construisent, se structurent. Et puis voilà, le Rwanda va avancer à son rythme.
Vous trouvez que l'audiovisuel est assez structuré au Rwanda ?
Il n'est pas structuré comme moi, j'espérais qu'il le serait dix ans après, mais c'est la réalité du pays. On a quand même avancé…
Allez-vous continuer vos activités d'enseignement, de formation, de stages au Rwanda ?
Pour le moment je n'en fais plus pour des raisons personnelles surtout, mais aussi parce que le projet de Ntarabana m'a pris pas mal de temps et que j'ai aussi le besoin de faire autre chose au Rwanda. Et je fais de la formation mais pas spécialement pour des gens qui ont des envies de cinéma. Par exemple, les deux dernières années en dehors de Ntarabana , ont été consacrées à travailler avec des femmes qui sont des anciennes prostituées ou d'anciens enfants de la rue. L'objectif est d'essayer de leur apprendre des rudiments d'expression audiovisuelle notamment à travers la photo et la vidéo, dans une approche différente. Mais ça participe toujours de ça, en fait : la capacité à emmener les gens à réfléchir sur l'image et sur la représentation. Le fait qu'on puisse s'exprimer autrement que par des phrases quand on n'a pas été à l'école, est important. On peut s'exprimer par des images. Mais il y a des codes et il faut maîtriser un minimum de technique. Le reste, ça vient de l'intérieur…
(*) La 26ème Quinzaine du cinéma francophone a eu lieu du 2 au 10 octobre 2017, au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, dans le cadre du Festival francophonie métissée. La programmation propose chaque année, de découvrir les dernières productions et coproductions belges parmi lesquelles une bonne partie concernent l'Afrique. La sélection est effectuée par le responsable cinéma du Centre, Louis Héliot, un cinéphile aguerri et expert, qui encadre les projections en présence de la plupart des réalisateurs, présents pour échanger avec le public.
(**) Le Cinéma Aventure est situé Rue des Frippiers, 15, Galerie du Centre 57 Bloc II, 1000 Bruxelles, Belgique. Les deux projections du film Ntarabana (en présence du réalisateur) ont lieu le lundi 30 avrl 2018 à 20h00 et le jeudi 02 mai 2018, à 19h30.
Propos recueillis et introduits par Michel AMARGER
Paris, Africiné Magazine
pour Images Francophones
Image : Le cinéaste camerounais François Woukoache, à la caméra.
Crédit : DR
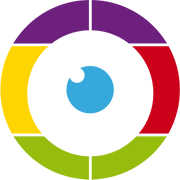 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images