Afrique francophone : zoom sur les réalisatrices

Un colloque international sur les 40 ans de cinéma des réalisatrices africaines francophones a été organisé le 23 et le 24 novembre à Paris, respectivement au Musée du Quai Branly et à la Bibliothèque nationale de France. Occasion de refaire l’histoire des cinémas d’Afrique au féminin et en difficultés.
Il y a plus inconnu que les cinémas d’Afrique : ce sont les réalisatrices africaines. « Elles ont toujours été un peu marginalisées, elles sont le parent pauvre du développement de la cinématographie ». Pour ces raisons, Brigitte Rollet, chercheur au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC) de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en France, a décidé de célébrer ces femmes « qu’on ne célèbrera sans doute jamais » en organisant un colloque de deux jours, dans le but de mettre en lumière leur travail.
Historiquement, la Camerounaise Thérèse Sita Bella (1933-2006) est la première femme africaine à réaliser un film : Tam tam à Paris, en 1963. Mais Brigitte Rollet a choisi pour pionnière la Guadeloupéenne Sarah Maldoror pour son film Sambizanga, tourné en Angola et sorti en 1972. Ce qui lui a permis d’avancer le chiffre quarante pour marquer cet anniversaire. « C’est vrai qu’il y a eu Sita Bella, mais Sarah Maldoror a davantage marqué. Je ne pense pas qu’on pourrait dire la même chose du film de Sita Bella, parce qu’il est moins connu. Je ne sais pas où on peut le voir, je ne sais pas non plus où on peut voir La passante de Safi Faye [1972, Sénégal, 10min, NDLR]. Par cette rencontre, je voulais aussi montrer la difficulté de faire un patrimoine de ces films », explique-t-elle.
Parcours de combattantes
Fondatrice et directrice du Centre pour l’étude et la recherche des femmes africaines dans le cinéma, l’Africaine-Américaine Beti Ellerson a remonté le cours du temps pour retrouver des femmes dans l’histoire du cinéma africain. Comme elle l’a rappelé, dans les années 50, elles y étaient déjà mais se préparaient, avec une figure comme Annette Mbaye d’Erneville « qui n’a pas fait de film mais est devenu une grande critique au Sénégal ». La caméra était réservée aux hommes, les femmes étaient confrontées aux sociétés qui refusaient de s’ouvrir au monde. Mais au fur et à mesure, la société les a acceptées comme artistes. C’est ainsi qu’en 1963, Thérèse Sita Bella réalise « un film dont on parle beaucoup mais qu’on n’a jamais vu ». Après avoir joué dans Petit à petit de Jean Rouch en 1971, la Sénégalaise Safi Faye réalise le court-métrage La passante en 1972, puis le long métrage Lettre paysanne en 1975.
Avant cela, Sarah Maldoror, Africaine d’adoption, a tourné en 1969 à Alger Monagambée, son premier court métrage sur la torture. En 1972 sort Sambizanga, son long métrage qui retrace la mort sous la torture de Domingos Xavier, un activiste du Mouvement de libération de l’Angola, mais surtout le combat de sa compagne pour le retrouver. Pour Beti Ellerson, Sarah Maldoror a contribué au cinéma de libération en Afrique. C’est une référence pour de nombreuses réalisatrices africaines. Dans les années 80, arrivent les femmes du Maghreb, avec des figures comme l’Algérienne Assia Djebar et son film La Nouba des Femmes du Mont-Chenoua en 1977 et la Marocaine Farida Benlyazid avec Une porte sur le ciel en 1988. Au Fespaco 1991, l’Union panafricaine des femmes professionnelles de l’image (UPAFI) est créée, dans le but d’assurer la représentation visuelle des femmes et l’égalité dans la formation professionnelle.
Comme l’a rappelé Beti Ellerson, l’émergence des femmes dans le cinéma a coïncidé avec les années 1960 où les Africains se sont approprié la caméra pour montrer autre chose que le regard colonial. Mais, après les luttes coloniales, les réalisatrices ont porté, dans les années 80, leur combat sur le développement et l’autonomisation des femmes. À partir des années 90, en rupture avec les luttes féministes, elles posent les problèmes plus généraux du monde et ne font pas toujours de l’Afrique leur sujet. Mais « elles n’ont pas encore brisé le plafond de verre », d’après Beti Ellerson.
Nombreuses mais invisibles
Responsable des formations du programme Africadoc, Jean-Marie Barbe révèle qu’il y a autant de femmes que d’hommes à se lancer dans le documentaire en Afrique : « c’est une donne particulière dans le monde, peut-être parce que la fiction est envahie par les hommes et que le documentaire est ouvert et peut se faire avec des outils très légers ». Si les femmes sont nombreuses à se lancer dans la réalisation, elles restent peu visibles.
Jackie Buet, directrice du festival de films de femmes de Créteil en France, en a l’amère expérience : « il y a un manque d’ouverture des festivals aux femmes. Cette année par exemple, il n’y avait aucun film de femme à Cannes». Une pétition a d’ailleurs été lancée en mai pour protester contre l’absence de film de femme dans la compétition officielle pour la palme d’Or. Et depuis sa création en 1972, aucune femme n’a reçu l’Etalon de Yennenga, le Grand prix du Fespaco.
La faute, d’après Jackie Buet, à la critique qui n’évolue pas et à la société globale qui renvoie une image dévalorisante aux femmes qui doutent alors et s’autocensurent.
Beti Ellerson le confirme en soutenant que les femmes n’osent pas rêver. La conséquence étant qu’elles ne réussissent pas et se découragent. Brigitte Rollet abonde dans le même sens : « le fait qu’il y a beaucoup de réalisatrices n’empêche pas que le cinéma reste une activité pensée comme masculine. Les réalisatrices ont toujours été un peu marginalisées dans les ouvrages d’histoire du cinéma qui n’intègrent pas que le cinéma africain est aussi fait par les femmes. Le cinéma est un art coûteux et les producteurs hésitent à confier des budgets élevés à une femme. C’est une situation que les réalisatrices africaines partagent avec de nombreuses réalisatrices occidentales ».
Vrais/faux débats ?
Chez les principales concernées, les avis sont partagés. Certaines réalisatrices n’ont jamais considéré leur situation de femme comme un problème. Ainsi, Sarah Maldoror (Guadeloupe), Fanta Régina Nacro (Burkina Faso), Rahmatou Keita (Niger) et Farida Benlyazid (Maroc) soutiennent qu’elles n’ont jamais eu de difficulté à faire un film parce qu’elles sont des femmes. « Les gens vous respectent, si vous savez où vous allez », dit Farida Benlyazid. « Qu’on soit homme ou femme, les problèmes sont les mêmes : formation, financement et distribution », renchérit Sarah Maldoror.
D’autres sont très conscientes de leur condition de femme cinéaste et développent le moyen de le dépasser. Nadia El Fani (Tunisie) revendique même un cinéma de femmes : « il ne faut pas se voiler la face. Il y a une vulnérabilité des femmes par rapport aux hommes, c’est une réalité. Quand je suis dans la rue en Tunisie, je suis une femme. Je ne peux pas filmer la nuit par exemple. Ce n’est pas vrai qu’il n’y a aucune différence entre un film de femme et un film d’homme. Les hommes que je filme ne se mettent pas en scène de la même manière que s’ils étaient filmés par un homme ».
Rama Thiaw (Sénégal) est plus nuancée, même si elle reconnaît que « quand on est une femme, et encore plus une femme africaine, c’est très compliqué de faire un film par rapport à notre culture, au rôle qu’on a en tant que femme, à ce qu’on attend de nous. On doit se battre deux fois plus. Mais je ne pense pas qu’il y a un imaginaire féminin, on a tous un imaginaire qui nous est propre, selon notre parcours ».
Pour Oswalde Lewat (Cameroun), « lorsqu’on fait des films et qu’on est une femme, le regard des autres n’est pas neutre, que ce soit pour nous aider à avancer ou au contraire, à reculer. Il n’y a pas de cinéma de femmes, mais on considère que les hommes sont plus légitimes pour faire des films ».
Une légitimité qui devrait s’appliquer aussi bien aux femmes. Beti Ellerson déclare que « la femme africaine doit être partout : à l’image, derrière la caméra, au montage… » Reste à rendre leur travail visible. « Les réalisatrices ont allumé de milliers de petites lucioles, il faut s’en approcher pour les voir », dit Jackie Buet.
Stéphanie Dongmo
Africiné, Douala
Historiquement, la Camerounaise Thérèse Sita Bella (1933-2006) est la première femme africaine à réaliser un film : Tam tam à Paris, en 1963. Mais Brigitte Rollet a choisi pour pionnière la Guadeloupéenne Sarah Maldoror pour son film Sambizanga, tourné en Angola et sorti en 1972. Ce qui lui a permis d’avancer le chiffre quarante pour marquer cet anniversaire. « C’est vrai qu’il y a eu Sita Bella, mais Sarah Maldoror a davantage marqué. Je ne pense pas qu’on pourrait dire la même chose du film de Sita Bella, parce qu’il est moins connu. Je ne sais pas où on peut le voir, je ne sais pas non plus où on peut voir La passante de Safi Faye [1972, Sénégal, 10min, NDLR]. Par cette rencontre, je voulais aussi montrer la difficulté de faire un patrimoine de ces films », explique-t-elle.
Parcours de combattantes
Fondatrice et directrice du Centre pour l’étude et la recherche des femmes africaines dans le cinéma, l’Africaine-Américaine Beti Ellerson a remonté le cours du temps pour retrouver des femmes dans l’histoire du cinéma africain. Comme elle l’a rappelé, dans les années 50, elles y étaient déjà mais se préparaient, avec une figure comme Annette Mbaye d’Erneville « qui n’a pas fait de film mais est devenu une grande critique au Sénégal ». La caméra était réservée aux hommes, les femmes étaient confrontées aux sociétés qui refusaient de s’ouvrir au monde. Mais au fur et à mesure, la société les a acceptées comme artistes. C’est ainsi qu’en 1963, Thérèse Sita Bella réalise « un film dont on parle beaucoup mais qu’on n’a jamais vu ». Après avoir joué dans Petit à petit de Jean Rouch en 1971, la Sénégalaise Safi Faye réalise le court-métrage La passante en 1972, puis le long métrage Lettre paysanne en 1975.
Avant cela, Sarah Maldoror, Africaine d’adoption, a tourné en 1969 à Alger Monagambée, son premier court métrage sur la torture. En 1972 sort Sambizanga, son long métrage qui retrace la mort sous la torture de Domingos Xavier, un activiste du Mouvement de libération de l’Angola, mais surtout le combat de sa compagne pour le retrouver. Pour Beti Ellerson, Sarah Maldoror a contribué au cinéma de libération en Afrique. C’est une référence pour de nombreuses réalisatrices africaines. Dans les années 80, arrivent les femmes du Maghreb, avec des figures comme l’Algérienne Assia Djebar et son film La Nouba des Femmes du Mont-Chenoua en 1977 et la Marocaine Farida Benlyazid avec Une porte sur le ciel en 1988. Au Fespaco 1991, l’Union panafricaine des femmes professionnelles de l’image (UPAFI) est créée, dans le but d’assurer la représentation visuelle des femmes et l’égalité dans la formation professionnelle.
Comme l’a rappelé Beti Ellerson, l’émergence des femmes dans le cinéma a coïncidé avec les années 1960 où les Africains se sont approprié la caméra pour montrer autre chose que le regard colonial. Mais, après les luttes coloniales, les réalisatrices ont porté, dans les années 80, leur combat sur le développement et l’autonomisation des femmes. À partir des années 90, en rupture avec les luttes féministes, elles posent les problèmes plus généraux du monde et ne font pas toujours de l’Afrique leur sujet. Mais « elles n’ont pas encore brisé le plafond de verre », d’après Beti Ellerson.
Nombreuses mais invisibles
Responsable des formations du programme Africadoc, Jean-Marie Barbe révèle qu’il y a autant de femmes que d’hommes à se lancer dans le documentaire en Afrique : « c’est une donne particulière dans le monde, peut-être parce que la fiction est envahie par les hommes et que le documentaire est ouvert et peut se faire avec des outils très légers ». Si les femmes sont nombreuses à se lancer dans la réalisation, elles restent peu visibles.
Jackie Buet, directrice du festival de films de femmes de Créteil en France, en a l’amère expérience : « il y a un manque d’ouverture des festivals aux femmes. Cette année par exemple, il n’y avait aucun film de femme à Cannes». Une pétition a d’ailleurs été lancée en mai pour protester contre l’absence de film de femme dans la compétition officielle pour la palme d’Or. Et depuis sa création en 1972, aucune femme n’a reçu l’Etalon de Yennenga, le Grand prix du Fespaco.
La faute, d’après Jackie Buet, à la critique qui n’évolue pas et à la société globale qui renvoie une image dévalorisante aux femmes qui doutent alors et s’autocensurent.
Beti Ellerson le confirme en soutenant que les femmes n’osent pas rêver. La conséquence étant qu’elles ne réussissent pas et se découragent. Brigitte Rollet abonde dans le même sens : « le fait qu’il y a beaucoup de réalisatrices n’empêche pas que le cinéma reste une activité pensée comme masculine. Les réalisatrices ont toujours été un peu marginalisées dans les ouvrages d’histoire du cinéma qui n’intègrent pas que le cinéma africain est aussi fait par les femmes. Le cinéma est un art coûteux et les producteurs hésitent à confier des budgets élevés à une femme. C’est une situation que les réalisatrices africaines partagent avec de nombreuses réalisatrices occidentales ».
Vrais/faux débats ?
Chez les principales concernées, les avis sont partagés. Certaines réalisatrices n’ont jamais considéré leur situation de femme comme un problème. Ainsi, Sarah Maldoror (Guadeloupe), Fanta Régina Nacro (Burkina Faso), Rahmatou Keita (Niger) et Farida Benlyazid (Maroc) soutiennent qu’elles n’ont jamais eu de difficulté à faire un film parce qu’elles sont des femmes. « Les gens vous respectent, si vous savez où vous allez », dit Farida Benlyazid. « Qu’on soit homme ou femme, les problèmes sont les mêmes : formation, financement et distribution », renchérit Sarah Maldoror.
D’autres sont très conscientes de leur condition de femme cinéaste et développent le moyen de le dépasser. Nadia El Fani (Tunisie) revendique même un cinéma de femmes : « il ne faut pas se voiler la face. Il y a une vulnérabilité des femmes par rapport aux hommes, c’est une réalité. Quand je suis dans la rue en Tunisie, je suis une femme. Je ne peux pas filmer la nuit par exemple. Ce n’est pas vrai qu’il n’y a aucune différence entre un film de femme et un film d’homme. Les hommes que je filme ne se mettent pas en scène de la même manière que s’ils étaient filmés par un homme ».
Rama Thiaw (Sénégal) est plus nuancée, même si elle reconnaît que « quand on est une femme, et encore plus une femme africaine, c’est très compliqué de faire un film par rapport à notre culture, au rôle qu’on a en tant que femme, à ce qu’on attend de nous. On doit se battre deux fois plus. Mais je ne pense pas qu’il y a un imaginaire féminin, on a tous un imaginaire qui nous est propre, selon notre parcours ».
Pour Oswalde Lewat (Cameroun), « lorsqu’on fait des films et qu’on est une femme, le regard des autres n’est pas neutre, que ce soit pour nous aider à avancer ou au contraire, à reculer. Il n’y a pas de cinéma de femmes, mais on considère que les hommes sont plus légitimes pour faire des films ».
Une légitimité qui devrait s’appliquer aussi bien aux femmes. Beti Ellerson déclare que « la femme africaine doit être partout : à l’image, derrière la caméra, au montage… » Reste à rendre leur travail visible. « Les réalisatrices ont allumé de milliers de petites lucioles, il faut s’en approcher pour les voir », dit Jackie Buet.
Stéphanie Dongmo
Africiné, Douala
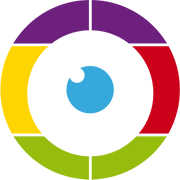 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images