63ème Berlinale, le cinéma peut-il changer les choses ?

Raoul Peck et Lonesome Solo mettent en scène le social.
Dans son texte d’introduction à la 63ème Berlinale, Dieter Kosslick, le directeur de la manifestation, a mis l’accent sur le social comme fil conducteur de cette édition 2013 du festival. En effet, la sélection officielle répond parfaitement à cette vision. Les films qui constituent le noyau dur de la programmation de cette Berlinale sont autant d’échos aux différentes discussions courantes dans notre société contemporaine. On y retrouve l’environnement et le gaz de schiste, le combat des artistes contre des régimes politiques intolérants, le destin des minorités combattant pour leur droit d’exister, des peuples confrontés à des crises sociales et politique ou tout simplement à des drames humains. Bref la Berlinale 2013 se veut à l’écoute de son temps en servant de plateforme aux auteurs portant un message humain fort. À bien observer le programme, ce message se ramifie selon les thèmes, les styles et les tons.
Plus tard, Wong Kar-Wai, le président du jury, a confirmé cette orientation du festival lors de la cérémonie de clôture quand, commentant certains prix, il déclara à quel point il a la conviction que « le cinéma peut changer les choses ». D’ailleurs le palmarès va parfaitement dans ce sens. Presque tous les prix sont allés à des films venant de pays où les sociétés sont en train de connaitre des mutations profondes : Iran, Bosnie, Roumanie, Kazakhstan,…
D’abord la terre
L’un des débats les plus passionnants et passionnés de notre temps c’est celui de l’énergie et son corolaire : l’évolution de notre société ainsi que de son mode de consommation, au détriment de ce que la nature est susceptible de nous donner. L’homme a tendance à toujours demander trop à notre mère nature. Partout dans le monde on assiste à un débat très houleux au sujet de l’extraction de nouvelles énergies, avec de nouvelles méthodes outre le danger que cela aurait sur l’environnement et donc sur notre survie. C’est la polémique soulevée par Gus Van Sant dans son nouveau film en compétition, Promised Land. Ailleurs, c’est la question de l’expansion urbaine et son impact sur les espaces ruraux. C’est ce que le Russe Boris Khlebnikov aborde dans A Long and Happy life (Dolgaya schastlivaya zhizn).
Les deux films se passent dans deux villages. Le déplacement de la ville vers la campagne nous met d’emblée au centre du débat autour du sens de l’évolution de notre vie. Dans quelle mesure peut-on se permettre de sacrifier le potentiel viable de la terre qui est travaillée par des agriculteurs souvent démunis, au profit de compagnies pétrolières ou immobilières qui ne cherchent qu’à s’enrichir de plus en plus, sans penser à la survie de la race humaine et son devenir à long terme ? C’est le sens du combat de Steve Butler (joué par Matt Damon), le New-yorkais qui a pour mission de racheter des terres aux habitants d’un petit village pour des forages de gaz naturel, dans Promised Land (qui remporte une Mention Spéciale, Berlinale 2013). C’est aussi contre quoi Sascha le propriétaire d’une ferme qui fait vivre une grande partie de son village se bat au prix de sa vie, devant la caméra de Boris Khlebnikov (A Long and Happy life). Les deux personnages sont d’abord tentés par le mirage du confort et la richesse. Mais lorsque leur conscience se réveille et qu’ils voient à quel diable ils étaient sur le point de vendre leurs âmes, ils se dressent contre le rouleau compresseur de la modernité dans son aspect le plus criminel et inhumain.
La solidarité internationale.
Dans le cadre de la section Berlinale Specials, Raoul Peck a présenté son nouveau film [photo], Assistance mortelle (Fatal Assistance). Ce titre en oxymoron dit l’ironie et la lucidité avec lesquelles le réalisateur haïtien aborde la politique internationale de l’aide humanitaire. Le film fait le bilan de plus de deux ans d’intervention internationale en Haïti, après le terrible tremblement de terre qui a mis le pays à genoux un certain 12 janvier 2010. La catastrophe humaine a eu un bilan des plus lourds dans l’histoire de notre temps : environ 316.000 morts, 300.000 blessés, 1.000.000 de sans abris, 250.000 habitations et 30.000 commerces détruits. La réaction de la communauté internationale ne s’est pas laissée attendre. La bonne volonté universelle s’est très vite manifestée. Pays riches, personnalités célèbres, institutions internationales et organisations non gouvernementales ont annoncé leur soutien à la population haïtienne. Mais les bons sentiments, la noblesse des âmes et les déclarations les plus touchantes sont des choses difficilement traduisibles en actes concrets. C’est cela que le documentaire de Raoul Peck semble nous enseigner, pour ne pas dire, remettre en cause.
Cinéma et urgence ne font pas nécessairement bon ménage. Il est trop naïf de penser qu’une réaction artistique et intellectuelle puisse être conçue en concomitance avec les crises graves ou les catastrophes humaines. Les films issus des premières semaines ou même mois de ce qui s’appelle le Printemps Arabe ont été vite dépassés par les événements mais aussi par les différentes formes de discours élaborées avec plus de patience et de pénétration des faits. Raoul Peck a pris son temps. Non seulement il a suivi son sens critique qu’on lui connait mais aussi il est resté cohérent avec son projet. Trois ans après la catastrophe et l’énorme mobilisation internationale, qu’en est-il de la reconstruction promise au Haïtiens?
Que les choses ne se passent pas comme il a été prévu, cela pourrait être compréhensible, mais pour le cinéaste lucide et bon observateur, il y a pire : à l’imprévu structurel auquel toute organisation ou institution pourrait être confrontée vient s’ajouter une forme diffuse d’incohérence qui cacherait des formes plus suspectes et plus ramifiées de profit au nom des bonnes causes. Non seulement une part des promesses n’a jamais été tenue, mais aussi une grande partie de l’argent déboursé s’est évaporée. C’est dire que beaucoup de déclarations sont plus destinées à redorer l’image médiatiques de leurs auteurs qu’à traduire des intentions réelles d’assister les sinistrés. Pis encore, l’aide financière servirait moins à financer les projets de reconstruction qu’au développement et à la promotion des organisations d’aide et leurs lobbys.
Au moyen d’interviews des représentants des différentes structures et l’observation des faits sur le terrain, le réalisateur parvient à démontrer comment le dialogue de sourds entre l’effort international d’un côté et les structures nationales de l’autre se traduit par l’inefficacité la plus totale et conduit même à rendre le drame de la population encore plus absurde, au lieu de l’améliorer. La communauté internationale peut se contenter d’une fausse bonne conscience mais les sinistrés du séisme n’ont pas encore ne serait-ce que des toilettes pour s’en tenir aux besoins les plus basiques. C’est que le tragique dans cette situation n’est pas seulement dans la catastrophe naturelle qui s’est abattu sur Port-au-Prince. Il est à chercher dans l’histoire de l’humanité, comme a déclaré Raoul Peck dans le débat qui a suivi la projection du film dans la Haus der Berliener Festspieler. « Haïti est un pays qui n’est pas supposé exister : premier pays indépendant (1804) dans l’histoire de la colonisation après les USA, et qui plus est, premier pays noir ». Quelle volonté au monde, tel qu’il est actuellement, accepterait qu’un pays pareil puisse se remettre sur pieds ? Et puis il y a un constat encore plus inquiétant : si le monde a échoué dans la reconstruction d’Haïti, cela signifie que l’humanité est incapable de faire face à n’importe quelle catastrophe.
La jeunesse défavorisée
Il est des films qui se veulent à l’écoute d’une jeunesse qui est si ballotée par le destin et la misère que sont sort ne peut être que tragique. C’est le cas du groupe de jeunes Ivoiriens qu’on retrouve dans Le Djassa a pris feu (Burn it up Djassa) le film de Lonesome Solo projeté dans le cadre du Panorama. Il s’agit d’un film pour les démunis, les pauvres et les subalternes, dirait Gramsci. L’univers est celui des bas fonds d’Abidjan. Là, une faune de jeunes perdus vit au jour le jour entre les sorties nocturnes dans les maquis et les veillées dans le Ghetto. Ce dernier est montré comme un monde à lui seul en dehors du temps et de l’espace. L’histoire racontée est atemporelle, bien qu’elle soit parfaitement vraisemblable.
D’une part, le film se veut extrêmement réaliste. Les personnages collent parfaitement à la vie ordinaire dans les rues de Wassakara, l’un des quartiers ghettos abidjanais. Tony gagne sa vie en vendant des cigarettes le jour et en jouant aux cartes le soir dans des bars improvisés. Ange, sa sœur, frustrée dans son travail dans un salon de coiffure se prostitue le soir pour ramener un peu plus d’argent. Une situation toute explosive, à l’image du pays, à la veille de la guerre civile dont l’enclenchement est imminent.
D’une autre part, la manière dans les événements sont racontés donne au film une certaine élévation et une construction particulièrement originale. Le récit est mené un peu à la manière d’un morceau de rap où de temps en temps un refrain revient donner du tempo.
Le film est bien ancré aussi bien dans la réalité comme dans le cinéma. En apparence, il reconduit les composantes du thriller à l’Africaine comme on en voit beaucoup dans la production vidéo. La vie d’Ange et son frère bascule dans le drame le jour d’une bagarre qui tourne mal. Le drame gagne en tension quand on apprend que celui qui mène l’enquête policière n’est autre que Mike, le frère ainé d’Ange et Tony. La poursuite finale confrontera les deux frères. Le film aurait été banal de ce point de vue n’eut été le deuxième niveau de narration introduit par des interventions en nouchi, le jargon des jeunes rappeurs du Wassakara, qui ponctuent le film et lui donne son rythme et en élève le discours.
L’esthétique du film est la synthèse de plusieurs formes d’expression et même de traditions : le thriller comme genre cinématographique, le rap comme langage de cette jeunesse et d’une manière très subtile la tradition plus ancienne du griot. Le jeune rappeur qui intervient de temps en temps pour compléter et commenter l’histoire, est l’incarnation du Griot hérité de la narration orale africaine adapté au rap et au cinéma. Le ghetto devient la métonymie de tout le pays et le fratricide qui s’y joue l’allégorie de la guerre civile qui mettra plus tard la Côte d’Ivoire à sac. Le Djassa a pris feu est produit par Philippe Lacôte, avec le soutien (en autres) de la Francophonie.
Voir des films pareils dans un festival est un signe qu’il y a encore de la place à un cinéma social. Et quand on sait que par ailleurs, la Berlinale a un projet énorme de formation destiné aux jeunes, on comprend alors tout le fond didactique du festival. Le Talent Press accueille les jeunes journalistes. Le Talent Campus est ouvert à toutes sortes de jeunes professionnels du cinéma : réalisateurs, scénaristes, producteurs, organisateurs de festivals. Il doit y avoir un grand secret pour qu’un festival de cette envergure puisse avoir aussi une vocation humaniste et offrir une scène où l’écho de l’actualité brûlante peut être entendu.
Africiné / Amsterdam,
envoyé spécial à Berlin
Photo : L'ancien président américain, Bill Clinton et le Premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive, à Port-au-Prince. Scène du film Assistance Mortelle (Fatal Assistance) de Raoul Peck © Velvet Film 2012.
Plus tard, Wong Kar-Wai, le président du jury, a confirmé cette orientation du festival lors de la cérémonie de clôture quand, commentant certains prix, il déclara à quel point il a la conviction que « le cinéma peut changer les choses ». D’ailleurs le palmarès va parfaitement dans ce sens. Presque tous les prix sont allés à des films venant de pays où les sociétés sont en train de connaitre des mutations profondes : Iran, Bosnie, Roumanie, Kazakhstan,…
D’abord la terre
L’un des débats les plus passionnants et passionnés de notre temps c’est celui de l’énergie et son corolaire : l’évolution de notre société ainsi que de son mode de consommation, au détriment de ce que la nature est susceptible de nous donner. L’homme a tendance à toujours demander trop à notre mère nature. Partout dans le monde on assiste à un débat très houleux au sujet de l’extraction de nouvelles énergies, avec de nouvelles méthodes outre le danger que cela aurait sur l’environnement et donc sur notre survie. C’est la polémique soulevée par Gus Van Sant dans son nouveau film en compétition, Promised Land. Ailleurs, c’est la question de l’expansion urbaine et son impact sur les espaces ruraux. C’est ce que le Russe Boris Khlebnikov aborde dans A Long and Happy life (Dolgaya schastlivaya zhizn).
Les deux films se passent dans deux villages. Le déplacement de la ville vers la campagne nous met d’emblée au centre du débat autour du sens de l’évolution de notre vie. Dans quelle mesure peut-on se permettre de sacrifier le potentiel viable de la terre qui est travaillée par des agriculteurs souvent démunis, au profit de compagnies pétrolières ou immobilières qui ne cherchent qu’à s’enrichir de plus en plus, sans penser à la survie de la race humaine et son devenir à long terme ? C’est le sens du combat de Steve Butler (joué par Matt Damon), le New-yorkais qui a pour mission de racheter des terres aux habitants d’un petit village pour des forages de gaz naturel, dans Promised Land (qui remporte une Mention Spéciale, Berlinale 2013). C’est aussi contre quoi Sascha le propriétaire d’une ferme qui fait vivre une grande partie de son village se bat au prix de sa vie, devant la caméra de Boris Khlebnikov (A Long and Happy life). Les deux personnages sont d’abord tentés par le mirage du confort et la richesse. Mais lorsque leur conscience se réveille et qu’ils voient à quel diable ils étaient sur le point de vendre leurs âmes, ils se dressent contre le rouleau compresseur de la modernité dans son aspect le plus criminel et inhumain.
La solidarité internationale.
Dans le cadre de la section Berlinale Specials, Raoul Peck a présenté son nouveau film [photo], Assistance mortelle (Fatal Assistance). Ce titre en oxymoron dit l’ironie et la lucidité avec lesquelles le réalisateur haïtien aborde la politique internationale de l’aide humanitaire. Le film fait le bilan de plus de deux ans d’intervention internationale en Haïti, après le terrible tremblement de terre qui a mis le pays à genoux un certain 12 janvier 2010. La catastrophe humaine a eu un bilan des plus lourds dans l’histoire de notre temps : environ 316.000 morts, 300.000 blessés, 1.000.000 de sans abris, 250.000 habitations et 30.000 commerces détruits. La réaction de la communauté internationale ne s’est pas laissée attendre. La bonne volonté universelle s’est très vite manifestée. Pays riches, personnalités célèbres, institutions internationales et organisations non gouvernementales ont annoncé leur soutien à la population haïtienne. Mais les bons sentiments, la noblesse des âmes et les déclarations les plus touchantes sont des choses difficilement traduisibles en actes concrets. C’est cela que le documentaire de Raoul Peck semble nous enseigner, pour ne pas dire, remettre en cause.
Cinéma et urgence ne font pas nécessairement bon ménage. Il est trop naïf de penser qu’une réaction artistique et intellectuelle puisse être conçue en concomitance avec les crises graves ou les catastrophes humaines. Les films issus des premières semaines ou même mois de ce qui s’appelle le Printemps Arabe ont été vite dépassés par les événements mais aussi par les différentes formes de discours élaborées avec plus de patience et de pénétration des faits. Raoul Peck a pris son temps. Non seulement il a suivi son sens critique qu’on lui connait mais aussi il est resté cohérent avec son projet. Trois ans après la catastrophe et l’énorme mobilisation internationale, qu’en est-il de la reconstruction promise au Haïtiens?
Que les choses ne se passent pas comme il a été prévu, cela pourrait être compréhensible, mais pour le cinéaste lucide et bon observateur, il y a pire : à l’imprévu structurel auquel toute organisation ou institution pourrait être confrontée vient s’ajouter une forme diffuse d’incohérence qui cacherait des formes plus suspectes et plus ramifiées de profit au nom des bonnes causes. Non seulement une part des promesses n’a jamais été tenue, mais aussi une grande partie de l’argent déboursé s’est évaporée. C’est dire que beaucoup de déclarations sont plus destinées à redorer l’image médiatiques de leurs auteurs qu’à traduire des intentions réelles d’assister les sinistrés. Pis encore, l’aide financière servirait moins à financer les projets de reconstruction qu’au développement et à la promotion des organisations d’aide et leurs lobbys.
Au moyen d’interviews des représentants des différentes structures et l’observation des faits sur le terrain, le réalisateur parvient à démontrer comment le dialogue de sourds entre l’effort international d’un côté et les structures nationales de l’autre se traduit par l’inefficacité la plus totale et conduit même à rendre le drame de la population encore plus absurde, au lieu de l’améliorer. La communauté internationale peut se contenter d’une fausse bonne conscience mais les sinistrés du séisme n’ont pas encore ne serait-ce que des toilettes pour s’en tenir aux besoins les plus basiques. C’est que le tragique dans cette situation n’est pas seulement dans la catastrophe naturelle qui s’est abattu sur Port-au-Prince. Il est à chercher dans l’histoire de l’humanité, comme a déclaré Raoul Peck dans le débat qui a suivi la projection du film dans la Haus der Berliener Festspieler. « Haïti est un pays qui n’est pas supposé exister : premier pays indépendant (1804) dans l’histoire de la colonisation après les USA, et qui plus est, premier pays noir ». Quelle volonté au monde, tel qu’il est actuellement, accepterait qu’un pays pareil puisse se remettre sur pieds ? Et puis il y a un constat encore plus inquiétant : si le monde a échoué dans la reconstruction d’Haïti, cela signifie que l’humanité est incapable de faire face à n’importe quelle catastrophe.
La jeunesse défavorisée
Il est des films qui se veulent à l’écoute d’une jeunesse qui est si ballotée par le destin et la misère que sont sort ne peut être que tragique. C’est le cas du groupe de jeunes Ivoiriens qu’on retrouve dans Le Djassa a pris feu (Burn it up Djassa) le film de Lonesome Solo projeté dans le cadre du Panorama. Il s’agit d’un film pour les démunis, les pauvres et les subalternes, dirait Gramsci. L’univers est celui des bas fonds d’Abidjan. Là, une faune de jeunes perdus vit au jour le jour entre les sorties nocturnes dans les maquis et les veillées dans le Ghetto. Ce dernier est montré comme un monde à lui seul en dehors du temps et de l’espace. L’histoire racontée est atemporelle, bien qu’elle soit parfaitement vraisemblable.
D’une part, le film se veut extrêmement réaliste. Les personnages collent parfaitement à la vie ordinaire dans les rues de Wassakara, l’un des quartiers ghettos abidjanais. Tony gagne sa vie en vendant des cigarettes le jour et en jouant aux cartes le soir dans des bars improvisés. Ange, sa sœur, frustrée dans son travail dans un salon de coiffure se prostitue le soir pour ramener un peu plus d’argent. Une situation toute explosive, à l’image du pays, à la veille de la guerre civile dont l’enclenchement est imminent.
D’une autre part, la manière dans les événements sont racontés donne au film une certaine élévation et une construction particulièrement originale. Le récit est mené un peu à la manière d’un morceau de rap où de temps en temps un refrain revient donner du tempo.
Le film est bien ancré aussi bien dans la réalité comme dans le cinéma. En apparence, il reconduit les composantes du thriller à l’Africaine comme on en voit beaucoup dans la production vidéo. La vie d’Ange et son frère bascule dans le drame le jour d’une bagarre qui tourne mal. Le drame gagne en tension quand on apprend que celui qui mène l’enquête policière n’est autre que Mike, le frère ainé d’Ange et Tony. La poursuite finale confrontera les deux frères. Le film aurait été banal de ce point de vue n’eut été le deuxième niveau de narration introduit par des interventions en nouchi, le jargon des jeunes rappeurs du Wassakara, qui ponctuent le film et lui donne son rythme et en élève le discours.
L’esthétique du film est la synthèse de plusieurs formes d’expression et même de traditions : le thriller comme genre cinématographique, le rap comme langage de cette jeunesse et d’une manière très subtile la tradition plus ancienne du griot. Le jeune rappeur qui intervient de temps en temps pour compléter et commenter l’histoire, est l’incarnation du Griot hérité de la narration orale africaine adapté au rap et au cinéma. Le ghetto devient la métonymie de tout le pays et le fratricide qui s’y joue l’allégorie de la guerre civile qui mettra plus tard la Côte d’Ivoire à sac. Le Djassa a pris feu est produit par Philippe Lacôte, avec le soutien (en autres) de la Francophonie.
Voir des films pareils dans un festival est un signe qu’il y a encore de la place à un cinéma social. Et quand on sait que par ailleurs, la Berlinale a un projet énorme de formation destiné aux jeunes, on comprend alors tout le fond didactique du festival. Le Talent Press accueille les jeunes journalistes. Le Talent Campus est ouvert à toutes sortes de jeunes professionnels du cinéma : réalisateurs, scénaristes, producteurs, organisateurs de festivals. Il doit y avoir un grand secret pour qu’un festival de cette envergure puisse avoir aussi une vocation humaniste et offrir une scène où l’écho de l’actualité brûlante peut être entendu.
Hassouna Mansouri
Africiné / Amsterdam,
envoyé spécial à Berlin
Photo : L'ancien président américain, Bill Clinton et le Premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive, à Port-au-Prince. Scène du film Assistance Mortelle (Fatal Assistance) de Raoul Peck © Velvet Film 2012.
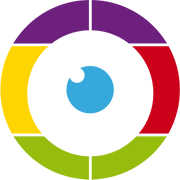 Le site cinéma et images
Le site cinéma et images